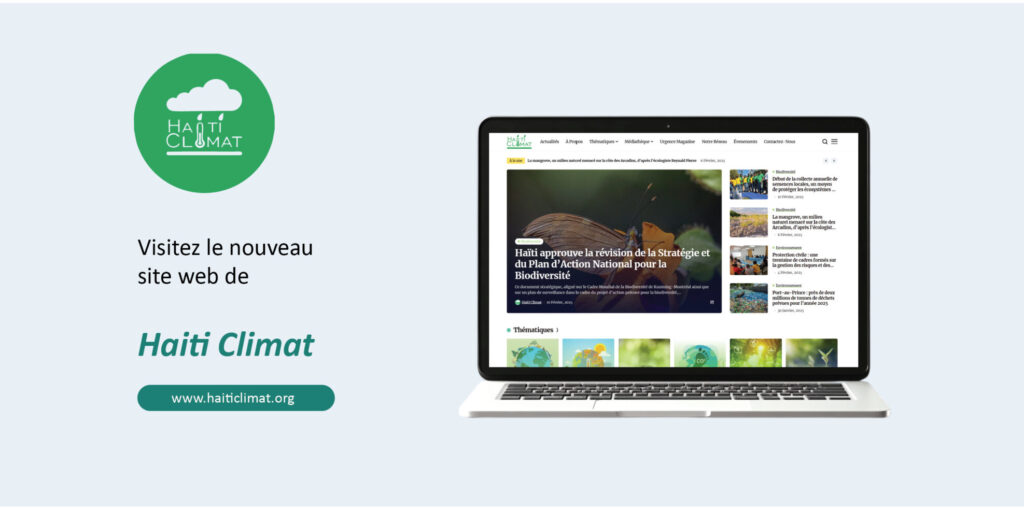Les ressources allouées au secteur de l’éducation dans le budget rectificatif 2024-2025

Le système éducatif haïtien repose majoritairement sur le secteur privé, qui dirige environ 90 % des établissements scolaires. Ce déséquilibre, hérité de décennies de désengagement de l’État, crée une situation où l’accès à l’éducation devient largement conditionné par la capacité financière des familles. Malgré l’existence d’écoles communautaires ou religieuses à faibles coûts, les frais de scolarité, de transport, d’uniformes et de manuels scolaires constituent un frein majeur à la scolarisation. Des programmes d’exemption de frais, mis en place avec l’appui d’institutions internationales, ont permis de soulager temporairement la charge des ménages les plus vulnérables. L’impact a été visible : hausse du taux de scolarisation et amélioration de l’âge d’entrée en classe. Toutefois, ces avancées restent fragiles si elles ne sont pas soutenues par un budget public ambitieux et mieux orienté.
Dans le budget rectificatif 2024-2025, les prévisions pour le secteur de l’éducation montrent peu de la volonté de l’État haïtien de rompre avec ce cycle malsain et peu productif. En effet, le budget alloué au ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) pour l’exercice fiscal s’élève à 47,3 milliards de gourdes, représentant 14,6 % du budget national total. Ce montant regroupe en même temps les crédits internes (34,6 milliards) et les financements extérieurs (12,6 milliards). En apparence, cette proportion semble considérable, mais elle cache une forte concentration sur les dépenses de personnel, qui à elles seules mobilisent plus de 29 milliards de gourdes, soit plus de 60 % du budget du MENFP. Cette structure budgétaire montre une prédominance du fonctionnement administratif sur les dépenses d’investissement. Cela limite la capacité du système à se moderniser ou à répondre aux défis structurels. En comparaison avec d’autres secteurs sociaux, l’éducation bénéficie d’un appui conséquent, mais reste marquée par un déséquilibre dans l’allocation des ressources.
Les dépenses d’immobilisation – cruciales pour la construction et la rénovation des écoles – ne représentent que 1,1 % du budget du ministère. Avec à peine 3,5 milliards de gourdes allouées à ce poste, les marges de manœuvre pour améliorer les infrastructures éducatives sont très limitées. En revanche, les biens et services, tels que les fournitures scolaires ou les frais de fonctionnement des établissements, obtiennent environ 3 % du budget total du MENFP. Le bureau du ministre, par exemple, reçoit à lui seul plus de 446 millions de gourdes, un chiffre révélateur des priorités internes. Une part non négligeable des dépenses est également répartie entre les transferts et les subventions, quoique modestes. Ces chiffres soulèvent des interrogations sur l’efficacité et l’équité des choix budgétaires opérés.
Au niveau des services internes du MENFP, les chiffres montrent également une centralisation marquée des dépenses. Par exemple, le bureau du ministre à lui seul consomme plus de 446 millions de gourdes, dont une large part est affectée aux dépenses de personnel et de fonctionnement courant. Ce déséquilibre illustre un phénomène récurrent dans l’administration publique haïtienne : une bureaucratie lourde, souvent au détriment des services directs à la population. Les investissements ciblés, comme la construction d’écoles ou l’achat d’équipements pédagogiques, restent marginaux dans la structure actuelle. Pourtant, ce sont ces dépenses qui ont le plus d’impact sur la qualité de l’apprentissage et l’égalité d’accès à l’éducation. Un réajustement des priorités internes alignerait les ressources sur les besoins réels du système éducatif.
En somme, bien que l’État haïtien consacre une part notable de son budget à l’éducation, l’analyse détaillée révèle une structure rigide et peu orientée vers la transformation durable du secteur. Les faibles investissements dans les immobilisations, combinés à une lourde masse salariale, nuisent à la qualité et à l’accessibilité des services éducatifs. Pour progresser, une réallocation stratégique des ressources est nécessaire, visant à renforcer l’infrastructure scolaire, la formation des enseignants et l’accès à du matériel pédagogique moderne. Par ailleurs, une transparence accrue dans la gestion des fonds, notamment au niveau des directions et services internes, s’impose. La refonte du modèle budgétaire pourrait ainsi contribuer à bâtir un système éducatif plus performant, équitable et résilient.