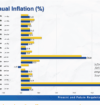CDB et Haïti, faut-il voir le verre à moitié vide ?

Depuis environ une décennie, les conférences de presse annuelles de la Banque de développement des Caraïbes se suivent et se ressemblent pour Haïti. Sur le papier, Haïti fait partie de la liste des 19 pays membres emprunteurs de la sous-région de la CDB. Dans les faits, le pays depuis son adhésion en 2007 n’a pas bénéficié un centime en prêt de la CDB. Les relations entre Haïti et l’institution financière régionale se sont toujours basées et se basent encore à l’heure actuelle sur des dons et des subventions. Pour une raison tout à fait simple : Haïti ne réunit pas toutes les conditions nécessaires pour pouvoir emprunter auprès de la Banque de développement des Caraïbes. Contrairement à d’autres petites économies de la sous-région telles que Bélize, Sainte Lucie, Antigua et Barbuda, et j’en passe…
Il n’existe dans la littérature moderne sur le développement aucun exemple de pays qui s’est développé à partir de partenariats fondés sur des dons, des subventions, de l’appui budgétaire ou encore de l’aide publique au développement. Les pays qui manifestent de réelles velléités de développement se donnent les moyens pour attirer les investissements directs étrangers, mobiliser le marché financier pour avoir accès à des capitaux frais à des conditions favorables pour financer de vrais projets de développement de grandes envergures (infrastructures, énergies, etc.). Les dirigeants de ces pays sont par-dessus tout soucieux d’instaurer et de garantir un climat de stabilité politique favorable aux affaires. Ils sont conscients que le capital est frileux et font donc le nécessaire pour non seulement l’attirer mais surtout pour le garder et le faire fructifier.
Chez nous, en Haïti, c’est plutôt l’inverse qui prévaut. À regarder de près, nos dirigeants ne montrent aucun signe de préoccupation pour la réalité décrite un peu plus haut. Dans le cas contraire, ils auraient fait en sorte que le pays remplisse les critères nécessaires pour pouvoir être un pays membre emprunteur à part entière de la CDB. Cela ne devrait pas être trop sorcier si des pays tels que la Jamaïque, les Bahamas ou encore la Guyane y arrivent. C’est l’exemple parfait, s’il en fallait un, que le potentiel ne fait pas tout. On peut avoir un potentiel extraordinaire mais sans un leadership éclairé au plus haut niveau, de la bonne gouvernance, des politiques publiques qui tiennent la route et surtout de la stabilité politique, ce potentiel ne servira strictement à rien.
Haïti est en train d’en faire l’amère expérience. Alors que les besoins de financement du développement n’ont jamais été aussi élevés, le pays a de moins en moins accès à des capitaux étrangers autres que des dons et des subventions. Depuis l’annulation d’une partie de ses dettes après le séisme de 2010, le pays ne peut plus se rendre sur le marché financier pour y contracter des emprunts. L’étiquette d’insolvabilité et aussi celle de pays très instable de la région où il ne fait pas bon d’y faire des affaires forcent des institutions financières régionales telles que la CDB à la prudence. Pas question de miser ses billes et de les risquer toutes dans un pays passé maître dans l’art du « pays-lock », de destruction des institutions, de sabotage des emplois et des investissements privés, du non-respect de la propriété privée, de la concurrence et du jeu démocratique de l’alternance politique, entre autres.
Les autorités étatiques de la République de Port-au-Prince doivent comprendre une fois pour toute que l’actuel budget national ne peut en aucun cas financer le développement réel du pays. Une grande part de ce budget est d’ailleurs allouée aux dépenses de fonctionnement en lieu et place de dépenses de capital. Une fois cette crise sans précédent derrière nous, il leur faudra de toute urgence œuvrer à la consolidation de stabilité macro-économique, à la relance de politiques publiques aptes à soutenir l’activité économique, la création d’emplois, et surtout s’atteler à revoir nos partenariats existants avec les institutions financières internationales.