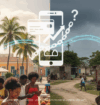Une gourde très forte : politiquement intéressante mais économiquement et financièrement coûteuse

Opinant récemment sur la récente évolution de la gourde haïtienne par rapport au dollar américain, le président de la République d’Haïti s’est félicité pour la forte appréciation de la monnaie locale, précisant que le niveau actuel du cours de cette dernière par rapport à la devise américaine est inférieur à celui enregistré au début de son mandat. Chose assez inédite pour un chef d’État qui, en général, ne commente pas sur la fluctuation des monnaies mais plutôt sur le chômage et l’inflation.
Une telle déclaration d’un président qui a accusé des spéculateurs de vouloir mettre fin à son régime en utilisant le taux de change, indique que le sujet est devenu hautement politique. Les autorités financières et monétaires crient victoire estimant qu’elles ont crevé une bulle spéculative sur le marché local des changes.
Très dépendante des importations pour combler la faiblesse de la production nationale, l’économie haïtienne devrait connaître une diminution des prix des biens provenant de l’extérieur avec le renforcement de la monnaie locale. Ceci faciliterait une baisse des prix des biens importés, non négligeables dans le panier de la ménagère. Avec un taux d’inflation se rapprochant de 25% en fin d’exercice fiscal, le gouvernement s’est retrouvé dans une situation assez difficile pour conserver le faible pouvoir d’achat d’un grand nombre de familles haïtiennes, très affectées par le double choc causé par le phénomène de « peyilock » en 2019 et la pandémie Covid-19 en 2020.
Profitant en fait de la nette appréciation de la gourde par rapport au dollar, les autorités financières ont décidé de modifier à la baisse les prix à la pompe renforçant ainsi son capital politique. A rappeler que selon un décret émis en 1995, le prix à la pompe en Haïti est déterminé par le prix du baril de pétrole brut sur le marché mondial et le taux de change du dollar par rapport à la gourde sur le marché local des changes. La contraction des activités économiques au niveau mondial, en raison de la pandémie enregistrée en 2020, a provoqué une baisse de la demande pour les produits pétroliers et causé ainsi une diminution des prix sur les marchés internationaux. En remettant le décret en application après une longue pause, le gouvernement essaie de mettre fin à une hémorragie financière, soit 2 milliards de gourdes par mois, selon le ministre de l’Economie et des Finances. Le revers de médaille pour le gouvernement est que la gourde forte pourrait empêcher les autorités fiscales de mobiliser les fonds prévus dans un budget extrêmement ambitieux de plus de 250 milliards de gourdes. La non réalisation de cet objectif mettrait de fortes pressions sur les autorités monétaires pour compenser les recettes fiscales prévues qui ne seront pas collectées. Avec 37 milliards de gourdes de financement prévu par la Banque de la République d’Haïti (BRH), la note pourrait être assez salée pour la Banque centrale si les ressources prévues dans le budget ne se révélaient pas suffisantes. Une gourde forte dans une économie faiblement productive et compétitive, aurait un impact négatif sur les exportations du pays évoluant autour de 1 milliard de dollars américains. Ceci résultera en des pertes d’emplois dans une économie déjà affaiblie par deux chocs consécutifs au cours des deux derniers exercices fiscaux. La gourde forte facilitera, d’autre part, un accroissement des importations dans le pays, ce qui creusera le déficit de la balance commerciale et pourrait ramener des tensions sur le marché local des changes. La victoire politique pourrait être de courte durée tandis que les coûts économiques seraient assez élevés à moyen terme. Un vrai dialogue entre les différents acteurs politiques, économiques et sociaux s’avère nécessaire pour retrouver une certaine stabilité politique et macroéconomique en vue de réduire l’incertitude et protéger une population récemment victime de deux importants chocs.
DevHaiti