Les constructions anarchiques minent la production agricole dans la plaine des Gonaïves
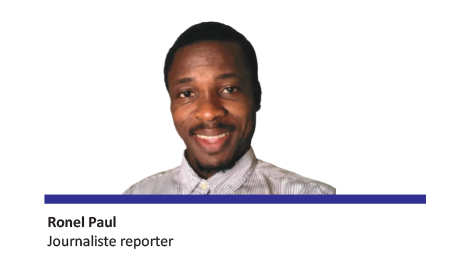
Cet article est une transcription d’un reportage multimédia réalisé par le journaliste et correspondant de RFI aux Gonaïves, Ronel Paul, aussi membre de la salle des Nouvelles de Référence FM (105.9) et du site d’informations Zoomhaitinews.com. Son reportage « Les effets de l’urbanisation et des constructions anarchiques sur la production agricole en Haïti, notamment dans la plaine des Gonaïves » a remporté le trophée du concours de reportages économiques (Catégorie multimédia) organisé par l’AHJEDD.
Haïti est dépourvu de plan d’urbanisation. Les gens en profitent pour construire n’importe où et les espaces cultivables ne sont pas épargnés. La plaine des Gonaïves, jadis considérée comme l’un des greniers du département de l’Artibonite, est aujourd’hui devenue une cité résidentielle. Considérant qu’Haïti est un pays essentiellement agricole, cette urbanisation non contrôlée a de grandes conséquences sur la production agricole et par ricochet, sur l’économie d’Haïti dans une certaine mesure.
Nous sommes à Grand-mont, une localité de la première section dénommée Pont Tamarin dans la plaine des Gonaïves, où l’on pratique notamment la riziculture.
Depuis plus de 10 ans, en lieu et place des rizières, de grandes maisons s’implantent et s’ensuit naturellement dans la zone des lots de magasins de matériaux de construction.
Lader Alexis, âgé de 32 ans et père de cinq enfants, pratique le repiquage de riz depuis son plus jeune âge sur les champs des riziculteurs en échange de rémunération. Une activité qui lui avait permis de prendre soin de sa famille. Mais depuis quelques années, son travail est considérablement réduit. «En temps normal, toutes ces terres devraient déjà être repiquées. Moi, tout ce que je souhaite: que l’Etat prenne des mesures pour empêcher aux gens de continuer à construire sur les terres agricoles. Même si une personne avait déjà fait l’acquisition d’un lopin de terre, l’Etat devrait l’indemniser et restituer les espaces cultivables», explique le jeune riziculteur, le visage dépité.
La production de riz à Grand-Mont était tellement florissante dans le temps, qu’à elle seule, elle suffisait à nourrir la population gonaïvienne, à en croire Edouard Jean, un riziculteur qui observe avec stupéfaction la construction incessante des maisons dans des espaces qui autrefois étaient réservés à produire des tonnes de riz. « Ou pa wè se kay kounya tè yo plante, olye otorite yo te ede nou pou evite moun fè kay sou tè yo ! Paske tout kay wap gade la yo se jaden ki te la.»
Se remémorant les années 90, le quinquagénaire se rappelle de la prospérité agricole de Grand-mont. « Tout tè sa yo nèt te konn fè diri. Lè w pase la ou wè patat, bannann. Ou pat ka pote 2 patat ki soti nan tè sa yo », se plaint Edouard Jean.
Mais comment ces maisons sont-elles arrivées sur les rizières de Grand-Mont?
L’agriculture haïtienne est saisonnière. Elle est dépendante entièrement de la nature. Avec le phénomène «El Nino» provoqué par les changements climatiques, la sécheresse s’est emparée d’une bonne partie du pays. Ne disposant pas d’autres moyens que la pluie pour arroser leurs terres, certains paysans ont vendu quelques parcelles en vue d’expatrier leurs enfants, regrette Rosemond Luc, coordonnateur de l’organisation paysanne KOZEPÈP dans le Haut Artibonite,
«Aujourd’hui nous possédons 19 éléctro-pompes dans la plaine des Gonaïves, ce qui ne représente absolument rien. Car ce nombre insignifiant de pompes n’alimentent que leurs périmètres et ne peuvent fonctionner que durant 8 heures par jour», poursuit le syndicaliste, qui estime que l’État haïtien est un catalyseur de ce phénomène pour avoir construit une route de contournement de la ville des Gonaïves, de Pont Gaudin, entrée ouest des Gonaïves, à Carrefour Joffre, sortie nord des Gonaïves, au détriment d’une grande partie des terres agricoles.
Selon un rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) publié en 2020, plus de quatre millions d’Haïtiens se trouvent en situation d’insécurité alimentaire aiguë. Une situation aggravée par le Covid-19, mais provoquée par l’appréciation du dollars par rapport à la gourde et surtout, par la baisse de la production agricole occasionnée par la sécheresse. Ajouter à cela, la construction anarchique dans la plaine des Gonaïves complique davantage la situation. Pourtant, la mairie est incompétente à prendre des mesures pour freiner ce phénomène, explique le professeur Kesler Pierre-Charles, directeur général de la mairie des Gonaïves. «Comment la mairie des Gonaïves peut intervenir pour empêcher quelqu’un de construire sur un espace qu’il a lui-même fait l’acquisition?», s’interroge le professeur Pierre-Charles.
La plaine des Gonaïves s’étend sur 8 000 hectares et peut générer six à dix milliards de gourdes par an, souligne le professeur Pierre Poitevien dans son livre coécrit avec l’agronome Thomas Jacques, intitulé «Gonaïves: Enjeux et défis de développement local et endogène». Pour parvenir à ce chiffre d’affaires, il nous faudrait un plan d’aménagement du territoire, explique le professeur Pierre Poitevien, doyen de la Faculté des Sciences économiques à l’Université Publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG).
M. Poitevien estime que le phénomène de la disparition des terres agricoles en Haïti se situe à plusieurs niveaux; d’abord par l’absence de plan d’aménagement.
«On ne vit pas sans un plan. Un plan de développement, c’est ce qui devrait nous conduire dans un système d’aménagement territorial. On devrait dire : voici les zones qui seront habitées et quelles zones de production agricole en fonction des besoins de la population.» Jusqu’à présent, Haïti n’a toujours pas de plan d’aménagement du territoire, regrette l’expert en administration internationale.
«Les collectivités se développent dans le plus grand désordre», conclut-il.
Suite à l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, la République dominicaine avait fermé sa frontière avec Haïti. Deux semaines seulement ont suffi pour constater une pénurie de produits alimentaires au marché communal des Gonaïves. Un signe manifeste des impacts de la disparition des espaces agricoles dans la cité de l’Indépendance. Malgré notre insistance, aucun responsable de l’Organisme pour le Développement de la vallée de l’Artibonite, ODVA, n’a voulu intervenir sur ce sujet pourtant crucial pour l’économie du pays.

DevHaiti


