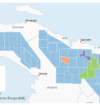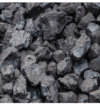Esquisse de la mauvaise gestion migratoire en Haïti

Le texte ci-dessous est un extrait tiré de la publication intitulée « Migration en Haïti : Profil Migratoire National 2015 » réalisée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Haïti. Le Profil Migratoire d’Haïti est une compilation de données sociodémographiques et économiques sur la population Haïtienne et ses migrants. Le document présente un aperçu du paysage institutionnel et législatif gouvernant la migration en Haïti.
La recherche des meilleures conditions de vie a conduit de nombreuses personnes à tenter leurs chances à l’extérieur du pays, soit dans des situations de migration irrégulière ou par l’émigration régulière vers d’autres pays de la région ou d’ailleurs.
Haïti est un important pays d’origine de migrants, à la fois réguliers et irréguliers, qui constituent une diaspora et une population migrante importante vivant dans la région Caribéenne, et particulièrement en République dominicaine, aux États-Unis, au Canada, en France et plus récemment dans des pays d’Amérique du Sud, tels que l’Équateur et le Brésil.
Au cours des 40 dernières années, Haïti a subi une combinaison de désastres naturels, de difficultés socio-économiques et d’instabilité politique qui a entrainé un phénomène important de fuite des cerveaux, de mobilité transfrontalière et de migrations irrégulières.
La migration haïtienne est généralement une migration de travail et fait partie du triangle d’emploi, entrepreneuriat et investissement qui, à plusieurs niveaux sociaux, affecte la vie des Haïtiens. Chaque sommet du triangle influe sur la décision de migrer. On constate ainsi que les principaux pays d’accueil des migrants haïtiens sont souvent ses partenaires commerciaux principaux. Néanmoins, l’absence d’informations pertinentes pour la prise de décisions est beaucoup plus courante dans les cas de projets migratoires que dans d’autres projets économiques. Comme la migration est souvent considéré comme un choix personnel et le produit d’une crise sociale ou financière, le soutien institutionnel aux décideurs et aux réseaux familiaux auxquels ils/elles appartiennent avant, pendant et après la migration est rare, multipliant ainsi la faute de sécurité et la probabilité d’échec ou de perte d’opportunités.
Malgré le potentiel reconnu entre la migration et le développement, le gouvernement d’Haïti a exploité ce potentiel d’une manière limitée, partiellement du fait de l’absence de données compréhensives et fiables sur la migration et les indicateurs y étant liés. La gestion migratoire en Haïti s’effectue dans un cadre de duplication structurelle où au moins six ministères interviennent. Malgré ce fait, il n’est pas clair si les ministères et les agences impliqués ont un personnel spécialisé dans le domaine ni à quel point les informations sur les initiatives prises au sein des organes de l’Etat sont partagées avec les autres parties prenantes, même au sein de l’administration publique. En termes d’évaluation de la coordination politique, il faut aussi souligner la concentration des ressources financières et humaines à Port-au-Prince ainsi que l’indisponibilité de certains services liés à la migration, y compris l’accès aux documents d’identité nationale hors de la capitale.
Les initiatives au niveau de l’innovation juridique liant la migration et le développement remontent à l’ère de Dessalines. Dans l’absence d’une politique migratoire claire, les lois internes en vigueur sur la migration risquent de produire des effets pervers, tout en privilégiant la clandestinité et l’informalité. L’absence d’un cadre de droit international suffisant représente aussi un défi pour Haïti, en dépit des efforts récents d’étudier les implications de l’accession aux traités principaux sur les droits humains des migrants.
DevHaiti