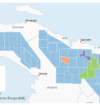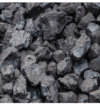À quand une politique migratoire en Haïti ?
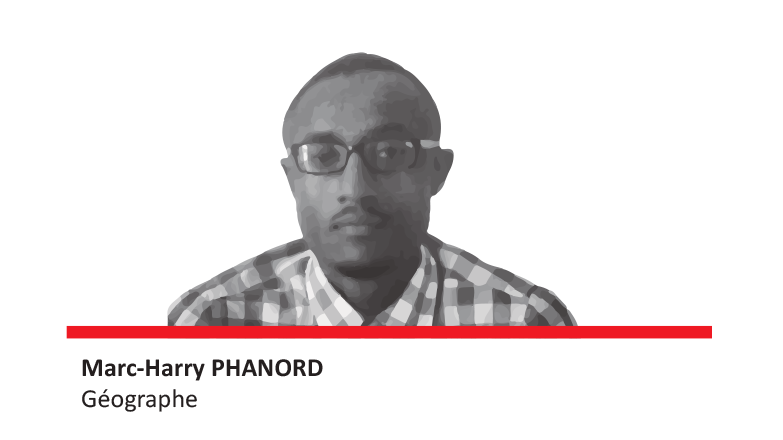
Le pays est en pleine croissance urbaine étant donné qu’Haïti a dû rentrer à partir de l’année 2010 dans une phase d’inversion de la dominante démographique rurale qui a duré plus de deux siècles (IHSI, 2009). Cette urbanisation qui fut très lente à son départ risque d’évoluer de façon galopante si l’exode rural n’est pas rapidement maîtrisé.
Déjà, les données de l’ECVMAS-2012 montrent des mutations importantes qui affectent particulièrement la structure familiale et la distribution des familles en fonction du milieu de résidence (aire métropolitaine, autre urbain, rural).
Au niveau externe, déjà près d’un tiers de la population a déclaré avoir au moins un parent vivant à l’étranger (IHSI, 2003). Ils sont dispersés partout, notamment dans les Amériques et en Europe. Dans certains pays de la région, notamment la République dominicaine, les Îles Bahamas, et les Îles Turques et Caïques, et de nos jours le Chili et le Brésil. Le taux d’immigration haïtienne dans ces populations atteint une proportion relativement significative, pose des problèmes de gestion et d’intégration socio-économique qui engendre des mesures parfois drastiques de rapatriements forcés.
L’intensité des flux de départs, malgré les difficultés d’insertion dans les pays d’accueil et les discriminations sociales qu’ils suscitent, laisse envisager l’importance de la migration pour la société haïtienne. L’intensité des flux de départs, même en période de quasi stabilité en Haïti, nous oblige à identifier et comprendre les facteurs d’influences de la migration dans la société haïtienne afin de pouvoir identifier et proposer des solutions de rétention à long terme.
De 1915 à nos jours, la question migratoire haïtienne reste d’actualité et marque environ un siècle d’histoire, si l’on considère l’occupation américaine d’Haïti et dans la région caribéenne, celle de Cuba et de la République dominicaine notamment, comme l’événement inaugural.
Il a toujours eu des échanges migratoires entre Haïti et les pays voisins, mais non suffisants pour déterminer sa situation par rapport aux migrations internationales. Cette époque a marqué également une rupture définitive avec la prétention Haïtienne au leadership régional dans le cadre du mouvement de solidarité internationale avec les peuples dominés.
Dès lors, la plupart des Haïtiens qui partirent, l’ont fait non pour contribuer aux mouvements de libération de peuples frères, mais pour «le travail» et/ou un semblant de mieux-être.
Ainsi, se trouvait institué le phénomène de fuite.
« Comment une telle Situation peut-elle soutenir à la propagande d’une politique migratoire préventive, inclusive et de rétention ? »
Des préalables sont nécessaires à la construction d’un problème public tel que celui de la migration. Il faut un état des savoirs qui fasse aussi le point sur les acteurs en conflits et les enjeux sociaux du problème. En ce sens, la politique construite suppose une triangulation entre problèmes confrontés, défis posés aux acteurs et les intérêts qui sont en jeu dans les processus observés.
Pour un phénomène comme la migration, il faut peut-être autre chose, à savoir quel regard pose-t-on sur le phénomène manifesté?
Il s’agit du point de vue privilégié pour comprendre les contours du phénomène. Souvent, il importe de croiser des regards divergents pour saisir plus nettement la réalité observable et observée. La raison, c’est qu’un regard singulier qui se veut unitaire risque de sacrifier des acteurs, l’intérêt de certaines populations au profit d’autres.
En raison de la complexité du phénomène migratoire, il est d’intérêt de l’analyser du point de vue du volume des flux migratoires et de leur impact sur la société et les politiques étrangères du pays. Il est également important de considérer ce phénomène du point de vue des réformes qu’une telle politique peut engendrer ou instituer. Parmi les grandes stratégies susceptibles d’influencer les politiques étrangères d’un État, Lelio Mamora, spécialiste argentin des migrations internationales, relève quatre grands points:
• les stratégies de pression d’un État sur un autre pour obtenir des avantages;
• les stratégies de rétribution qui consistent à accorder un privilège à un autre État en fonction, par exemple, de la configuration de leurs rapports historiques (rapports privilégiés entre ancienne puissance coloniale et ancienne colo- nie);
• les stratégies de représailles qui, dans certaines conjonctures, prennent forme de politiques d’expulsions ou de rapatriements et;
• les stratégies de négociations qui dominent particulièrement dans les dynamiques d’intégration régionale.
Dans trois cas sur quatre, Marmora se réfère à Haïti comme un cas type pour son illustration.
Entre autres, d’autres pays peuvent utiliser l’arme de rapatriement des migrants irréguliers comme stratégie de représailles pour obtenir des avantages. Dans d’autres, les migrations peuvent jouer un rôle éminemment important dans les stratégies de négociations régionales.
Dans le cas d’Haïti, il importe de souligner le fait que les deux principaux pays récepteurs de migrants haïtiens, respectivement les États-Unis et la République dominicaine, sont ainsi ses principaux partenaires économiques et commerciaux avec lesquels Haïti enregistre un grave déficit chronique de sa balance commerciale.
Au regard de l’histoire, il apparaît que tant en 1937, 1990 et de 2013 à 2015, la question migratoire et des rapatriements surgit toujours comme une pierre d’achoppement dans les relations haïtiennes et dominicaines. En ce sens, les migrations jouent un rôle structurant dans les relations diplomatiques d’Haïti et doivent être traitées avec la plus grande rigueur. En cela, résoudre les problèmes migratoires, c’est entreprendre la redéfinition des relations d’Haïti avec les pays des régions caribéennes et américaines.
L’élaboration de sa politique migratoire définit non seulement la manière dont Haïti saisit son rôle dans la division régionale et internationale du travail mais aussi la façon dont elle entend façonner l’avenir. D’où le rapport de la politique migratoire avec la réforme de l’État.
Malgré le fait que tout citoyen se sente généralement mieux dans son pays, il est constamment influencé par des facteurs de mouvements migratoires liés aux politiques économiques et sociales et au progrès démocratique de son pays. Les grands flux migratoires ont souvent pour causes des phénomènes plus ou moins identiques:
• L’instabilité politique qui engendre des moments de violence sociale ou de répression politique.
• Les crises socio-économiques, le manque d’insertion socioprofessionnelle et de services sociaux.
• Le manque de couverture de protection sociale (sécurité sociale, sécurité de revenus, assurance santé, assurance d’emploi et de chômage, des incertitudes liés aux cycles de vie, entre autres).
Une politique migratoire pour un pays comme le nôtre se veut être préventive, inclusive et de rétention. En ce sens, une politique migratoire qui n’apporte pas de réponses à ces problèmes est condamnée à l’inefficience et l’ineffectivité.
En cela, la politique migratoire appelle à la réforme de l’État et doit, simultanément, compléter des politiques de marché du travail à l’échelle nationale, de manière à prendre en compte les déséquilibres entre le marché du travail national et ceux des pays voisins, de la région caribéenne et américaine. Pour ce faire, cette politique migratoire est doublement une politique de promotion du travail décent pour tous, dans leur propre pays et de stabilité politique et économique définissant la vie en Haïti comme une alternative à la migration.
Elle a pour objectifs de :
• Contribuer au renforcement de l’intégration sociale et économique de la population haïtienne par la création de Travail de manière à recoudre les tissus sociaux;
• projeter une nouvelle image du pays, et des Haïtiens, à l’étranger en redéfinissant sa place/dans la division régionale et internationale du travail;
• Réguler les flux migratoires en augmentant l’attractivité de la vie au pays afin de réduire les migrations forcées et de promouvoir l’immigration choisie en Haïti;
• La “Rémigration”, retour volontaire de la Diaspora en vue d’apporter son expérience, savoir, sa richesse au profit du pays.
De ce fait, la politique migratoire appelle à la fois à l’adoption de réformes structurelles profondes et l’adoption de nouveaux outils législatifs permettant la coordination et la valorisation de recherches sur la migration, le développement et le suivi des politiques nationales. Elle prend en compte la capacité, souvent insuffisante, des institutions chargées d’intégrer la migration dans l’approche nationale de développement, de reconstruction et de lutte contre la pauvreté, ainsi que dans les plans sectoriels de la santé, du commerce et la mise en valeur des groupes sociaux vulnérables.
Au nombre des principales orientations de cette politique se trouvent:
• Renforcement du cadre institutionnel en fournissant les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective des mandats des institutions étatiques concernées ;
• Renforcement de l’infrastructure relative aux technologies d’information, de communications et de gestion des données afin de faciliter la bonne gouvernance, la coopération entre les parties prenantes et la gestion efficace de la migration interne et externe;
• Clarification des rôles et des responsabilités des institutions étatiques, et des autres acteurs, intervenant dans le domaine de la migration, ainsi que le renforcement du dialogue et de la collaboration entre les parties prenantes grâce à l’établissement/renforcement de forums et de mécanismes pour un engagement soutenu et organisé des groupes d’intervenants (femmes, jeunes, secteur privé, organisations non-gouvernementales (ONG), institutions et membres de la diaspora, entre autres);
• Identification des lacunes dans la dotation d’expertise dans les institutions de l’État, y compris les CASEC et autres organismes de gouvernance locale, dans les institutions de la société civile nationale et de la diaspora, et dans le secteur privé;
• Développement d’un système de suivi et d’évaluation robuste facilitant une bonne reddition de comptes et gestion de la performance, y compris le suivi et la production de rapports auprès des institutions internationales veillant au respect d’engagements impliqués par la signature et la ratification des traités principaux sur les droits humains de migrants.
La coordination interinstitutionnelle et intersectorielle joue un rôle essentiel dans l’amélioration des services migratoires. Cette coordination permettra de mieux protéger les droits humains, l’environnement et les frontières du pays.
Dans cette optique, une politique doit être souscrite à une démarche participative impliquant les différents acteurs sociaux, y compris ceux de la diaspora haïtienne dans le processus de reconstruction nationale.
Tout l’intérêt de la démarche est dans la possibilité de redynamiser les rapports entre les divers acteurs intervenant dans le champ migratoire, ou vivant d’activités intrinsèquement liées à la migration.
DevHaiti