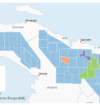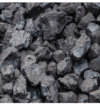Dans les méandres de la subvention des produits pétroliers en Haïti

La subvention des produits pétroliers pendant des années constitue une veine ouverte pour les finances publiques, comme aime à le rappeler à chaque occasion le ministre de l’Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert. La subvention des produits pétroliers, de mars 2010 à septembre 2018, a atteint 57 milliards de gourdes, selon des chiffres rendus publics par le ministère de l’Économie et des Finances (MEF).
Les efforts consentis par l’État pendant des années afin de maintenir les prix à la pompe malgré la dépréciation de la monnaie nationale et la hausse des prix sur le marché international se sont révélés vains. Ils ont donc poussé l’actuel gouvernement à prendre le taureau par les cornes afin de stopper cette saignée à blanc du Trésor public.
Si les débats dans l’opinion publique ne se portent jusqu’à présent que sur la forte hausse des prix à la pompe, l’on retiendra surtout que cette mesure du gouvernement a sonné le glas aussi bien pour la perte de taxes que pour la subvention directe qui faisaient perdre aux finances publiques des dizaines de milliards de gourdes.
Selon les propos du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, l’État a collecté pour l’exercice 2020-2021 96 milliards de gourdes dont 30 ont servi à subventionner les produits pétroliers. Le chef du gouvernement a présenté la subvention du carburant comme l’un des facteurs responsables de l’énorme déficit budgétaire pour l’exercice…
À titre de comparaison, cette subvention a atteint 17 milliards de gourdes pour l’exercice 2017-2018. Pour avoir une idée précise: ce montant, à l’époque, était le même que celui attribué au ministère des Travaux publics Transport et Communication et le triple de celui allouée au ministère de la Santé publique et de la Population et surpasse largement les crédits attribués au ministère de l’Agriculture des ressources naturelles et du développement rural.
Historique de nos déboires avec la facture pétrolière
Un document du Ministère de l’Economie et des Finances, faisant l’historique de la problématique pétrolière, informe qu’en 1982, la Banque de la République d’Haïti (BRH) a pris en charge le paiement de la facture pétrolière au taux officiel de cinq gourdes pour un dollar.
Selon le MEF, les réserves officielles de change ont permis à la BRH de faire face à tous ses engagements (service de la dette extérieure publique, paiement de la facture pétrolière, etc.) jusqu’en 1984.
«En 1984, pour faire face à la détérioration des réserves en devises des autorités monétaires, la BRH instaura le ‘’Programme de contrôle des exportations (PCE)’ affectant 50% des recettes d’exportation au paiement de la facture pétrolière. Les revenus générés suite à l’application de cette mesure ont permis à la BRH de satisfaire sans grande difficulté jusqu’en 1988 la demande de produits pétroliers».
Les difficultés allaient resurgir en 1990 quand les revenus générés par les exportations ne pouvaient plus couvrir la totalité de la facture pétrolière. La BRH, qui a dû utiliser d’autres ressources (TELECO, emprunts extérieurs, etc.) pour y faire face, a quand même accumulé des arriérés dans le règlement de la facture courante 1989-1990.
Pour éliminer ces arriérés, la BRH s’est engagée à payer, via un accord entrant en vigueur le 31 octobre 1990 avec les compagnies pétrolières, la somme de 1,4 million de dollars pendant six mois, à partir des revenus en devises disponibles à la TELECO.
«Ce même 31 octobre 1990, la BRH est chargée par décret d’assurer l’approvisionnement régulier du marché en hydrocarbures, devant le refus des compagnies pétrolières d’accorder à l’État haïtien de nouveaux crédits».
Ayant hérité de la patate chaude, la BRH, face à la résurgence du problème d’insuffisance de devises, a été obligée d’acheter des banques commerciales 1,5 million de dollars au taux de 67 %, pour compléter les disponibilités et régler la facture de décembre 1990.
Après avoir épuisé toutes les ressources et toutes les stratégies à sa disposition, la BRH, à partir de février 1991, a eu beaucoup de difficultés pour assurer l’approvisionnement du marché en produits pétroliers
L’embargo n’a pas aidé non plus. De 1992 à 1994, Haïti n’a pu s’approvisionner que difficilement en carburant. Il y avait constamment rareté sur le marché.
La panacée de 1995
En 1995, les incidences de la fluctuation des prix des produits pétroliers sur le marché international combinées à la situation déficitaire du fonds de stabilisation desdits produits ont conduit le gouvernement d’alors à adopter une loi devant lui permettre d’intervenir plus aisément dans la structure des prix de la gazoline, du gasoil et du kérosène.
L’article 3 de ladite loi introduit un droit spécial dit ‘’droit d’accise variable’’ qui est réajustée à chaque arrivage pour tenir compte des variations des prix susceptibles d’occasionner une augmentation ou une diminution du prix à la pompe, dans une proportion supérieure à 5%.
«La situation des prix des produits pétroliers étant relativement stable, et ce jusqu’en 2001, cette loi n’est pas entrée en vigueur immédiatement», rappelle le MEF.
Cependant, au début de l’exercice fiscal 2002-2003, l’État a subi des pertes sèches de l’ordre de 318 millions de gourdes et les crédits d’impôts aux compagnies ont atteint 72,8 millions de gourdes. La faute à la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain et la hausse des prix au niveau du marché international.
«C’est dans ce contexte que l’État haïtien a décidé le 1er janvier 2003, de ne plus subventionner les produits pétroliers en appliquant pour la première fois la loi de mars 1995 sur les accises variables. Ainsi, de janvier 2003 à février 2010, cette loi a été appliquée convenablement dans les termes et conditions», a indiqué le MEF précisant que pour cette période, 114 changements de prix à la pompe ont été recensés.
L’âge d’or de la subvention
À partir de mars 2010 et pour des raisons d’ordre économique, politique et social, l’État haïtien a décidé de geler les prix à la pompe ce, en dépit des fluctuations des prix sur le marché international.
«Cette situation persistante entraîne des pertes de recettes considérables pour le fisc. L’Etat haïtien a dû accepter non seulement de perdre les recettes attendues sur ces produits, mais aussi de rembourser aux compagnies pétrolières le montant nécessaire, non absorbé par les droits et taxes, pour maintenir inchangés les prix à la pompe», explique le MEF.
Au cours de l’exercice 2017-2018, l’Etat payait aux compagnies pétrolières 56 gourdes pour chaque gallon de kérosène vendu et 63 gourdes pour chaque gallon de diesel.
Ajoutez à cela, l’agrandissement du parc automobile. D’après une étude effectuée en mars 2013, il aurait doublé tous les sept ans. Toujours selon cette étude citée par le MEF, Il est passé de 116 223 véhicules en 1998 à 218 844 en 2007, soit une augmentation de 88 % .Et en 2012, il a atteint 407 810, soit une augmentation de 86 %. A ce rythme là, en 2019, il devrait atteindre les 700 000 véhicules.
La subvention devient donc de plus en plus lourde. À l’exception de Trinidad, pays producteur, souligne le MEF, Haïti était le pays qui affichait les prix à la pompe les plus bas de l’Amérique latine.
Les recettes sur les produits pétroliers suscités représentaient plus de 20 % du budget national. Le pays importe en moyenne 25 millions de gallons de carburant par mois pour un montant de 78,5 millions de dollars.
La subvention profite aux plus riches
Selon une étude conjointe de la Banque mondiale et du ministère de l’Économie et des Finances, 20% des plus riches consomment 93% de la gazoline et du diesel. Il en ressort que, pour l’exercice 2017-2018, une subvention de 14,5 milliards de gourdes va à 20% de la population et une subvention de 14 milliards va à 80% de la population. Les classes défavorisées ne bénéficient que des effets indirects de cette subvention.
DevHaiti