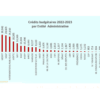L’invasion russe peut affecter sévèrement l’économie haïtienne

Nous publions in-extenso cette analyse du conflit russo-ukrainien et de son impact potentiel sur l’économie haïtienne du Dr Thomas Lalime publiée dans les colonnes du journal Le Nouvelliste en date du 7 mars 2022.
Dans mes cours d’économétrie, je prenais souvent l’exemple d’une hypothétique évolution simultanée du produit intérieur brut russe et celui d’Haïti pour illustrer la notion d’absence de causalité ou de corrélation fortuite. Celle-ci résulte d’une forte variation coïncidente entre deux variables, dénuée de tout fondement théorique, empirique ou intuitif. Avec la guerre russo-ukrainienne, cette illustration ne tient plus: les variables de l’économie russe peuvent bien avoir un impact considérable sur l’économie mondiale et sur l’économie haïtienne, en particulier. L’exemple le plus éloquent demeure l’explosion du prix du pétrole comme conséquence directe de l’invasion russe.
Le prix du baril de pétrole Brent, variété de pétrole la plus échangée sur le marché à Londres, a clôturé la journée du vendredi 4 mars 2022 à 118.11 dollars américains. Le record absolu de 147.5 dollars américains date de juillet 2008. Pour la seule séance du vendredi 4 mars 2022, le prix du baril de pétrole Brent pour livraison en mai a augmenté de 6.92 %. Et pour les huit premiers jours à compter du déclenchement de la guerre par la Russie, le prix de ce même baril de Brent a cru de 21.9 %. Avant le début de la guerre, le baril de Brent s’échangeait à 96.9 dollars américains à Londres. Le 1er décembre 2021, le prix de ce même baril s’élevait à seulement 68.94 dollars américains.
À New York, le baril de pétrole brut, en l’occurrence le «West Texas Intermediate (WTI)» avec échéance en avril, a connu une hausse de 7.43 % le vendredi 4 mars 2022. Il a clôturé la journée à 115.68 dollars américains, un niveau inégalé depuis le mois de septembre 2008.
Le prix du baril de pétrole Brent a atteint la barre de 139.13 dollars américains le dimanche 6 mars 2022. Du début de l’invasion de l’armée russe en Ukraine au dimanche 6 mars, le prix du baril de pétrole a flambé de 33%. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), principale variété américaine, à échéance en avril, a atteint le niveau de 130.50 dollars américains ce dimanche 6 mars.
Les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) envisagent de libérer plus de 60 millions de barils de pétrole de leurs réserves en vue de stabiliser un marché en panique et boosté par l’incertitude créée par la guerre. La Russie est le 3ème producteur mondial de pétrole avec une production d’environ 10 millions de barils par jour.
Hausse des prix à la pompe
Les consommateurs ressentent déjà les effets de la flambée des prix du baril de pétrole. Les prix à la pompe ne cessent de grimper partout dans le monde. Aux États-Unis d’Amérique, le prix du gallon (3,78 litres) d’essence ordinaire en Californie s’élevait à 5 dollars le vendredi 4 mars 2022, un record. Au Canada, dans la ville de Vancouver, le gallon d’essence était vendu à plus de 7.6 dollars canadiens. Ces prix sont déjà revus à la hausse ce lundi 7 mars. Certains automobilistes canadiens envisagent même de trouver d’autres alternatives à l’utilisation de leur voiture en pensant au covoiturage, au transport en commun, voire à la vente purement et simplement de leur voiture, selon les témoignages recueillis par Radio Canada.
Ce sont les premières conséquences économiques de l’invasion russe. Selon certains spécialistes, même avec la vente massive de pétrole provenant d’autres marchés ou des stocks stratégiques américains, le prix du baril de pétrole brut restera probablement au-dessus de 100 dollars américains dans un futur proche si la guerre persiste. Pour le moment, les traders évitent les importations de pétrole en provenance de Russie, ce qui provoque une baisse de trois millions de barils sur un marché qui était déjà assez volatile avant le début de la guerre.
Selon les prévisions de JP Morgan, le prix du baril de pétrole Brent pourrait même atteindre la barre de 185 dollars américains d’ici la fin de l’année si les conditions actuelles persistent. Or, certains spécialistes prévoient qu’un baril de pétrole à plus de 150 dollars américains pourrait conduire à une récession économique mondiale. L’un des mécanismes sera la hausse de l’inflation qui forcera les banques centrales à augmenter les taux d’intérêt. Cette hausse de taux, à son tour, ralentira le niveau d’activités économiques.
Haïti paiera à coup sûr les conséquences de cette flambée des prix du pétrole. Lors de la dernière augmentation des prix à la pompe sur le marché local le 10 décembre 2021, le baril du Brent s’échangeait à 75.32 dollars américains. Il a donc augmenté de 86.7 % entre le 10 décembre 2021 et le 6 mars 2022. L’État haïtien n’a donc que deux choix: augmenter à nouveau les prix à la pompe ou revenir à la subvention des prix à la pompe. D’autant plus que la dépréciation de la gourde s’est poursuivie durant cette période. Les deux options feraient augmenter l’inflation, diminueraient le pouvoir d’achat des ménages et entraîneraient donc des conséquences négatives sur leur niveau de vie.
Hausse des prix des produits alimentaires
Outre la flambée des prix du baril de pétrole, les prix du blé, du maïs et de l’engrais ont aussi connu un pic. L’Ukraine et la Russie sont des puissances mondiales dans la production de blé, de maïs et d’autres céréales. Ce sont aussi de grandes productrices et exportatrices mondiales d’engrais. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie jusqu’au 2 mars 2022, le prix du maïs a augmenté de plus de 15 %, celui du blé de plus de 25 % alors que le prix du gaz naturel a flambé davantage.
Le blé et le maïs sont des substituts au riz. En ce sens, l’augmentation de leur prix peut engendrer une hausse du prix du riz. Le blé sert aussi de matière première à la fabrication de la farine, elle-même utilisée dans la production des pâtes alimentaires et du pain. Les prix de ces produits, très prisés par les ménages à travers le monde, risquent d’augmenter drastiquement. Les autres grains peuvent suivre la même tendance. Et comme ces grains sont utilisés dans l’élevage, le prix des différentes variétés de viandes peuvent augmenter également. Le coût des produits alimentaires, à travers le monde, peut continuer à flamber si la guerre russe s’éternise.
Et comme Haïti importe la majeure partie des produits qu’il consomme, elle continuera d’importer cette inflation mondiale. L’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) vient de publier l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de janvier 2022. L’inflation globale s’élève à 24% tandis que celle des produits importés s’élevait à 33 % contre 19.1 % pour les produits locaux. Les ménages haïtiens constatent donc dans leurs poches et leur assiette la hausse des prix des produits sur le marché international.
L’autre produit dont le prix est affecté par l’invasion russe qui aura de grandes répercussions sur Haïti demeure l’engrais. Celui-ci est très utilisé dans la Vallée de l’Artibonite, notamment. Si son prix augmente sur le marché international, les effets seront ressentis dans la production de riz et d’autres denrées. L’économie russe n’a jamais été aussi proche de l’économie haïtienne ! En fait, le monde est devenu un village global et l’économie mondiale, par voie de conséquence, on ne peut plus interconnectée. En ce sens, les sanctions économiques imposées à la Russie représentent une arme à double tranchant qui peut en retour impacter négativement l’économie mondiale.
À noter que les prix des céréales étaient déjà à la hausse avant le début de la guerre. Pour preuve, l’Indice FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) des prix des produits alimentaires a affiché une inflation mensuelle de 3.9% en février 2022 et une inflation annuelle de 24.1%. Il s’agit d’un niveau record qui dépasse de 3.1 points le niveau le plus élevé qui a été enregistré en février 2011. Selon la FAO, «la hausse de février est principalement due à la forte progression des sous-indices des prix des huiles végétales et des produits laitiers. Les prix des céréales et de la viande ont également augmenté, tandis que le sous indice des prix du sucre a reculé pour le troisième mois consécutif.»
De son côté, l’Indice FAO des prix des céréales accuse un taux d’inflation mensuelle de 3% en février 2022 et une inflation annuelle de 14.8%. «En février, les prix de toutes les principales céréales ont augmenté par rapport à leurs valeurs respectives du mois dernier. Les prix mondiaux du blé ont progressé de 2.1%, en grande partie sous l’effet de nouvelles incertitudes quant à l’offre mondiale, dans un contexte de perturbations dans la région de la Mer noire qui pourraient potentiellement entraver les exportations de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, deux exportateurs majeurs de blé. Les prix à l’exportation des céréales secondaires ont eux aussi augmenté, de 4.7%.», précise la FAO.
Les prix mondiaux du maïs ont augmenté de 5.1% par rapport au mois dernier, selon la FAO, à la fois en raison des craintes persistantes quant aux conditions de culture en Argentine et au Brésil, de la hausse des prix du blé et des incertitudes concernant les exportations de maïs en provenance d’Ukraine, un exportateur important. Parmi les autres céréales secondaires, poursuit l’organisation mondiale, les prix du sorgho et de l’orge se sont affermis depuis le mois précédent: ils gagnent respectivement 5.9 et 2.7%. Les prix internationaux du riz ont augmenté de 1.1% en février, soutenus en premier lieu par l’appréciation des monnaies de certains exportateurs par rapport au dollar des États-Unis et par une forte demande de riz parfumé de la part des acheteurs du Proche-Orient asiatique.
La prochaine publication des indices de la FAO renseignera davantage sur les conséquences de la guerre sur les prix des produits alimentaires. Il s’avère évident que si la guerre russe en Ukraine se poursuit, les inflations mondiale et locale risquent de s’amplifier avec toutes les conséquences que cela implique pour les ménages haïtiens, particulière- ment sur les plus vulnérables.

Thomas Lalime Economiste