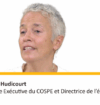La Réforme Bernard vue par Gaston Georges MÉRISIER

Cet article est écrit dans le but de répondre à deux (2) questions qui ont été posées à l’auteur à savoir :
1. Est-ce que 40 ans plus tard, la Réforme Bernard a pu atteindre son objectif ?
2. Qu’est-ce que cette réforme a apporté à notre système d’éducation ?
À la première question, la réponse est double: tout d’abord «non», si on se réfère à la période de mise en œuvre qui a été fixée (1979-1991); et «on ne sait pas encore», si on considère que c’est une réforme inachevée; sa phase de mise en œuvre n’ayant fait l’objet d’aucune démarche soutenue, seule l’évalua- tion de la phase d’expérimentation du Nouveau Secondaire a été jusqu’ici réalisée. Dès le début, des problèmes ont émergé de toutes parts pour ralentir le processus et rendre la mise en œuvre inefficace: rejet par certains acteurs des orientations données notamment en ce qui concerne la place accordée au Créole comme langue d’enseignement et langue enseignée, difficultés à produire à temps les programmes d’études ainsi que les matériels pédagogiques et didactiques de support, faible niveau de financement public alloué (seulement 10.39% du Budget de l’État, exercice fiscal 1980-1981), etc.
Rappelons que cette Réforme a été lancée en 1979 sous l’impulsion des bailleurs de fonds internationaux (bilatéral et multilatéral) à un moment où l’expansion de l’éducation et les problèmes résultant des exigences et des espoirs croissants de la société dans ce domaine ont suscité dans toute la région d’Amérique latine et des Caraïbes un mouvement de réforme du même genre.
En Haïti, le système éducatif était jusqu’alors organisé, en partie, suivant les prescrits de la Loi du 5 août 1919 en ce qui concerne l’enseignement primaire et de l’Arrêté du 15 juin 1923 ainsi que de la Loi du 17 octobre 1963 en ce qui concerne le secondaire. L’enseignement primaire était toujours organisé en six (6) années et l’enseignement secondaire (classique) en sept (7) années.
La Réforme Bernard envisage de transformer l’enseignement primaire de 6 ans en enseignement fondamental et de l’étendre à 10 ans: un premier cycle de 4 ans, un deuxième cycle de 3 ans et un troisième cycle de 3 ans avec cette fois une double option classique et préprofessionnelle.
Pour préparer l’entrée des enfants à l’école fonda- mentale, la section enfantine prévue à l’article 5 de la Loi du 5 août 1919 a été maintenue et transformée en ordre d’éducation préscolaire devant être dispensée, selon l’article 19 de la Loi du 30 mars 1982, dans des jardins d’enfants et des écoles maternelles, ainsi que dans des Centres intégrés de Nutrition et d’Éducation Communautaire.
Aujourd’hui encore, la majorité des écoles fonda- mentales à travers le pays (85.26%) ne comportent que 6 classes fondamentales; et le peu d’écoles fondamentales complètes qui existent (14.74%) ont 3 cycles totalisant 9 années fondamentales. Quant à l’éducation préscolaire, elle est en grande partie dispensée dans des classes intégrées dans des écoles fondamentales (92.82%) et seulement 7.18% dans des jardins d’enfants.
Les premières préparations pour le lancement de la réforme du Secondaire ont démarré environ 20 ans plus tard avec la création, par Décision ministérielle, en 1997, d’une Commission chargée de formuler des propositions à cet effet et la création en 2001, également par Décision ministérielle, de 20 Groupes Techniques de Champs Disciplinaires chargés d’élaborer les Programmes-cadres ainsi que les programmes d’études qui ont pu permettre de lancer officiellement la phase d’expérimentation en octobre 2002 par Décision ministérielle mais rendue effective en 2006 dans un échantillon de 62 écoles dont 34 lycées répartis dans 7 Départements géographiques du pays (Artibonite, Grand-Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest).
Actuellement, la majorité des écoles secondaires (environ 98%) contiennent encore les classes de 6e, 5e et 4e dénommées maintenant 7e, 8e et 9e années fondamentales pour être conformes à la nomenclature prônée par la Réforme Bernard; et presque l’intégralité de ces écoles n’offrent que la filière générale.
En guise de réponse à la deuxième question, on peut tout au moins retenir cinq (5) choses :
1. L’attitude vis-à-vis du Créole des acteurs militant au sein du système éducatif a plus ou moins évolué positivement au fil du temps notamment au niveau de la grande majorité des écoles fondamentales; tous les élèves étant obligés de subir les examens officiels de Créole administrés à la fin de la 9e année;
2. La structure des ordres d’enseignement établis par la Réforme Bernard est tout au moins officiellement adoptée avec leur nomenclature propre;
3. Les examens officiels sont organisés pour sanctionner uniquement la fin de l’enseignement fondamental (9e année) et la fin de l’enseignement secondaire (Nouveau Secondaire IV);
4. L’accès du système scolaire est plus ou moins démocratisé, les effectifs d’élèves n’ayant cessé de croître, depuis 1990, à tous les ordres d’enseignement et de formation, même quand il reste encore beaucoup à faire du point de vue de la qualité et de l’inclusion notamment en ce qui concerne les enfants à besoin spéciaux et ceux vivant en milieux défavorisés;
5. Les plans, les programmes et les projets élaborés depuis de nombreuses années s’inscrivent presque tous dans la dynamique de la réforme.
DevHaiti