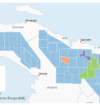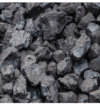L’évolution du mouvement coopératif en Haïti : entre solidarité, défis et résilience

Une coopérative est une entreprise fondée sur la coopération entre ses membres, qui en sont en même temps les propriétaires et les usagers. Elle repose sur des valeurs de solidarité, de responsabilité, d’équité et de démocratie. Contrairement aux entreprises traditionnelles, l’objectif principal d’une coopérative n’est pas la maximisation du profit, mais la satisfaction des besoins communs de ses membres (comme l’accès à des services, à un emploi ou à des produits à un prix juste). Chaque membre dispose d’un droit de vote égal, quel que soit le montant de sa contribution financière. Les bénéfices, appelés excédents, sont souvent réinvestis dans l’organisation ou redistribués entre les membres selon leur participation. Les coopératives peuvent exister dans plusieurs secteurs : agriculture, finance (comme les coopératives de crédit), logement, consommation, travail, etc. Elles jouent un rôle crucial dans le développement économique local et la résilience sociale.
Les coopératives sont guidées par sept principes fondamentaux définis par l’Alliance coopérative internationale. Ces principes incluent : l’adhésion volontaire et ouverte à tous, le contrôle démocratique par les membres, la participation économique des membres, l’autonomie et l’indépendance, l’éducation et la formation, la coopération entre coopératives, et l’engagement envers la communauté. Cela signifie qu’en plus de fournir des services ou des biens, une coopérative éduque ses membres, renforce le tissu social et soutient des initiatives locales. En intégrant ces principes, les coopératives favorisent un modèle économique plus équitable, durable et inclusif. Elles sont particulièrement pertinentes dans les contextes où les marchés ou les États ne répondent pas efficacement aux besoins des populations.
Le mouvement coopératif en Haïti prend racine au début du XXᵉ siècle. Cependant, c’est sous la présidence de Sténio Vincent en 1937 qu’il reçoit un cadre légal avec la première loi autorisant officiellement la création de coopératives. Dix ans plus tard, en 1947, les premières coopératives agricoles émergent dans les zones rurales, amorçant une mise en œuvre concrète sur le terrain. En 1981, la création du Conseil national des coopératives (CNC) marque une étape cruciale en instituant un organe chargé de l’encadrement et de la régulation. La loi de 2002 vient renforcer ce cadre en visant à développer les caisses populaires et à démocratiser l’accès aux services financiers. En 2007, la première fédération des caisses, Le Levier, voit le jour pour renforcer le secteur. Enfin, en 2014, l’État étend les services de supervision via le DIGCP dans les Cayes et au Cap-Haïtien, consolidant ainsi le soutien de proximité au mouvement coopératif.
Au tournant des années 1990-2000, les coopératives d’épargne et de crédit, connues sous le nom de Caisses populaires, ont connu une forte croissance, parallèlement à l’essor des institutions de microfinance non mutualistes. Toutefois, une grave crise éclate en 2002-2003 à la suite de pratiques frauduleuses, causant d’importantes pertes pour les épargnants et une perte généralisée de confiance. Cette crise incite les autorités à adopter une nouvelle loi en 2002 pour encadrer plus strictement les CEC et leurs fédérations. La Banque de la République d’Haïti (BRH) renforce alors son implication, en créant la Direction de l’inspection générale des caisses populaires (DIGCP), chargée de la supervision du secteur. Ce dispositif vise à sécuriser les dépôts, protéger les membres, et améliorer la transparence. En 2018, la BRH rappelle le rôle essentiel de ces coopératives dans le développement local et la démocratie économique. Elles restent des structures clés pour répondre aux besoins économiques, sociaux et culturels de la population.
En conclusion, le mouvement coopératif en Haïti s’est construit au fil des décennies comme un pilier essentiel du développement économique et social, particulièrement dans les zones rurales et marginalisées. Malgré les défis, notamment la crise de 2002-2003, les coopératives ont su se réinventer grâce à un encadrement juridique renforcé et à des mécanismes de supervision plus rigoureux. Aujourd’hui, elles représentent bien plus qu’un modèle économique élémentaire : elles incarnent un espace de solidarité, de participation démocratique et de résilience collective. En soutenant les initiatives locales, en facilitant l’accès aux services financiers, et en valorisant l’entraide communautaire, les coopératives haïtiennes continuent de jouer un rôle crucial dans la construction d’un avenir plus inclusif et durable pour le pays.

DevHaiti