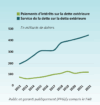Enjeux des politiques de revenu de base universel dans les pays en développement
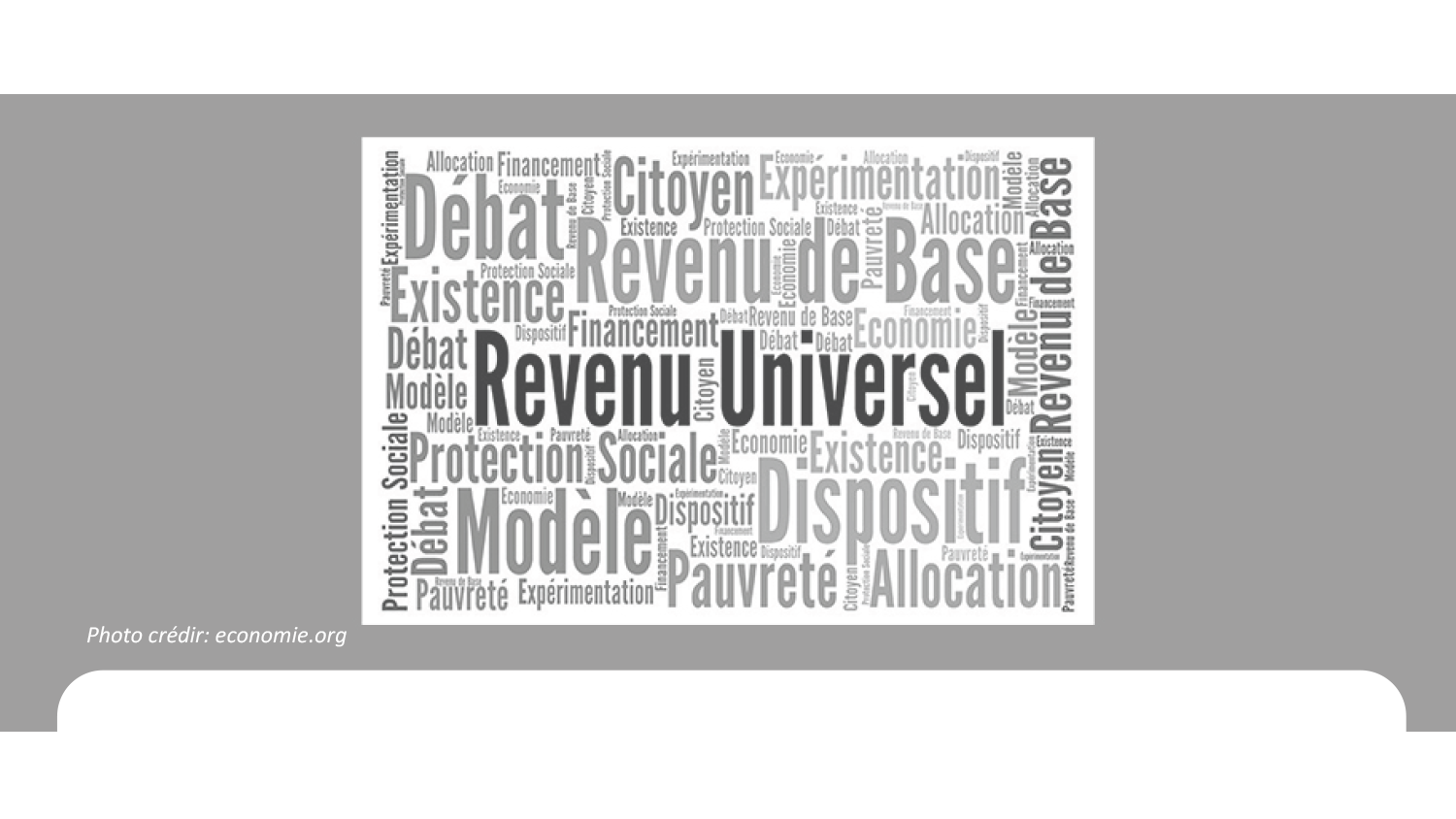
Les politiques de revenu de base universel (UBI, pour son sigle en anglais) sont devenues très populaires dans les débats publics à travers le monde. Les causes pour adopter l’UBI varient selon les catégories de pays. Dans les pays avancés, la peur que l’automation et l’intelligence artificielle ne prennent la place du facteur travail est l’argument principal. Dans les pays en développement, c’est plutôt l’objectif d’éradiquer la pauvreté, en essayant d’augmenter le revenu des gens.
Si de manière tautologique le revenu universel semble être une bonne idée en ce sens qu’il permet d’augmenter automatiquement le revenu des gens, son impact n’est pas aussi évident. Dans certains pays où les marchés pour les services sociaux ne sont pas développés ou n’existent pas tout simplement, l’UBI peut ne pas être la meilleure option. Plusieurs recherches ont été menées par des académiciens pour évaluer les réels effets de l’UBI dans les pays en développement et les incitations microéconomiques qui vont avec. Il existe deux grands arguments contre l’adoption de l’UBI:
1- Il est probable que dans les pays ou les marchés des services sociaux ne sont pas développés ou n’existent pas, les bénéficiaires dépensent l’argent davantage dans l’alcool, le cigarette etc.
2- L’argument de la dépendance (l’UBI peut décourager l’offre de travail ou la demande d’emploi).
Ces arguments font sens du point de vue de la logique. Premièrement, si les bénéficiaires n’ont pas accès à des marchés où ils peuvent se procurer de services médicaux, éducatifs etc. à un coût raisonnable, il se peut que l’argent ne soit pas dépensé dans ces services. Deuxièmement, si la différence entre l’UBI et le salaire minimum est faible, il se peut que les gens ne veuillent pas travailler, ce qui peut être un obstacle à la productivité et au développement.
Toutefois, comme le veut l’économie expérimentale aujourd’hui, tous les arguments logiques doivent être évalués avec des données réelles pour établir ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas dans les discussions de politiques publiques. Plusieurs travaux empiriques ont été réalisés durant la dernière décennie pour éclairer les lanternes des décideurs politiques sur les possibles impacts de l’UBI. Les économistes français et indien, respectivement Esther Duflot et Abhijit Banerjee, prix Nobel de l’économie en 2019, en sont les pionniers.
Les évaluations, généralement, n’ont pas révélé les impacts négatifs que beaucoup craignaient. En examinant les données sur les biens de tentation, Evans & Popova (2017) constatent que les transferts ont en moyenne réduit les dépenses en biens de tentation de 0,18 écart-type. En d’autres termes, loin de gaspiller leurs transferts en alcool et en tabac, les bénéficiaires semblent boire et fumer moins. Cette constatation ne diminue en rien la gravité du problème de l’abus de substances pour les pauvres, mais elle suggère que le manque d’argent peut être une cause de l’abus de substances plutôt qu’une contrainte à cet égard.
Banerjee et al. (2017a) passent en revue les études qui mesurent les effets des transferts sur l’offre de travail, peut-être la mesure la plus concrète des efforts déployés par les bénéficiaires pour améliorer leur propre vie. Du point de vue des bénéficiaires, bien sûr, le temps est précieux, et passer ce temps à gagner de l’argent a un coût réel ; il pourrait être très bon pour eux de pouvoir substituer une partie des revenus non gagnés aux revenus gagnés. Cela dit, Banerjee et al. (2017b) ne trouvent aucune preuve systématique que les transferts découragent le travail.
Un autre enjeu de l’UBI dans les pays en développement est la capacité réelle des gouvernements de l’adopter et de l’implémenter. Les pays en développement font particulièrement face à des problèmes de recettes fiscales et de capacités managériales suffisantes pour financer et conduire n’importe quelle politique publique. Adopter l’UBI requiert avant tout de pouvoir collecter l’argent du côté des contribuables. Il faut donc non seulement améliorer l’efficacité des gouvernements pour collecter les taxes mais aussi leur degré de transparence pour que cela puisse tenir à long-terme. La transparence est ici fondamentale en ce sens qu’elle améliorera la confiance entre les citoyens et les contribuables, facteur déterminant de revenu fiscal sur le long-terme.
Face aux problèmes de la pauvreté, des inégalités sociales, de la malnutrition, de la protection sociale etc. l’UBI peut être une réponse efficace des gouvernements. Les impacts de l’UBI sont loin d’être tautologiques comme le bon sens veut le faire croire. Si les revenus des gens augmentent de manière automatique, cela ne garantit pas que l’argent reçu sera dépensé dans les biens et services nécessaires au développement des familles. Il faut que l’UBI soit accompagné de marchés où les bénéficiaires peuvent se procurer les services sociaux. L’Etat dans les pays en développement doivent développer des capacités fiscales et managériales pour financer et implémenter les politiques publiques de l’UBI. Dans ces conditions l’UBI peut être un véritable outil politique pour garantir la dignité des citoyens dans les pays en développement.
États-Unis (ALASKA) : En Alaska, chaque citoyen reçoit une part des recettes pétrolières et gazières de l’Amérique, soit entre 1 000 et 2 000 dollars. Les résultats du programme n’ont pas eu d’effet sur l’emploi mais ont eu un effet sur la fécondité en encourageant les gens à avoir plus d’enfants.
États-Unis (Caroline du Nord) : Un autre programme a été mis en place en Caroline du Nord, où chaque membre recevait entre 4 000 et 6 000 dollars par an. Les résultats ont montré que ce programme améliorait la santé mentale et l’éducation et qu’il ne décourageait pas les gens de travailler.
CANADA : Le programme Mincome, s’adressait aux habitants du Manitoba et a été mené en 1974. Chaque famille recevait 16 000 CAD. Les résultats du programme ont montré une amélioration de l’éducation, les enfants scolarisés étant moins impliqués dans le travail. Le deuxième projet pilote a été mené en Ontario en 2017. Les participants célibataires recevaient 16 989 CAD et les participants mariés 24 027 CAD. Ses résultats préliminaires ont montré une diminution de la consommation d’alcool et de tabac chez plus de 50 % des participants.
Brésil : Le Bolso Familia en 2004 (la politique était conditionnée) Les participants ont dû maintenir leurs enfants à l’école et se rendre dans les dispensaires.
Entre 2008 et 2014, un autre essai de revenu de base a eu lieu dans le village de Quatinga Velho. Il s’adressait à cent parti- cipants qui recevaient chacun 30 reals (8 dollars) par mois.
En 2020, le Brésil a introduit un autre programme de revenu de base, connu sous le nom de Renda Básica de Cidadania, destiné aux habitants de Marica. Chaque participant recevait 130 reals (35 dollars). Le programme était financé par les redevances pétrolières et le fonds était accessible sous la forme d’une…
Finlande : En 2016, la Finlande a lancé un programme expérimental de revenu de base destiné aux chômeurs. Le programme visait 2 000 participants sélectionnés au hasard et chacun d’entre eux recevait 560 euros. Le programme a pris fin en 2018. Les résultats du programme expérimental ont montré que les participants étaient plus heureux et moins stressés, ce qui s’est traduit par une amélio- ration de leur état de santé.
Namibie : La Namibie a mis en place un programme pilote de revenu de base entre 2008 et 2009. Chaque habitant d’Otjivero-Omitara a eu droit à 100 dollars namibiens (6,75 dollars) par mois. Les résultats du programme pilote ont montré que les cas de malnutrition infantile avaient considérablement diminué et que le taux de scolarisation avait augmenté. De même, les délits sociaux tels que le vol ont consi- dérablement diminué.
Inde : L’Inde a mis en place un programme pilote de revenu de base entre 2011 et 2012. Le programme a ciblé 6 000 résidents de Madhya Pradesh. Le programme a été financé par l’Unicef et s’est déroulé en deux phases.
Au cours de la première phase, chaque homme, femme et enfant avait le droit de recevoir une allocation. Chaque adulte recevait 200 roupies et chaque enfant 100 roupies. L’allocation pour les enfants était versée au tuteur. Au bout d’un an, l’allocation a été portée à 300 roupies et 150 roupies pour les adultes et les enfants respectivement.
Au cours de la deuxième phase, chaque membre du village rece- vait 300 roupies par adulte et 150 roupies par enfant. Les résultats des deux programmes ont montré une amélioration de la nutrition, de l’assainissement et de la fréquentation scolaire des enfants.
DevHaiti