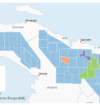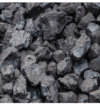Notre économie informelle et son lot d’inconvénients

Haïti a la réputation d’un pays de débrouillardise. C’est une vérité. La débrouillardise de la population est visible à chaque coin de rue, dans les stations de véhicules, dans les bus et camionnettes de transport en commun et même dans les bureaux, symbolisant l’économie formelle. Les données officielles confirment que les activités informelles représentent 80% de notre économie.
On ignore s’il existe des études qui fixent la taille ou les chiffres d’affaires des entreprises du secteur informel. Mais ce n’est pas surprenant qu’on peut y retrouver des business évalués à des dizaines de milliers de dollars américains ainsi que des commerces de quelques dizaines de gourdes. C’est un véritable secret de polichinelle, dans un pays où le chômage est roi, l’économie informelle reste le salut de la majorité de la population active haïtienne.
Si l’économie informelle assure la survie de la grande majorité de la population haïtienne, elle charrie aussi son lot d’inconvénients. Elle prive l’Etat d’importantes ressources qui pourraient financer les soins de santé, l’éducation, la construction d’infrastructures…au profit de la population. Ce n’est pas un hasard si Haïti vit surtout de la solidarité internationale avec toutes les contraintes qui marchent avec. On doit aussi reconnaitre le poids de la corruption dans cette situation. C’est souvent la corruption qui freine les efforts de l’Etat à formaliser les entreprises évoluant dans l’informel.
Une économie évoluant à 70% dans l’informel traduit l’image d’un Etat faible, incapable de contrôler les activités qui se déroulent sur son territoire. La crise sécuritaire qui handicape l’économie ces dernières années en est une conséquence. Aujourd’hui, une bonne partie du territoire échappe au contrôle de l’Etat. Cela est possible à cause du manque de contrôle sur ce qui sort et qui entre sur le territoire national.
Le poids des activités informelles dans l’économie suggère aussi que la majorité des citoyens n’ont pas accès au crédit ni aucune protection sociale. Selon la Banque mondiale, dans les pays en développement, la majorité des travailleurs exercent une activité non déclarée, c’est-à-dire un emploi qui ne leur offre aucune protection sociale et ne leur permet guère de gérer les risques auxquels leur famille est exposée.
En Haïti, où les catastrophes naturelles sont récurrentes, les victimes se retrouvent souvent seules quand elles perdent leurs biens ou leurs business. Avec parfois un support insuffisant de l’Etat ou des ONG, elles doivent remuer ciel et terre pour trouver les moyens de reprendre leurs activités. L’incendie récurent des marchés publics résume le calvaire des gens évoluant dans l’économie informelle. En s’endettant à chaque fois pour recommencer, les victimes des catastrophes sont piégées dans le cercle vicieux de la pauvreté. Et quand les gens évoluant dans l’économie informelle arrivent à l’âge de la retraite ou s’ils sont handicapés par une maladie ou un accident, ils se retrouvent sans revenus à la merci de bons samaritains.
Si l’économie informelle permet de s’échapper du fisc, elle traîne cependant son lot d’inconvénients notamment la perpétuation de la pauvreté souvent d’une génération à une autre. Dans un tel contexte, l’Etat a intérêt à travailler afin de réduire le poids de l’informel dans l’économie. C’est un combat dans lequel toute la société doit s’engager. La société n’a rien à perdre mais tout à gagner dans cette bataille.
«En Haïti, le terme informel est entendu comme l’opposé d’enregistré, d’officiel; il ne doit donc pas être assimilé au travail au noir ou à une activité illégale», fait remarquer André Calmont dans un article intitulé «Haïti: De ruptures en ruptures, un territoire en mutation». Pour être plus claire, il précise que bon nombre de commerces légaux et déclarés mènent d’ailleurs une partie de leurs activités dans l’informel : emplois non déclarés, achats et ventes sans facture, paiements en liquide, double comptabilité, etc.
Les opérateurs économiques, poursuit-il, justifient le recours à l’informel par le fait que le non-respect de la réglementation sociale et fiscale permet aux entreprises de minimiser leurs coûts, notamment salariaux, et de maximiser leur rentabilité ; ils justifient le recours à de telles pratiques par la nature excessive et inadaptée de la réglementation publique et par la concurrence déloyale que l’informel exerce à l’égard des entreprises du secteur formel. A son avis, l’insuffisance, voire l’absence de contrôle de l’État, et son incapacité à faire respecter les lois et règlements expliquent aussi le développement du secteur informel. «De fait, le formel et l’informel se nourrissent l’un l’autre», croit-il.
Une autre précision de l’auteur pour bien comprendre le secteur informel: « es activités économiques généralement considérées comme étant informelles sont celles qui sont caractérisées par la petite taille et le non-respect de la réglementation». Le secteur informel, précise André Calmont, a toujours existé en Haïti, comme dans tous les pays en développement, mais depuis l’ouverture commerciale du pays en 1986, il a pris une ampleur considérable et il représenterait aujourd’hui plus de 80 % des emplois de l’aire métropolitaine, par exemple.
Que sont les activités informelles? Il s’agit du travail indépendant, artisanat de « proximité», commerce ambulant, restauration de rue, etc. «Ces activités sont réalisées par des personnes qui s’efforcent de sortir de la misère et du chômage par tous les moyens et elles témoignent, dans une certaine mesure, d’une forme de créativité et de débrouillardise indéniable», explique l’article André Calmont.
DevHaiti