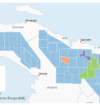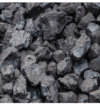Le système de paiement haïtien et son intégration au système financier mondial

Parmi les quatre missions principales dévolues à la Banque de la République d’Haïti (BRH), l’une d’entre elles consiste particulièrement à assurer l’efficacité, le développement et l’intégrité du système de paiements qui constitue l’un des piliers importants de toute économie moderne. En effet, il facilite les échanges de biens et services, tout en assurant la fluidité des transactions financières. Coup d’œil sur le système de paiement haïtien dans un environnement mondial de plus en plus globalisant
Au gré de l’évolution surprenante de la technologie, chaque pays développe son système de paiement, en fonction de ses besoins spécifiques, son infrastructure technologique et sa réglementation financière, tout en respectant les normes et standards internationaux. La Banque centrale haïtienne, à travers son document d’information paru en aout 2024 et intitulé ‘’Le système de paiement en Haïti’’, a fait une analyse assez édifiante de celui-ci. Dans cette analyse, la BRH met en lumière l’évolution des infrastructures, méthodes et moyens de paiement. Elle évoque les implications de la Banque centrale dans le processus de modernisation dudit système ainsi que les contributions des fintechs dans l’amélioration des modalités de paiement dans l’économie haïtienne.
L’analyse de la BRH du système de paiement en Haïti a mis l’accent sur plusieurs points, dont :
– L’évolution des moyens de paiement en Haïti.
Ainsi bien avant l’indépendance haïtienne, les habitants de la colonie de Saint-Domingue utilisaient le troc (tabac, sucre, lettre comme moyen d’échange) et des instruments monétaires rudimentaires (”peso gordo” espagnol, gourde, gourdins, escalin)
Après, de 1804 à 1880, le pays n’a expérimenté aucune institution financière viable, capable d’assurer la gestion du système de paiement et le financement de son économie. Sur le plan monétaire, la circulation de plusieurs monnaies était permise sur le territoire national, comme le peso gordo espagnol, la livre coloniale française et des pièces de monnaie de l’Empire britannique. Cela n’a pas empêché la sévère rareté de monnaie de mai 1813 sous la présidence d’Alexandre Pétion, qui allait conduire à la première émission de papier-monnaie d’une valeur de 300 000 gourdes. Ce faisant, Haïti devint l’un des rares pays à avoir émis de la monnaie papier sans contrepartie métallique.
Malgré tout, les émissions monétaires se raréfiaient et la pénurie a persisté jusqu’aux années 1850-1870, en dépit des efforts du gouvernement de Boyer. Pour y remédier, ce dernier a lancé de nouvelles émissions de billets en 1826. Cependant, des crises économiques et politiques, comme le tremblement de terre de 1842 et la révolution de 1843, ont conduit à la dévaluation de la gourde.
De 1870 à 1875, la réforme monétaire et les nouvelles émissions de billets n’ont pas amélioré la situation de la monnaie. En 1881, la gourde a été alignée sur le franc français. Cependant, cet alignement a été suspendu en 1912 avec l’indexation de la gourde sur le dollar américain à un taux de 5 gourdes pour 1 dollar. Ce régime a laissé la place en 1991 à celui de taux de change flottant, entérinant l’effritement de la parité fixe de la gourde au dollar ÉU officiellement en vigueur depuis l’occupation américaine de 1915. Lors de cette même année (1991), les cartes de crédit ont été introduites dans l’économie, et depuis, les paiements électroniques se sont développés. Cependant, l’utilisation du numéraire (pièces et billets) reste encore prédominante.
– Utilisation et prédominance du numéraire dans les transactions.
Le système de paiement haïtien actuellement se caractérise par une utilisation intensive de billets de banque et de pièces de monnaie dans les échanges commerciaux et les opérations financières. Malgré les efforts de modernisation tentés lors des dernières années, le cash reste le moyen de paiement le plus utilisé, tant dans le secteur formel qu’informel. De 2017 à 2023, une accélération du rythme de progression des billets et pièces en circulation a été enregistrée, de 13 % en 2017 à 24,12 % en 2023.
Ce recours accru au numéraire n’est pas exempt de coûts, aussi bien pour la Banque centrale, les banques commerciales que pour l’économie en général, affectant l’efficience économique.
– Les cartes de paiement en Haïti
Grâce aux partenariats avec les réseaux internationaux Visa et Mastercard, les établissements bancaires haïtiens émettent des cartes de paiement en vue de permettre à leur clientèle d’effectuer les transactions en toute sécurité, tant en Haïti qu’à l’étranger. L’installation des points de vente (POS) dans les centres commerciaux, stations de services, restaurants, hôtels, entre autres, favorise l’utilisation croissante des instruments de paiement, mobilisant de manière automatique des dépôts bancaires d’un compte à un autre. Ainsi, les banques ont augmenté leur offre de produits spécifiques, adaptés aux besoins des potentiels titulaires de cartes de paiement. En effet, lors des quinze dernières années, le nombre de cartes de débit et de crédit émises a augmenté de manière considérable, ce qui favorise un plus grand accès aux services de paiement et améliore l’inclusion financière.
– Émergence et développement de portefeuille mobile, de la banque en ligne et du paiement électronique.
Les portefeuilles mobiles ont été introduits en Haïti lors de la période post-séisme de janvier 2010 qui a vu la destruction d’environ 30 % des structures physiques des banques. Une telle situation a poussé les compagnies de téléphonie mobile à s’allier aux banques commerciales en vue de proposer à leurs abonnés des plateformes de services de paiement, leur permettant de réaliser des transactions financières. Le fort taux de pénétration de la téléphonie mobile dans le pays a rendu possible ces changements.
Toutefois, la « fracture numérique » est de nature à ralentir l’essor des méthodes de paiement via les supports mobiles. Cela inclut l’accès à Internet, aux ordinateurs, aux téléphones intelligents et aux compétences numériques nécessaires pour utiliser efficacement ces technologies.
L’intégration du système de paiement haïtien au système financier mondial
Le système de paiement haïtien est relié au reste du monde grâce à un réseau de banques correspondantes situées à l’étranger. Par le biais de cette correspondance bancaire, les institutions financières haïtiennes facilitent le financement des échanges commerciaux entre Haïti et ses partenaires. À titre d’illustration, un opérateur économique haïtien, souhaitant payer un bien qu’il désire importer, peut demander à une banque haïtienne de procéder au paiement en son nom. Cette opération implique que la banque locale débite le compte de son client, puis utilise son réseau de banques correspondantes à l’étranger pour demander de transférer les fonds au fournisseur. Ces transactions sont possibles grâce au système de paiement SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), qui réalise les mouvements financiers transfrontaliers entre les institutions financières, à l’échelle mondiale.

DevHaiti