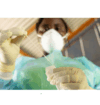Covid-19 n’a pas tout emporté…

En dépit des craintes suscitées par la crise née de la propagation de la pandémie de Covid-19 à l’échelle mondiale, tout n’est pas perdu. Les vaccinations, la reprise lente aux Etats-Unis, les 540 milliards de dollars d’envois de fonds en 2020, laissent entrevoir le bout du tunnel.
Quand l’OMS a annoncé le 11 mars 2020 que le niveau de propagation de la Covid-19 lui vaut l’appellation de pandémie, les craintes commencèrent dès lors à se préciser. Pays après pays, les mesures de restrictions se sont imposées jusqu’à affecter l’économie mondiale. Les pays à faibles revenus craignaient le pire. En ce qui concerne Haïti, même si le pays a enregistré officiellement ses premiers cas dès mars 2020, il a été globalement épargné en comparant ses chiffres de victimes aux centaines de milliers d’infectés et de morts enregistrés notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.
« Alors que la Covid-19 exerce toujours un effet dévastateur sur les familles du monde entier, les remises migratoires confirment leur rôle de planche de salut pour les populations pauvres et vulnérables, souligne Michal Rutkowski, directeur mondial du pôle Protection sociale et emploi de la Banque mondiale. Les mesures d’accompagnement et les systèmes nationaux de protection sociale doivent continuer de favoriser l’inclusion de toutes les communautés, y compris les migrants », lit-on dans un communiqué de la Banque mondiale de mi-mai 2021.
En juin, dans ses « Perspectives économiques » de la région, la Banque mondiale constate que les conditions économiques extérieures se sont améliorées depuis le début de l’année. La hausse des prix des produits de base a accru les recettes publiques et les envois de fonds des migrants restent importants, ce qui aide à maintenir les dépenses de consommation au Honduras, au Salvador, à la Jamaïque, au Guatemala et au Nicaragua. Le nombre de touristes étrangers ne représente qu’une infime fraction des niveaux pré-Covid dans une grande partie des Caraïbes, mais en République dominicaine et au Mexique, il est remonté ces derniers mois à près de 50 % des niveaux antérieurs.
Le PIB régional devrait progresser de 5,2 % en 2021, moyennant un déploiement plus rapide des vaccins dans la plupart des pays, un allégement des restrictions de déplacement, des retombées positives de la situation dans les économies avancées et une hausse des prix des produits de base. La croissance devrait ralentir à 2,9 % en 2022. Le retour de la production aux niveaux pré-COVID sera lent dans une grande partie de la région. En 2022, selon les prévisions, le PIB régional par habitant sera inférieur de 1,5 % au niveau de 2019.
Depuis la mi-mai 2021, la Banque mondiale relève que les envois de fonds vers la région Amérique latine et Caraïbes auraient progressé de 6,5 % en 2020, pour atteindre 103 milliards de dollars. Après la chute brutale des remises migratoires en volume au deuxième trimestre de 2020, liée à la pandémie, les transferts ont rebondi aux troisième et quatrième trimestres.
Le redressement de l’emploi aux États-Unis, même si le pays n’a pas encore renoué avec les niveaux pré-COVID, explique la hausse des envois de fonds vers le Mexique, le Guatemala, la République dominicaine, la Colombie, l’El Salvador, le Honduras et la Jamaïque, puisque la grande majorité des travailleurs émigrés de ces pays y sont installés.
Selon la dernière édition de la note d’information de la Banque mondiale sur les migrations et le développement, les envois de fonds officiellement enregistrés vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint 540 milliards de dollars en 2020, soit à peine 1,6 % de moins qu’en 2019, quand ils étaient ressortis à 548 milliards de dollars. Tout compte fait, les risques de détérioration prédominent encore, notamment : les campagnes de vaccination sont plus lentes que prévues, constat d’une recrudescence des cas de COVID-19, des réactions défavorables du marché aux difficultés financières et perturbations liées aux tensions sociales et aux catastrophes naturelles. La durabilité de la reprise dépend fortement de l’endiguement de la pandémie.
La viabilité des finances publiques suscite une inquiétude grandissante, sachant que la dette publique brute a atteint 64 % l’année dernière et que la dette extérieure est également montée en flèche. Les perturbations liées aux catastrophes naturelles continuent de poser un risque pour la région. À plus long terme, l’absence de mesures visant à réparer les dommages causés par la pandémie, notamment en investissant dans l’infrastructure et les nouvelles technologies, assombrirait les perspectives, selon la Banque mondiale.
DevHaiti