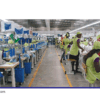Etzer Emile: « Le problème ne sera pas résolu tant que le salaire minimum ne garantit pas un revenu décent… »

« Les ouvriers n’auraient pas besoin de gagner les rues si la question d’augmentation du salaire minimum était claire et que les autorités concernées la prenaient à cœur », a affirmé l’économiste Etzer Emile à son émission « Éducation Économique » ayant eu pour thème «le dossier du salaire minimum : les enjeux économiques».
« Le problème ne sera pas résolu tant que le salaire minimum, qui est le seuil fixé par l’Etat, ne garantit pas un revenu décent pour des conditions socioéconomiques stables», a poursuivi l’économiste indiquant que le salaire minimum, suivant le pays, peut être fixé par heure (comme c’est le cas aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, en Corée du Sud, en Allemagne etc.), par jour (Haïti, Japon et Mexique), par semaine (Nouvelle Zélande, Malte), et par mois (Belgique, Portugal, Espagne, Pays Bas etc.).
Deux courants de pensée divergent sur la question, à savoir :
a) Le courant qui ne voit que le côté négatif de l’augmentation du salaire minimum notamment l’augmentation du taux de chômage, l’augmentation des prix, l’augmentation des coûts de production, etc.
b) Le courant marxiste qui fait le rapport entre la productivité du salarié (force de travail du salarié) et le salaire perçu qui ne sont pas du tout proportionnels. C’est à cause de ce grand écart entre ces deux indicateurs que les marxistes parlent d’exploitation des salariés.
En Haïti, on n’avait pas toujours eu de salaire minimum, et c’est en août 1934, plus précisément le 10 de ce mois, que l’Etat a fixé pour la première fois le salaire minimum. Avant cette date, le salaire était fixé par les employeurs au détriment des employés. Ce premier salaire minimum était fixé à une gourde et cinquante centimes pour une journée de travail.
Et depuis lors on a assisté à une évolution du salaire minimum comme suit : de 1.5 gourde en 1934, il est passé à 2 gourdes en 1945, en 1947 à 3.5 gourdes, en 1984 à 15 gourdes, en 1995 à 36 gourdes, en 2003 à 70 gourdes, en 2009 à 125 gourdes, en 2010 à 150 gourdes, en 2012 à 200 gourdes, en 2014 à 260 gourdes, en 2016 à 350 gourdes, en 2017 à 385 gourdes, en 2018 à 420 gourdes et à 500 gourdes en 2019. Depuis lors, le salaire minimum n’a pas été ajusté tandis que l’inflation touche le niveau record de 24% en 2021.
Quel que soit le secteur considéré, la question du salaire a toujours été une véritable lutte entre patrons et ouvriers. Les patrons trouvent toujours des raisons pour ne pas augmenter le salaire minimum tandis que les ouvriers et les défenseurs des droits des ouvriers trouvent bien d’autres raisons pour faire valoir le contraire.
Pour les patrons, on note:
a) L’augmentation du taux de chômage. Selon eux, l’augmentation du salaire minimum entrainerait le licenciement d’une partie de leurs employés à cause d’une trop grande masse salariale. Ils utilisent souvent cet argument pour faire pression sur l’Etat.
b) L’augmentation des prix des marchandises due à l’augmentation des coûts de production.
c) L’incapacité à étendre leur entreprise.
d) La diminution de leurs bénéfices. Dans le cas d’Haïti, ces entreprises peuvent générer plus de bénéfices sur le marché des changes avec l’augmentation du taux du dollar par rapport à la gourde que dans la vente des produits.
e) Perte de leur compétitivité par rapport aux autres pays de la zone en raison de l’augmentation des prix de leurs produits. Ce qui entraîne- rait aussi une baisse des exportations.
Avant de passer en revue les arguments de la partie adverse, rappelons que les entreprises étrangères n’investissent pas seulement en raison des prix des salaires qui sont bas, mais elles sont aussi attirées par la stabilité, la sécurité, une perpétuelle lutte contre la corruption etc.
Pour ceux qui sont pour l’augmentation du salaire minimum, les arguments ne manquent pas non plus et nous pouvons citer:
a) L’attribution d’un salaire de qualité dans le but de lutter contre la pauvreté. Un bon salaire dit-on permet de s’éloigner du seuil de pauvreté.
b) L’augmentation de la consommation des ménages se traduisant par une augmentation des ventes au niveau des entreprises locales, ce qui implique aussi de meilleurs chiffres d’affaires pour les entreprises.
c) Une relance de l’économie. Et pour expliquer cela, prenons la formule qui permet de calculer le PIB.
PIB= C+I+G+(XN)
Avec le C pour la consommation. Pour vous dire que, bien que la consommation ne soit pas le seul facteur pour déterminer le PIB, plus le salaire est élevé, plus la consommation des ménages est élevée, plus le PIB sera élevé. Ce qui implique du même coup une nette avancée économique.
Et la théorie de Keynes n’en dira pas le contraire.
d) Une plus large collecte de taxe au niveau de l’Etat notamment avec la taxe sur le chiffre d’affaires (TCA).
e) Une augmentation de la productivité. Ce qui évitera trop de roulement quand on tient compte des coûts des formations et des recrutements.
f) La création d’un climat de paix au niveau de la société, en d’autres termes, une augmentation des salaires peut aider à diminuer les troubles au sein de la société, en témoignent les émeutes des 6 et 7 juillet 2018. « Les ouvriers n’auraient pas besoin de gagner les rues si la question d’augmentation du salaire minimum était claire et que les autorités concernées la prenaient à cœur », a affirmé l’économiste Etzer Emile à son émission « Éducation Économique » ayant eu pour thème « le dossier du salaire minimum : les enjeux économiques ».
« Le problème ne sera pas résolu tant que le salaire minimum, qui est le seuil fixé par l’Etat, ne garantit pas un revenu décent pour des conditions socioéconomiques stables », a poursuivi l’économiste indiquant que le salaire minimum, suivant le pays, peut être fixé par heure (comme c’est le cas aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, en Corée du Sud, en Allemagne etc.), par jour (Haïti, Japon et Mexique), par semaine (Nouvelle Zélande, Malte), et par mois (Belgique, Portugal, Espagne, Pays Bas etc.).
Deux courants de pensée divergent sur la question, à savoir :
a) Le courant qui ne voit que le côté négatif de l’augmentation du salaire minimum notamment l’augmentation du taux de chômage, l’augmentation des prix, l’augmentation des coûts de production, etc.
b) Le courant marxiste qui fait le rapport entre la productivité du salarié (force de travail du salarié) et le salaire perçu qui ne sont pas du tout proportionnels. C’est à cause de ce grand écart entre ces deux indicateurs que les marxistes parlent d’exploitation des salariés.
En Haïti, on n’avait pas toujours eu de salaire minimum, et c’est en août 1934, plus précisément le 10 de ce mois, que l’Etat a fixé pour la première fois le salaire minimum. Avant cette date, le salaire était fixé par les employeurs au détriment des employés. Ce premier salaire minimum était fixé à une gourde et cinquante centimes pour une journée de travail.
Et depuis lors on a assisté à une évolution du salaire minimum comme suit : de 1.5 gourde en 1934, il est passé à 2 gourdes en 1945, en 1947 à 3.5 gourdes, en 1984 à 15 gourdes, en 1995 à 36 gourdes, en 2003 à 70 gourdes, en 2009 à 125 gourdes, en 2010 à 150 gourdes, en 2012 à 200 gourdes, en 2014 à 260 gourdes, en 2016 à 350 gourdes, en 2017 à 385 gourdes, en 2018 à 420 gourdes et à 500 gourdes en 2019. Depuis lors, le salaire minimum n’a pas été ajusté tandis que l’inflation touche le niveau record de 24% en 2021.
Quel que soit le secteur considéré, la question du salaire a toujours été une véritable lutte entre patrons et ouvriers. Les patrons trouvent toujours des raisons pour ne pas augmenter le salaire minimum tandis que les ouvriers et les défenseurs des droits des ouvriers trouvent bien d’autres raisons pour faire valoir le contraire.
Pour les patrons, on note:
a) L’augmentation du taux de chômage. Selon eux, l’augmentation du salaire minimum entrainerait le licenciement d’une partie de leurs employés à cause d’une trop grande masse salariale. Ils utilisent souvent cet argument pour faire pression sur l’Etat.
b) L’augmentation des prix des marchandises due à l’augmentation des coûts de production.
c) L’incapacité à étendre leur entreprise.
d) La diminution de leurs bénéfices. Dans le cas d’Haïti, ces entreprises peuvent générer plus de bénéfices sur le marché des changes avec l’augmentation du taux du dollar par rapport à la gourde que dans la vente des produits.
e) Perte de leur compétitivité par rapport aux autres pays de la zone en raison de l’augmentation des prix de leurs produits. Ce qui entraîne- rait aussi une baisse des exportations.
Avant de passer en revue les arguments de la partie adverse, rappelons que les entreprises étrangères n’investissent pas seulement en raison des prix des salaires qui sont bas, mais elles sont aussi attirées par la stabilité, la sécurité, une perpétuelle lutte contre la corruption etc.
Pour ceux qui sont pour l’augmentation du salaire minimum, les arguments ne manquent pas non plus et nous pouvons citer:
a) L’attribution d’un salaire de qualité dans le but de lutter contre la pauvreté. Un bon salaire dit-on permet de s’éloigner du seuil de pauvreté.
b) L’augmentation de la consommation des ménages se traduisant par une augmentation des ventes au niveau des entreprises locales, ce qui implique aussi de meilleurs chiffres d’affaires pour les entreprises.
c) Une relance de l’économie. Et pour expliquer cela, prenons la formule qui permet de calculer le PIB.
PIB= C+I+G+(XN)
Avec le C pour la consommation. Pour vous dire que, bien que la consommation ne soit pas le seul facteur pour déterminer le PIB, plus le salaire est élevé, plus la consommation des ménages est élevée, plus le PIB sera élevé. Ce qui implique du même coup une nette avancée économique.
Et la théorie de Keynes n’en dira pas le contraire.
d) Une plus large collecte de taxe au niveau de l’Etat notamment avec la taxe sur le chiffre d’affaires (TCA).
e) Une augmentation de la productivité. Ce qui évitera trop de roulement quand on tient compte des coûts des formations et des recrutements.
f) La création d’un climat de paix au niveau de la société, en d’autres termes, une augmentation des salaires peut aider à diminuer les troubles au sein de la société, en témoignent les émeutes des 6 et 7 juillet 2018.

DevHaiti