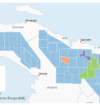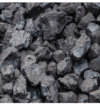Haïti : En dépit de la crise, le secteur des coopératives s’affiche résilient

La crise sociopolitique, économique et sécuritaire qui secoue sévèrement le pays depuis 2018 n’est pas sans conséquences sur les secteurs de la vie sociale et économique. Et dans cette logique, le secteur des coopératives n’est pas épargné. Les caisses d’épargne et de crédit se débattent pour continuer à exister, à en croire les différents acteurs et personnalités intervenus lors d’un débat tenu dans le cadre de la 13e édition du Sommet international de la Finance à l’initiative de la Banque de la République d’Haïti (BRH), le Group Croissance et le Centre de Facilitation des Investissements (CFI).
Intervenant à ce panel de discussions sur l’impact de la crise sur le secteur des coopératives, Jocelyn Jean Baptiste, assistant directeur à la direction de l’inspection générale des caisses populaires (DIGCP) au niveau de la Banque de la République d’Haïti (BRH), dresse un tableau critique de la situation des caisses populaires haïtiennes en ces temps troublés. «Les conséquences de cette crise se reflètent dans différents aspects [de la vie] des coopératives d’épargne et de crédit», a-t-il fait savoir. «Malgré la crise, le secteur connaît une croissance de 21 %. Et les liquidités se sont accrues de 17,52 %».
Le secteur comporte 74 coopératives d’épargne et de crédit — ou caisses populaires pour un total de 2 fédérations, Le Levier et Le Sociétaire, mais aussi une association qui est l’association nationale des caisses populaires haïtiennes (ANACAPH). On retrouve les caisses dans les 10 départements géographiques du pays — majoritairement situées dans le département de l’Ouest. Au total, on décompte 1 million 256 mille 54 membres dans les coopératives dont 60 % d’hommes, 37 % de femmes et 3 % de personnes morales qui sont des entreprises et associations.
Au 30 septembre 2022, 81 % des dirigeants des Coopératives d’Épargne et de Crédit (CEC) sont des hommes et 64 % des employés sont des femmes. L’actif des CEC s’élève à 26,5 milliards de gourdes. Il était de 21,8 milliards en 2021. Le ratio de liquidité a subi une baisse de 4,06 % en passant de 53,24 % au 30 septembre 2021 à 49,18 % au 30 septembre 2022. Cette diminution n’a pas empêché les CEC de respecter le minimum de liquidités recommandé qui est de 25 % par rapport au passif-dépôts.
«Malgré la crise, les CEC continuent de grandir — elles connaissent de la croissance. Elles dégagent des excédents et maintiennent aussi un niveau de fonds propres toujours supérieur au minimum de 12,5 % recommandé», laisse croire le responsable de la BRH au cours de son intervention. «Cependant, la situation financière du secteur est globalement impactée tenant compte notamment de la baisse graduelle du niveau des fonds propres depuis quelques années — passant de 22,87 % en 2018 à 17,22 % en 2022». Certaines situations particulières engendrées par la crise focalisent leur attention comme le déplacement du siège social d’une coopérative à cause de l’insécurité, la fermeture provisoire du siège social d’une autre, la rotation du personnel opérationnel pour plusieurs, la baisse des activités de certains membres-débiteurs, poursuit-il.
Les coopératives d’épargne et de crédit œuvrent dans l’intermédiation financière, cela sous-tend, captent les épargnes et offrent des crédits. «Malgré la crise, les CEC ont accordé plus de crédits au cours de l’exercice 2021-2022, en témoigne le pourcentage du portefeuille de crédit par rapport à l’actif total du secteur qui est passé de 52,70 % en 2021 à 55,29 %. Soit une hausse de 2,59 %», affirme Jocelyn Jean Baptiste, assistant-directeur à la direction de l’inspection générale des caisses populaires (DIGCP).
«Les caisses se multiplient, mais les excédents dégagés ne suivent pas cette croissance. On ne sait pas jusqu’à quand les CEC vont pouvoir maintenir le cap pour rester dans les normes. De jour en jour, l’avoir des caisses diminue», termine le responsable.
De grands gymnastiques…
Pour continuer à exister dans un contexte sécuritaire difficile, les caisses se voient obligées de faire de grandes gymnastiques, à en croire Sony Exantus, directeur appui aux caisses à la Fédération Le Levier regroupant 41 caisses sur les 10 départements accompagnant les coopératives notamment en termes de formation «Nous faisons face à une série de problèmes qui impactent grandement le fonctionnement des caisses», reconnaît-il.
«Avec la situation actuelle, il y a des endroits qui ne sont pas accessibles. Nos ressources ne peuvent se rendre dans ces zones. Ce qui fait que nous sommes obligés d’utiliser la technologie pour mieux accompagner les dirigeants, les employés de nos caisses, ce, afin que les sociétaires puissent trouver de meilleurs services tous les jours», confie-t-il. «Avec la situation sociopolitique, nous avons du mal à nous déplacer sur les zones. Ce qui nous donne des problèmes à pouvoir procéder aux vérifications de toutes nos caisses», souligne-t-il en guise d’impacts de la crise les empêchant notamment de procéder à la vérification des caisses membres.
Il y a des zones où les caisses n’ont pas fait d’assemblée générale. Or, c’est une tâche légale auxquels les dirigeants doivent s’atteler. «Des caisses ne peuvent le faire en raison de la situation dans certaines zones. Je ne sais pas jusqu’à quand cette situation va perdurer. Nous sommes obligés de jongler avec les situations pour au moins permettre aux caisses de continuer à fonctionner et pouvoir donner plus de services», regrette Sony Exantus, directeur d’appui aux caisses à la Fédération. «Les caisses ne peuvent donner du service. Certains se voyaient même dans l’obligation de fermer temporairement en attendant que le calme revienne pour pouvoir recommencer à fonctionner ».
Pour sa part, Guyson Célestin de l’Association nationale des Caisses populaires haïtiennes (ANACAPH), qui est un réseau de caisses au même titre que Le Levier et Le Sociétaire, se plaint du fait que les caisses se retrouvent dans l’incapacité de tenir régulièrement leur assemblée générale dans le délai prescrit par la loi en raison de la situation d’insécurité qui sévit en Haïti. Il n’y a pas que ça. Les fédérations sont également incapables de réviser et d’approuver les rapports des caisses populaires membres. Ce qui empêche les caisses d’avancer. « Il y a une quantité importante de caisses qui ne peuvent même pas programmer leur assemblée générale jusqu’à présent. Voire des caisses qui sont obligées de faire des assemblées en catimini ne pouvant exposer trop leurs membres. Des caisses se trouvent dans l’impossibilité d’élire de nouveaux membres. Ce sont des impacts qu’a la crise», soutient-il.
ANACAPH, qui s’apprête à fêter les 25 ans d’existence en juin, est une association se donnant, entre autres, pour mission de renforcer le secteur des coopératives en faisant des plaidoyers – aussi, se propose-t-elle d’agir sur la gouvernance. Elle ne comporte pas moins de 56 caisses. Il est difficile pour l’association d’appliquer un plan de formations pour ses membres. «Ne pas pouvoir faire des assemblées générales, c’est aussi être incapable de pouvoir tenir des élections pour réélire 1/3 de ses dirigeants. Ainsi, des résolutions ont été prises par des CEC pour prolonger le mandat de certains membres. Il y a des milliers de sociétaires qui risquent un bon matin de ne pas avoir les services habituels», laisse-t-il entendre.
«Effectivement, l’actif de la caisse augmente, mais les dépenses augmentent aussi. Elles mettent en péril la pérennité des caisses», dit-il, une façon de souligner que cette crise débutée en 2018 n’est pas sans conséquence sur son secteur. «Nou ap pare n pou n rebondi. Men se ak anpil ensetitid», projette Guyson Célestin de l’Association des Caisses populaires haïtiennes.
Kotelam se porte bien malgré tout
Mme Béatrice Georges, directrice générale de la coopérative d’épargne et de crédits, Kotelam, au compteur 33 ans d’existence — est durement impacté. Composée d’environ 132 mille sociétaires, 81 employés et de 15 dirigeants, elle offre, entre autres, des crédits logements, énergie, à la consommation et pour business. Racontant l’histoire de la compagnie, la responsable n’a pas cessé de mettre en exergue les différentes crises auxquelles elle a eu à faire face. La crise des coopératives des années 2000 a eu de graves conséquences sur Kotelam qui a perdu de nombreux sociétaires.
Les conséquences ne s’arrêtent pas là. Après cette crise, les gens ont été réticents à rejoindre les coopératives qui ont pu tenir le coup après cette vague qui a emporté d’innombrables institutions qui se faisaient appeler caisses d’épargne et de crédit.
«Après le passage de cette vague, les gens ne voulaient plus faire affaire avec les coopératives», avance la responsable. L’autre crise qui a failli emporter Kotelam est le tragique séisme de janvier 2010 qui a terrassé la ville. S’ensuit en 2018, la détérioration de la crise sociopolitique marquée par les protestations, la multiplication des conflits armés, des enlèvements — rendant le pays invivable. Ajouté à cela, ces dernières années, la crise du carburant, sans oublier la Covid-19.
«Avec la multiplication des zones de non-droits, nos agents ont du mal à faire des recouvrements », dit-elle. Le business ne se fait pas uniquement à l’intérieur de la succursale. Il se fait dans les rues, raconte-t-elle. Les agents de crédits vont dans les rues non seulement pour démarcher les nouveaux sociétaires, les produits (épargnes et crédits), mais aussi pour faire des rappels à nos sociétaires en retard de paiement de venir payer. Nos revenus ont du plomb dans l’aile alors que nos dépenses en raison de l’inflation augmentent, se plaint la responsable. Depuis au moins 5 ans, notre portefeuille baisse du fait que les clients ne paient pas et beaucoup d’entre eux ne veulent pas faire des crédits parce qu’ils ne voient pas comment le rembourser, détaille la responsable de Kotelam. Et nous autres, avant d’accorder du crédit, nous réfléchissons beaucoup qui fait que notre portefeuille diminue.

DevHaiti