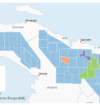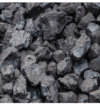Haïti, une économie dominée par l’informel

«En Haïti, le terme informel est entendu comme l’opposé d’enregistré, d’officiel; il ne doit donc pas être assimilé au travail au noir ou à une activité illégale», fait remarquer André Calmont dans un article intitulé «Haïti: De ruptures en ruptures, un territoire en mutation». Pour être plus claire, il précise que bon nombre de commerces légaux et déclarés mènent d’ailleurs une partie de leurs activités dans l’informel : emplois non déclarés, achats et ventes sans facture, paiements en liquide, double comptabilité, etc.
Les opérateurs économiques, poursuit-il, justifient le recours à l’informel par le fait que le non-respect de la réglementation sociale et fiscale permet aux entreprises de minimiser leurs coûts, notamment salariaux, et de maximiser leur rentabilité ; ils justifient le recours à de telles pratiques par la nature excessive et inadaptée de la réglementation publique et par la concurrence déloyale que l’informel exerce à l’égard des entreprises du secteur formel. A son avis, l’insuffisance, voire l’absence de contrôle de l’État, et son incapacité à faire respecter les lois et règlements expliquent aussi le développement du secteur informel. «De fait, le formel et l’informel se nourrissent l’un l’autre», croit-il.
Une autre précision de l’auteur pour bien comprendre le secteur informel: « es activités économiques généralement considérées comme étant informelles sont celles qui sont caractérisées par la petite taille et le non-respect de la réglementation». Le secteur informel, précise André Calmont, a toujours existé en Haïti, comme dans tous les pays en développement, mais depuis l’ouverture commerciale du pays en 1986, il a pris une ampleur considérable et il représenterait aujourd’hui plus de 80 % des emplois de l’aire métropolitaine, par exemple.
Que sont les activités informelles? Il s’agit du travail indépendant, artisanat de « proximité», commerce ambulant, restauration de rue, etc. «Ces activités sont réalisées par des personnes qui s’efforcent de sortir de la misère et du chômage par tous les moyens et elles témoignent, dans une certaine mesure, d’une forme de créativité et de débrouillardise indéniable», explique l’article André Calmont.
Le déclin de l’agriculture renforce l’informel
Autrefois surnommé pays essentiellement agricole, Haïti laisse tomber au fur et à mesure son secteur agricole au profit d’une économie informelle. André Calmont, constate que le déclin de l’agriculture, accéléré par l’exode rural et les catastrophes naturelles, marque une mutation profonde de l’économie haïtienne qui s’est tertiarisée, en particulier par le biais des activités informelles
Les activités agricoles, précise l’article, connaissent, depuis plusieurs décennies, une dynamique socioé- conomique régressive et ne représentent plus que 20 % du PIB national. «Le secteur ‘’agriculture, foresterie et pêche ‘’ apporte, après les services, la deuxième plus grosse contribution au produit intérieur brut (PIB), soit 20,3% en 2020», confirme l’International Fund for Agricultural Development. Pourtant selon les données disponibles, en 1970, l’agriculture représentait 35% et en 1985, plus de 32% du PIB.
Le déclin de l’agriculture haïtienne est dû à un ensemble de problèmes tels que morcellement de l’exploitation par le partage successoral, dispersion des parcelles, précarité de l’occupation de la terre, absence de cadastre, etc. A cette liste, on doit ajouter les catastrophes naturelles récurrentes dues au changement climatique qui frappent le pays au cours des dernières décennies. D’après les informations disponibles, durant le XXe siècle, le pays a été touché par 34 tempêtes, coups de vent, bourrasques, tornades, orages, cyclones ou ouragans. En 2004, le cyclone Jeanne et les pluies diluviennes ayant frappé plusieurs régions du pays avaient détruit 7% de notre PIB, les quatre cyclones de 2008 : Fay, Gustav, Hanna et Ike affectaient 15% de notre PIB. De quoi accélérer l’exode des populations rurales vers les grandes villes du pays.
La sous-traitance incapable de combler le vide créé par le déclin de l’agriculture
Les autres secteurs formels de l’économie haïtienne n’ont pas été capables d’absorber la main d’œuvre laissée de côté par le secteur agricole. En 2012, rapporte André Calmont, le secteur secondaire employait 10,4 % de la population active et a fourni 18 % du PIB. La plupart des emplois du secteur secondaire sont dans les industries d’assemblage, appelées aussi sous-traitance, installées sur le sol haïtien. Dans les années 1970 et 1980, informe l’auteur, Haïti s’était déjà engagé dans une dynamique transnationale de sous-traitance, symbolisée par le parc industriel de la SONAPI, établi dans le nord de la capitale, mais l’instabilité politique qui a suivi la chute de la dictature avait sévèrement pénalisé cette activité qui avait quitté le pays.
Depuis 2004, des efforts sont entrepris pour tenter de développer le secteur de la sous-traitance dans le pays. «Des préférences commerciales ont été accordées à Haïti par les États-Unis dans ce secteur, dans le cadre de la loi HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement), entrée en vigueur en 2007 et modifiée en 2008 (loi HOPE II). Après le séisme de 2010, une nouvelle loi, baptisée HELP (Haiti Economic Lift Program), a prolongé jusqu’en 2020 puis en 2025 la loi HOPE II et augmenté les quotas d’importation, dans le but de favoriser la relance de l’économie après le tremblement de terre», rappelle André Calmont dans son article. Les lois HOPE et HELP, poursuit-il, ont donc incité les acheteurs américains à s’approvisionner en Haïti, malgré la concurrence dominicaine et chinoise. De ce fait, les exportations de vêtements vers les États-Unis connaissent donc une croissance rapide (486 millions de dollars en 2009 et 700 millions en 2012) ; près de 26 000 travailleurs sont employés dans le secteur du vêtement (2012) et, avec le développement des parcs industriels de Ouanaminthe et de Caracol, on estime que les effectifs dans cette filière devraient atteindre 50 000 en 2016. «Mais cette activité industrielle reste embryonnaire au regard des activités informelles qui représentent aujourd’hui l’essentiel de l’économie haïtienne», conclut-il.
D’après les données de l’Association des industries d’Haïti (ADIH), le nombre d’emplois dans le secteur textile est en baisse, passant de 53 091 en novembre 2022 à 43 280 en mai 2023.
DevHaiti