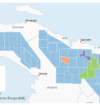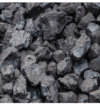Inclusion financière, sept ans plus tard, où en est-on en Haïti?

Le rapport Global Findex publié en 2015 avait révélé que seulement 11% de la population haïtienne avait accès aux différents produits des banques commerciales et de micro finance. Pour un état des lieux actualisé, le magazine DevHaïti a rencontré madame Yvrose Joseph qui est membre de la cellule chargée de l’inclusion financière à la Banque de la République d’Haïti (BRH). Voici une première partie de cette interview exclusive.
DH: En 2014, la BRH a soutenu le programme national d’inclusion financière. Où en est-on en 2021? Une topographie.
YJ: D’entrée de jeu, disons que la politique de lutte contre l’exclusion financière s’inscrit dans le prolongement des programmes de lutte contre la pauvreté encouragés par les décideurs politiques, les autorités de régulation monétaire et les institutions de développement. Dans ce cadre, la promotion de l’accès aux services et produits financiers formels se présente comme un facteur clé de progrès et un outil efficace de l’inclusion financière. Pour lever les principaux freins à l’inclusion financière des ménages et des entreprises, beau- coup de pays ont établi des Stratégies nationales d’inclusion financière.
En Haïti, quand la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF) a été lancée en 2015, les chiffres, issus de la base de données Global Findex de la Banque mondiale, révèlent que le niveau d’inclusion financière était de onze (11) %[1]. Soutenue par les efforts visant à améliorer la stabilité du secteur financier, à créer des emplois et à dynamiser le secteur privé, une grande partie de la population haïtienne a été incluse au cours de ces six (6) dernières années. Aujourd’hui, environ cinquante quatre pour cent (54) % de la population âgée de quinze ans et plus (15 et +) ont accès au système financier formel, selon les enquêtes FinScope, Haïti 2018. De ces 54 % d’inclues, environ onze (11) % ont un compte bancaire et vingt-six (26) % utilisent exclusivement d’autres mécanismes financiers formels.
Ce pic d’inclusion a été facilité grâce à des stratégies diverses développées par les différents opérateurs économiques et financiers tels que les banques commerciales, les Institutions de Microfinance, les Coopératives d’Epargne et de Crédit[2], les Sociétés Financières de Développement (SFD), les Maisons de Transfert, les Fournisseurs de Monnaie Mobile, les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), les Mutuelles de Solidarité (MUSO) etc. L’apport de certaines institutions internationales partenaires[3] impliquées dans la promotion de l’inclusion financière n’est pas à sous-estimer non plus.
S’il est vrai, qu’au regard de la loi existante, la réglementation relative à la conduite prudentielle dans le secteur financier incombe à la Banque de la République d’Haïti (BRH), il faudrait préciser, qu’elle ne supervise que les banques commerciales, les Sociétés Financières de Développement (SFD), les maisons de transferts et les Coopératives d’Epargne et de Crédit (CEC).
Avec le décret présidentiel, du 5 juin 2020, portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions de microfinance, publié au Journal Officiel[4], en date du 25 août 2020, la mission de la supervision bancaire de la BRH devra s’étendre aux institutions de microfinance non mutualistes. Ces dernières pourront agir soit, comme entreprise de microcrédit, soit, comme société de microfinance, en fonction de leur dotation en capital, à partir de l’été 2021.
Cet élargissement du cadre réglementaire, constitue un enjeu très important pour l’inclusion financière en Haïti, en supportant la concurrence et une diversification de l’offre de produits et services financiers de qualité dans le secteur financier. Une plus grande disponibilité et un accès aux produits et services financiers particulièrement au crédit, à l’assurance et à l’épargne, accompagnés de l’éducation financière, peuvent générer des impacts considérables sur la croissance avec des impacts sur l’efficacité de la politique monétaire et favoriser une plus grande stabilité financière au niveau du pays.
Cependant, pour maintenir la confiance dans le système financier, et permettre à l’inclusion financière de contribuer au renforcement de la stabilité financière, il faudra, à côté de cet approfondissement du système financier, continuer à œuvrer pour la mise en place d’un environnement favorable à la protection des consommateurs des produits et services financiers. De plus, la promotion de l’offre de produits et de services financiers doit s’adjoindre à des programmes d’éducation financière afin de mieux aider les inclus financiers à se protéger contre le surendettement, les perturbations financières et prendre les décisions optimales susceptibles d’améliorer effectivement leurs conditions de vie.
DH: À regarder les services et produits offerts par les banques commerciales ainsi que les coopératives, l’Unité d’Inclusion Financière est-elle satis- faite?
YJ: Le concept de l’Inclusion Financière, dans son essence, se réfère à la résolution d’une équation à trois dimensions touchant la disponibilité, l’accès et l’usage des produits et services financiers formels de qualité (crédit, épargne, assurance, transferts d’argent, paiements etc.) aux ménages et aux entre- prises afin de soutenir leur développement et de les prémunir contre les risques financiers[5].
Le développement des services de proximité pour l’amélioration de l’accès aux services financiers est l’un des cinq (5) piliers de la Stratégie nationale d’inclusion financière. Aujourd’hui, grâce aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), il est possible de desserrer les contraintes qui pèsent sur les services bancaires. A côté des produits et services financiers traditionnels, la monnaie mobile joue un rôle important dans la distribution de services financiers accessibles et de qualité à la population non bancarisée, en Haïti. En 2018, environ vingt-trois pour cent (23) % de la population âgées de quinze ans et plus (15 et+) se sont déclarés utilisateurs de «porte-monnaie mo- bile[6]».
Expérimenté, dans le pays, après le tremblement de terre de 2010, avec l’initiative Haïti Mobile Money (HMMI) du Consortium USAID et Bill & Melinda Gates, le nombre d’utilisateurs de la monnaie mobile est en augmentation constante. Pour l’un des produits électroniques considérés, le nombre de clients est passé de 383 000, en mars 2016, à plus de 900 000 utilisateurs, en juin 2020.
Les avancées réalisées, ces dernières années, ont permis de mettre en exergue le potentiel des fintech dans le développement de tout un éventail de services financiers reposant sur le numérique, dont l’octroi de prêts et les transferts monétaires. De nouveaux produits et services financiers, à partir de l’électronisation des paiements à travers les cartes dont la banque à distance, développés par certaines banques commerciales ont un impact considérable sur l’amélioration de l’inclusion financière en Haïti.
Aussi, dans les Coopératives d’Epargne et de Crédit, on observe une nouvelle tendance à prioriser les produits et services digitaux. Des expériences en cours telles que celles de Kès Pam Pi Prem, pour atteindre les couches les plus éloignées du milieu rural, constituent un bon exemple pour la mobilisation de l’épargne du secteur informel. Des expériences de ce genre comme celle de RENACA au Bénin s’inscrit dans cette logique. Un modèle sécurisé et fiable qui a su apporter des éléments de réponse à des problèmes de rétention d’épargne en changeant les habitudes de plus d’un. Il est à noter qu’une forte augmentation de la masse de l’épargne à partir de ces outils peut entraîner des implications positives sur la décision des autorités monétaires soit en matière de politique de crédit ou en termes de lutte contre l’inflation.
Malgré les mesures prises pour encourager les services financiers numériques, ils sont encore loin d’atteindre leur potentiel en Haïti. Environ 46 % des 7,67 millions des personnes âgées de 15 et plus sont toujours en attente d’être incluses formellement dans le système financier. Le monde rural reste largement exclu du système financier formel surtout quand on fait référence aux jeunes et aux femmes. Pour plus d’inclusion financière, il existe encore un énorme potentiel à réaliser au niveau de l’écosystème pour approfondir davantage l’inclusion financière et relier l’économie de proximité aux grandes plateformes et entreprises financières numériques dans un contexte mondial où les activités économiques sont fluidifiées par la technologie.
DH: Est-ce que le service Pronap fait partie de la stratégie d’inclusion financière?
YJ: Le renforcement des infrastructures financières et la mise en réseau constituent le cinquième pilier de la Stratégie nationale d’inclusion financière. Ce pilier supporte la mise en place de moyens de paie- ment alternatifs efficaces et sécurisés capables de faciliter le développement de nouvelles offres financières dans le pays. Aussi, il vise à garantir une plus grande utilisation des services et produits financiers numériques et une extension plus prononcée de la couverture géographique.
Aussi, la mise en marché de nouveaux services numériques paraît comme une alternative pour répondre à un certain nombre de risques liés à l’utilisation du cash. Une telle initiative met en place un cortège d’acteurs, incluant des fintechs, des opérateurs de téléphonie mobile et des institutions financières, visant tous à accélérer l’inclusion économique et financière.
La réglementation introduite par la BRH pour faciliter les Services Financiers Numériques a réussi à changer le paysage et le dialogue sur l’argent mobile et les paiements électroniques en Haïti Les opérations liées à la banque mobile sont actuellement réglementées par les lignes directrices, supportant le Bank-Led model. Dans une perspective d’inclusion financière en Haïti, l’enjeu d’interopérabilité se révèle important, permettant ainsi d’adresser le problème de traçabilité des transactions, de réduction d’un certain nombre de coûts financiers aussi bien pour les acteurs financiers que pour les clients.
Parmi les nombreuses interventions de la Banque de la République d’Haïti pour soutenir l’inclusion financière, l’établissement du Processeur National de Paiement (PRONAP), répond aux objectifs qui sont poursuivi dans le Document de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, visant bien à moderniser et maintenir l’efficacité du système de paiements en Haïti. En facilitant les transactions entre les banques, les CEC et les institutions de microfinance, le PRONAP est appelé à jouer un rôle prépondérant dans l’amélioration de l’inclusion financière dans le pays. A date, deux (2) Coopératives d’épargne et de Crédit et deux (2) banques commerciales ont déjà emboîté le pas.
Cependant, dans cette course vers l’interopérabilité, une plus grande formalité de l’informel, une réduction de la fracture numérique, la promotion de la concurrence financière soutenue par la réglementation et l’éducation financière ainsi que la protection des consommateurs sont autant de chantiers qui méritent d’être poursuivis. De plus, des efforts doivent être consentis par les acteurs concernés de façon à maîtriser les risques technologiques liés aux innovations financières qui pourraient entraver les retombées de l’interopérabilité et fragiliser la stabilité financière.
DH: Avez-vous déjà fait une évaluation mi-parcours de la stratégie? La stratégie nationale prend fin en quelle année?
YJ: Le Document de la Stratégie nationale d’inclusion financière confie le travail de suivi et l’évaluation des activités d’inclusion financière à un Groupe de Travail National sur l’inclusion financière[7]. Ce Groupe de Travail regroupe tous les acteurs concernés par l’objectif d’inclusion financière. La Stratégie nationale d’inclusion financière aussi bien que l’ensemble des documents liés à sa mise en œuvre prévoient des plans d’action annuels annexés à un cadre de suivi et d’évaluation. Le Document de la Stratégie nationale d’inclusion financière prévoit, en fonction des objectifs et des axes stratégiques préétablis, un ensemble de mesures ou d’étapes clés qui doivent être suivies en vue de l’opérationnalisation de la Stratégie. Ces mesures sont compilées dans des feuilles de route intégrant le Plan d’Action de la Stratégie qui se trouve au chapitre quatre (4), à la fin du Document.
L’évaluation constitue pour nous une composante essentielle de la crédibilité des démarches qui ont été adoptées pour contrecarrer l’exclusion financière constatée lors de l’élaboration de la Stratégie nationale d’inclusion financière. En termes de suivi, à partir des indicateurs d’offres et d’accès préalablement définis et ajustés régulière- ment en fonction des nouvelles réalités, des don- nées de base sur l’inclusion financière liées à l’offre[8] et à l’usage sont régulièrement collectées à l’Unité d’inclusion financière. La cartographie d’inclusion financière qui se trouve sur le site de la BRH, depuis 2018, fait partie des outils utilisés pour la diffusion de ces informations.
La réalisation des enquêtes nationales FinScope, Haïti en 2018, a été l’occasion, pour nous, d’évaluer le niveau d’inclusion financière en Haïti, après les 3 premières années du lancement de la Stratégie nationale d’inclusion financière. Les résultats nous ont permis de mesurer la progression de l’inclusion financière dans le pays, d’évaluer comment les six objectifs qui étaient fixés ainsi que les stratégies adoptées ont effectivement abouti aux résultats établis en 2015.
Les recommandations de ces enquêtes ont accéléré la mise en place de certaines réformes par rapport au système de paiement telles que la modernisation d’un certain nombre de coopératives d’Epargne et de Crédit en prévision d’une extension de l’offre de services financiers. Elles ont permis à 53% des interviewés de s’exprimer en faveur de l’élaboration d’un Plan National d’Education Financière (PNEF), levier important dans la protection des consommateurs des produits et services financiers, lancé en juin 2020. L’application des recommandations a aussi conduit à rendre fonctionnel le Comité de Coordination et de Suivi de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière[9].
Le Document de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière est un document qui se veut dynamique. Sa révision est en cours de manière à prendre en compte les acquis et en fonction de la nouvelle réalité ajuster la vision. A cet effet, un comité de pilotage est établi afin d’intégrer les attentes de tous et jumeler les intérêts en vue d’arriver à un docu- ment de consensus pour l’orientation de l’inclusion financière dans le pays pour les cinq (5) prochaines années.
DH: Quelles sont les perspectives?
YJ: Le niveau d’inclusion financière de 54%, permet de percevoir l’existence d’écarts importants entre les valeurs effectives des indicateurs de base d’inclusion financière pour Haïti et ceux d’autres pays de l’Amérique latine. Une augmentation de l’inclusion financière peut avoir des implications considérables sur l’efficacité de la politique mise en place par les autorités responsables de la politique monétaire, si les vieilles sont bien accordées dans le pays.
En Haïti, une part relativement importante des Micros, Petites et Moyennes entreprises (MPME) appartient au secteur informel. Les inclus sont beau- coup plus intéressés par les décisions de politique monétaire. Une contraction du secteur informel entraînerait d’énormes gains pour l’économie et stimulerait la demande de crédit.
Aussi, il est nécessaire de réduire les asymétries d’informations, à ce niveau, en mettant disponible des données statistiques et un cadre d’action et de réglementation spécifique liés à ce secteur de façon à favoriser le développement du financement des MPME par un recours accru aux créneaux financiers formels et aux nouvelles technologies. Des études quantitatives nationales connues comme le FinScope SME pourraient projeter une photographie réelle du secteur.
De plus, n’est-il pas grâce au développement et l’adoption des solutions numériques que la plupart des pays en Afrique ont un taux d’inclusion financière touchant les 80% ? Dans un pays comme le Kenya, le système de paiement mobile M-Pesa, notamment, à accélérer l’inclusion financière de près de 82,9 % de la population. Il en est de même pour le Rwanda, qui connaît un taux d’inclusion de 93 % , en 2020, grâce à la numérisation des services financiers..
L’ensemble des réflexions portant sur l’inclusion numérique, le plaidoyer sur l’amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes et la protection des consommateurs doivent se poursuivre. L’éducation financière au niveau des écoles primaires et secondaires est un élément important du Plan National d’Éducation Financière. La réalisation de cet objectif permettra d’atteindre les jeunes écoliers et universitaires et de mettre à leur disposition des outils méthodologiques susceptibles de faire augmenter leur niveau d’éducation financière et de les aider à travailler à leur autonomisation financière.
De manière à continuer à coordonner et de mieux soutenir les différentes initiatives numériques telles que la gourde digitale offrant un potentiel énorme pour l’avancement de l’inclusion financière, un cadre réglementaire plus souple soutenu par des partenariats entre les différents acteurs concernés est à encourager. Enfin, il est important de pouvoir compter sur le suivi et l’évaluation des stratégies existantes pour apprécier les progrès, ajuster les tirs et identifier des opportunités pour le développe- ment de nouveaux produits et services financiers ainsi que l’exploitation de nouvelles technologies capables d’accélérer l’inclusion financière en Haïti.
DevHaiti