Inflation 23,3 % : ça va mal pour les consommateurs
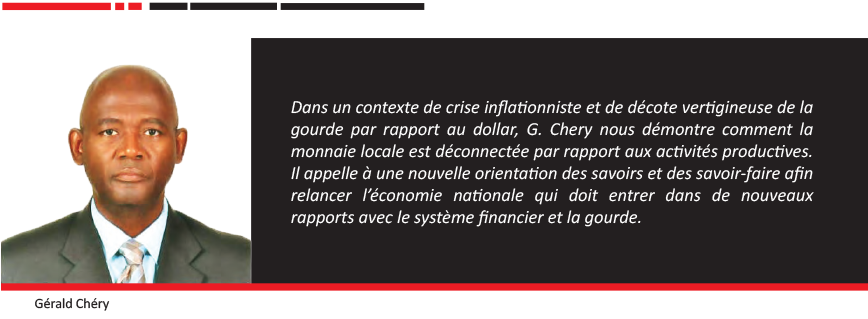
Dans sa publication intitulée le « Coin de l’IPC » du mois de mai, publié en juillet dernier, l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) a fait état d’une hausse de l’inflation de 2,3% en rythme mensuel et de 23,3% en glissement annuel. En effet, les prix des produits alimentaires et boissons non-alcoolisés ont augmenté de 2,5% sur un mois et de 27,1% sur un an. Quant aux articles d’habillement et de chaussure, ils ont connu une augmentation de 2,1% sur un mois et de 29,9% sur un an. Les meubles et les articles électroménagers, de leur côté, ont enregistré une hausse de 2,3% sur un mois et 20,1% sur un an.
En outre, les prix de soins de santé et des services de restauration ont crû respectivement de (4,2% sur un mois et 44,6 sur un an) et (2,5% sur un mois et 25,6 sur an). Toujours d’après ce rapport, l’alimentation, les articles d’habillement et chaussures, le logement, le gaz, l’électricité sont, entre autres, les produits qui sont les plus influencés. Cette augmentation de l’inflation qui s’explique principalement par la forte dépréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain et une hausse généralisée des prix, entraine une baisse du pouvoir d’achat des Haïtiens.
Cette poussée inflationniste résulte de la détérioration du taux de change, aux effets résiduels de la sécheresse de 2019 et au faible niveau de la production agricole.Elle s’explique également par les surcoûts financiers de l’acheminement des denrées alimentaires vers les centres urbains à cause des pénuries de carburant, des braquages des marchandises sur les routes, des pertes post-récoltes des produits périssables qui n’ont pu être évacué.Le panier alimentaire a lui aussi subi une hausse importante avec une augmentation de plus de 50% sur 12 mois.
Le cadre macroéconomique ne cesse de détériorer depuis les émeutes des 6 et 7 juillet 2018 provoquées par la décision irréfléchie de l’administration Moïse-Lafontant, visant à augmenter, avec démesure, les prix des produits pétroliers à la pompe. Ensuite, les différents épisodes de blocage du pays (février, juin, septembre et octobre 2019) ont empiré la situation.Cette détérioration du cadre macroéconomique engendre la dégradation des moyens d’existence des ménages, baisse des opportunités de travail notamment dans le secteur agricole, inflation, suspension voire perte des activités économiques, surendettement, exode rural, perte des productions agricoles non-évacuées vers les centres urbains…
Les plus grandes victimes de cette crise sont les plus vulnérables qui représentent plus de 4,6 millions de personnes vivant en situation d’insécurité alimentaire.
La croissance de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou taux d’inflation mesure la variation annuelle des activités économiques, surendettement, exode rural, perte des productions agricoles non-évacuées vers les centres urbains…
Les plus grandes victimes de cette crise sont les plus vulnérables qui représentent plus de 4,6 millions de personnes vivant en situation d’insécurité alimentaire. La croissance de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou taux d’inflation mesure la variation annuelle en pourcentage subi par les prix payés par le consommateur moyen pendant une période donnée pour ses achats de biens et services. Évidemment, la grille de prix des biens et services sur laquelle sont basés les calculs change avec le temps et les changements d’habitudes des consommateurs. Une croissance de l’IPC, sans croissance des revenus, conduit à une diminution du pouvoir d’achat. Inversement, une diminution de l’IPC ou son maintien, alors que les revenus sont à la hausse conduit à une augmentation du pouvoir d’achat des ménages.
Avant la covid-19, le système financier haïtien regroupait un nombre croissant de secteurs déficitaires qui exigeait des dépenses alors que leurs retombées sont négligeables ou insuffisants. L’État ne parvient pas à prélever les taxes sur les produits pétroliers; le financement de l’énergie électrique n’est pas assuré ; les projets de l’État sont exécutés de manière insatisfaisante. Le système éducatif n’est plus connecté au secteur productif. Le système politique est la cause d’incohérences et de dépenses. Ces zones affichant une gestion médiocre sont la cause de déficits structurels qui sont soldés en dernier ressort par le financement de la banque centrale. À ces zones de grande inefficacité s’ajoute l’effort requis par la pandémie qui exige des dépenses qui viennent aggraver une situation financière nationale qui est déjà chaotique.
Les dirigeants haïtiens sont obligés de dépenser lorsqu’il leur fallait réduire les engagements de l’État. La banque centrale renonce aux principes classiques de restriction du crédit bien que la monnaie nationale se déprécie petit à petit. Elle laisse filer le financement en attendant qu’un emprunt étranger aide Haïti à sortir de l’impasse. Il en résulte que les prix ne traduisent pas les coûts réels ni ne mesurent la rareté des biens. La gourde ne joue pas son rôle de monnaie de compte. Personne ne peut nier qu’une crise monétaire et financière s’installe en Haïti qui résulte des effets combinés d’une politique monétaire stérile et des dérapages des dépenses publiques.
Du côté de la monnaie, les mesures habituelles de relance n’ont pas abouti aux effets escomptés, ni permis de dépasser les contraintes durables du secteur réel, dont la difficulté des entreprises locales d’accéder à des services de qualité et aussi aux techniques de production efficaces. Les goulots d’étranglement perdurent en dépit des multiples tentatives de relance du crédit. Malgré ces zones d’inefficacité, les autorités monétaires ont opté pour des mesures modérées afin d’atténuer les contraintes à la circulation de l’argent que la pandémie aurait imposées aux entreprises et aux ménages. Elle a assoupli ses mesures lorsqu’une situation normale somme de les durcir. Par exemple, les taux directeurs sont maintenus à un niveau relativement bas, soit 10 %, 6 % et 4 % pour les maturités de 91, 28 et 7 jours. Les taux de réserves n’ont pas changé. Il est vrai que ces taux de réserves sont déjà assez élevés : 40 % sur les dépôts en gourdes et 51 % sur les dépôts en dollars.
D’autres déficits sont moins visibles mais exigent des agents économiques des dépenses qui donnent des résultats médiocres. Certains ménages changent leurs habitudes de consommation alimentaires.
D’autres évitent d’aller chez le médecin. La consommation baisse ainsi que le niveau des recettes fiscales. Les entreprises produisent moins et sont devenues moins efficaces. Les mesures de protection sociale sont la cause d’effets pervers. Elles engendrent l’opacité au lieu de contribuer à identifier les personnes qui en ont droit.
Ces tensions font baisser les recettes fiscales alors qu’elles poussent l’État à dépenser davantage. Il en résulte un creusement du déficit public couvert par la banque centrale qui s’élève à 34 037,02 millions de gourdes au 30 juin 2020. Entre juillet 2019 et juillet 2020, juillet 2018 et juillet 2019, la gourde s’est dépréciée de 28,3 % et de 34,9 % face au dollar. Dix ans plus tôt, un déficit qui dépassait les cinq milliards de gourdes était la cause d’un grand émoi. Les entreprises et les ménages espèrent aussi une réponse adéquate en rejetant les palliatifs qui font perpétuer la crise. La situation actuelle exige des corrections que les pouvoirs publics ne sauraient éviter.
Face à des rigidités qui sont de nature structurelle, les réponses ne viennent pas des seuls instruments monétaires et financiers. En général, s’ils disposent des moyens politiques et d’une réflexion pertinente, les pouvoirs publics cherchent à faire émerger de nouveaux acteurs économiques qui renouvellent les façons de produire, permettent de générer de nouvelles richesses et de financer les comptes sociaux.
L’opération revient à examiner les secteurs qui sont la cause des déficits chroniques face aux autres secteurs qui peuvent contribuer à renforcer le secteur productif et apporter de nouvelles recettes fiscales. Ici intervient l’aspect politique des changements des régimes monétaires, financiers et fiscaux minés par la crise. Derrière la crise se cachent des secteurs et des acteurs alimentant les déficits. Les acteurs déficitaires ne font pas qu’exiger des dépenses de l’État ; ils tendent aussi à entraver l’arrivée des solutions et aussi l’émergence des nouveaux acteurs qui peuvent aider à résoudre les déficits structuraux de l’économie. Les acteurs profitant du système retardent l’arrivée des acteurs porteurs de nouvelles possibilités de production et de financement.
Afin de sortir de l’impasse, les pouvoirs publics doivent se montrer capables de réaménager les jeux d’influence et de reconstituer des alliances dans le champ économique. Des mesures incitatives peuvent contribuer à ce premier résultat. Ensuite, les nouveaux acteurs et les nouveaux secteurs doivent offrir les possibilités de financement de la protection sociale en partant du secteur productif. Ces deux conditions suffisent pour engager des acteurs divers de toute la société autour de nouvelles formes d’utilisation de la monnaie nationale et de mobilisation du budget. Des réflexions pourraient être engagées à cet effet afin que la société haïtienne puisse sortir de l’impasse actuelle.
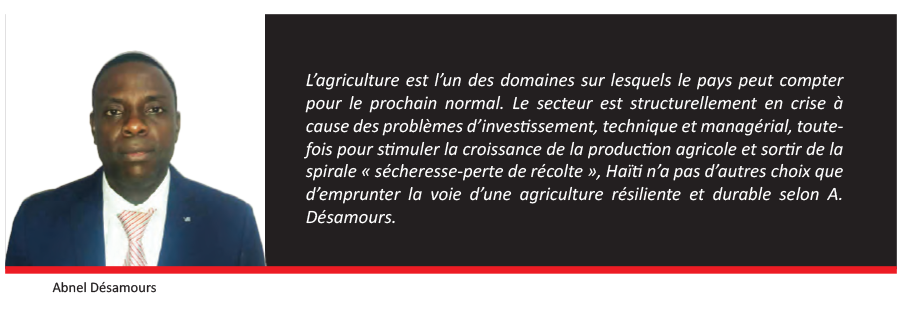
La situation du secteur agricole au cours de la période avril-juin 2020 est le résultat d’un cumul de chocs:
Deux années consécutives de sécheresse (Des pluies inférieures à la normale et irrégulières depuis la fin du mois de mars de cette année). Cette situation a compromis le cycle végétatif des cultures de la saison de printemps en particulier le haricot et le maïs. La plupart des régions productrices n’ont pas lancé la campagne de printemps cette année.
Des épisodes de « pays lock » de l’année 2019(avec ses conséquences sur la préparation de la campagne de printemps de cette année-là et la commercialisation des produits agricoles).
De profonds déséquilibres macroéconomiques se traduisant par la volatilité du taux de change et l’augmentation effrénée du coût des intrants.
La Covid-19 qui perturbe les chaines d’approvisionnement en intrants (engrais et pesticides) avec des impacts différenciés sur les cultures (faibles impacts sur les cultures vivrières peu intensives en engrais et pesticides et impacts plus significatifs sur la production du maïs et du haricot).
Ce cumul de chocs entrainerait une baisse de 20 à 30% de la production agricole par rapport à une année normale ou à l’année de référence (2009), selon FEWS-NET. Une prévision très optimiste, car le gouvernement a anticipé au mois d’avril, une baisse, dans son plan de réponse intitulé plan de réponse pour covid-19, de 12.3% par rapport à 2018-2019. Contrairement à l’année 2009, marquée par une hausse de la production agricole, la baisse de la production pourrait excéder 50% en 2020.
Pour stimuler la croissance de la production agricole et sortir de la spirale « sécheresse-perte de récolte », Haïti n’a pas d’autres choix que d’emprunter la voie d’une agriculture résiliente et durable, en visant à court et moyen terme l’autosuffisance alimentaire dans les filières racines /tubercules et maïs. Cette orientation stratégique appelle à tirer les leçons de la Covid-19 (Rupture des chaines d’approvisionnement : engrais et pesticides) et la mise en place d’un ensemble de politiques :
Des politiques de réhabilitation de l’environnement et d’aménagement du territoire (interaction entre l’agriculture et l’environnement/écosystèmes).
Des recherches agronomiques pour le développement des variétés résistantes aux changements climatiques, notamment à la sécheresse.
Des politiques d’assurance récolte (il faut aller plus loin que le Projet SYFAAH).
Des produits financiers adaptés au secteur agricole.
Gestion de l’eau.
Création de conditions pour une agriculture capitalistique (régime de la grande propriété/ développement des fermes agricoles).
Politiques commerciales adaptées au développement du secteur.
Développement de l’offre exportable (choix des produits, choix des marchés: agriculture biologique/versus agriculture de consommation de masse).
DevHaïti


