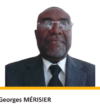La Réforme Bernard a-t-elle été un succès ?

Malgré quelques avancées dans l’intégration du créole à l’école, la Réforme Bernard n’a jamais été suivie telle que voulue par son concepteur. Elle prévoyait l’utilisation du créole comme langue de l’enseignement et l’introduction progressive du français oral en tant que langue seconde. Selon ce programme, les enfants doivent apprendre à lire exclusivement en créole en première année et commencer la lecture du français en 2ème année.
Les écoles n’ayant fait que la lecture en créole durant la première année sont rares. Beaucoup commencent avec le français et introduisent la lecture créole après, parfois assez tardivement, juste à temps pour préparer les enfants à l’examen d’État en créole. De plus, Il n’y a jamais eu en application une méthode systématique généralisée pour l’apprentissage du français oral, bien que certains manuels facilitant l’enseignement du français aient été produits par des maisons d’édition. Le ministère lui-même n’a pas renforcé son programme; il a financé les livres de lecture en français pour la première année bien qu’ils ne correspondent pas à son programme officiel.
Le drame pour la majorité des enfants haïtiens est qu’on leur donne des livres en français sans vraiment leur enseigner cette langue, et ils ont souvent en face d’eux des enseignants dont la maîtrise du français est approximative. Ajoutons aussi, que les jeunes de milieux traditionnellement francophones en Haïti deviennent de plus en plus anglophones et parlent moins le français. La pratique d’une langue véhicule aussi un contenu culturel. La culture américaine avec les nombreux haïtiens aux USA, les médias et la proximité des États-Unis d’Amérique font que les espaces culturels français en Haïti s’appauvrissent.
Le français fait partie de notre histoire et de notre culture, ce bagage bien géré est une richesse, mais malheureusement s’étant enraciné dans un contexte esclavagiste, notre rapport avec le français provoque des blocages psychologiques; la moindre faute de français est sanctionnée par la moquerie. N’ayant pas ce rapport avec l’anglais, nous – les Haïtiens – craignons moins de commettre des erreurs dans cette langue et en sommes moins conscients lorsque nous nous exprimons en anglais, laissant souvent l’impression qu’il est plus facile qu’il ne l’est en réalité. En anglais, être compris suffit.
Les résultats
De nos jours, même si le processus d’apprentissage est souvent trop laborieux avec les difficultés inhérentes à l’apprentissage de la lecture en langue étrangère et des ressources souvent insuffisantes pour payer des professeurs qualifiés, les enfants finissent tout de même par lire ce qui est à leur portée. Certaines personnes, surtout parmi les plus de 60 ans, peuvent recevoir des appels téléphoniques, mais, ne pouvant lire les chiffres, ne sont pas en mesure de composer un numéro. Grâce à la technologie qui met progressivement le monde de l’écrit, de la communication et de l’information à la portée de tous, ainsi qu’à la massification de l’éducation, ce niveau d’illettrisme est en voie de disparition. La communication par messages textes se généralise et se fait ordinairement en créole. Certains diraient que ce n’est pas de la grande littérature. Non, ça ne l’est pas, mais c’est mieux que d’avoir à recevoir par la radio les nouvelles de sa famille : «Dyesèl Janmari, fanmi w nan Jakmèl voye di w manman w mouri!»
Durant ma jeunesse, c’est ainsi que beaucoup de gens recevaient des nouvelles de leur famille de la province.
Nous pouvons dire que le créole est la langue principalement utilisée au niveau de la communication en Haïti, mais pas la langue de l’écrit. Comparative- ment au français, il y a très peu de livres écrits en créole. Même les jeunes qui ont été dans les très rares écoles qui priorisent l’enseignement en créole auront eu sous les yeux lorsqu’ils arrivent en secondaire plus de textes en français qu’en créole. Lorsque la lecture devient le divertissement préféré des jeunes, ils ne trouvent pas suffisamment de livres en créole pour entretenir leur avidité. Se procurer des livres d’occasion en français est plus facile. Le livre créole est finalement plus rare et plus cher. Le Dr Claude Calixte, professeur de philosophie et directeur de l’une des rares écoles en créole du pays, Livre Ouvert, m’a confié que l’une de ses meilleures élèves, d’un milieu très défavorisé, qui n’a aucune pratique du français à la maison et n’a probablement pas de télévision à sa portée, a développé une passion pour la lecture grâce aux livres d’occasion vendus par la CARE. Cette même élève choisit généralement de rédiger en français, alors que pour encourager les enfants à rédiger, les enseignants les laissent choisir la langue dans laquelle ils souhaitent s’affirmer comme auteur et se focalisent sur le contenu sans se préoccuper des fautes.
DevHaiti