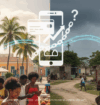Le paiement mobile, levier stratégique d’une réforme nationale du système de paiement

Dans un pays où le cash règne encore en maître, la montée du paiement mobile en Haïti apparaît comme une véritable révolution silencieuse. En à peine une décennie, l’économie nationale a vu naître une série d’initiatives, portées par la Banque de la République d’Haïti (BRH), les institutions bancaires et les opérateurs télécoms, visant à moderniser la manière dont les Haïtiens échangent, achètent, transfèrent et épargnent. Le portefeuille mobile, les cartes de paiement, les applications bancaires et désormais les plateformes interopérables comme le PRONAP (Processeur national de paiement) ou le SPIH (Système de Paiement Interbancaire Haïtien) ont profondément transformé le paysage financier national.
Mais ces avancées, si notables soient-elles, ne suffisent pas encore à ériger un système de paiement moderne, inclusif et totalement intégré à l’économie réelle. Les chiffres sont parlants : plus de 60 % des transactions continuent de s’effectuer en espèces, le secteur informel reste largement dominant, et une partie importante de la population demeure en marge des services financiers. Cette prédominance du numéraire limite non seulement la transparence et la sécurité des échanges, mais aussi la capacité de l’État à suivre, fiscaliser et dynamiser l’activité économique.
La BRH a, ces dernières années, accompli des pas significatifs vers la modernisation du système de paiement national. La réduction des délais de compensation bancaire, passée de cinq à deux jours grâce à la dématérialisation des chèques, témoigne d’une volonté ferme de rationaliser les flux financiers. L’introduction du SPIH/RTGS a, de son côté, permis d’accélérer les transferts interbancaires et d’améliorer la gestion de la liquidité au sein du système financier.
Le lancement du PRONAP a marqué une étape déterminante : pour la première fois, Haïti dispose d’une plateforme nationale capable d’assurer l’interopérabilité entre les différents acteurs financiers (banques, fintechs, coopératives, opérateurs de paiement) tout en garantissant la sécurité et la conformité des transactions. Ce socle technologique, combiné à la circulaire 121 de 2021 autorisant officiellement les fournisseurs de services de paiement (FSP), ouvre la voie à un véritable écosystème numérique de la finance.
Malgré ces progrès, plusieurs obstacles freinent encore la généralisation du paiement mobile. La fracture numérique reste l’un des plus structurants : faible couverture Internet dans les zones rurales, coût élevé des appareils intelligents, manque de compétences numériques et confiance limitée dans les outils digitaux. Ces contraintes, combinées à un environnement réglementaire encore perfectible, restreignent la portée des innovations.
De plus, l’interopérabilité entre les plateformes de paiement demeure partielle, et la faible bancarisation de la population empêche une adoption massive des solutions électroniques. À cela s’ajoute le défi de la cybersécurité, qui requiert des investissements soutenus pour garantir la protection des données et renforcer la confiance des usagers.
Pourtant, le potentiel du paiement mobile dépasse largement la simple commodité. Il constitue un outil stratégique de réforme économique et sociale. En fluidifiant les transactions, il peut réduire les coûts de transfert, améliorer la transparence fiscale et dynamiser les chaînes de valeur locales. Pour les femmes et les jeunes, souvent exclus du système bancaire traditionnel, il représente un tremplin vers l’autonomie économique.
De plus, l’introduction à venir du projet de monnaie digitale de la BRH (Bitkòb) ouvre des perspectives inédites d’intégration financière et de souveraineté monétaire. Ce projet, s’il est mené à terme avec rigueur et inclusivité, pourrait démocratiser encore davantage l’accès aux services financiers et accélérer la transition vers une économie « sans cash ».
Au-delà de la modernisation technique, la véritable réforme à venir est institutionnelle et culturelle. Elle suppose une coordination renforcée entre la BRH, le MEF, les institutions financières, les opérateurs privés et les collectivités locales pour faire du paiement digital un pilier de la transformation économique nationale.
La réforme du système de paiement haïtien, appuyée sur l’innovation numérique, ne se réduit pas à une question de technologie. Elle est une réforme de société, qui touche à la confiance, à la transparence, à la gouvernance économique et à la justice sociale. À ce titre, elle mérite d’être placée au cœur des politiques publiques de développement.
DevHaiti