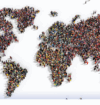Les flux de transferts de la diaspora insuffisants pour financer les MPMEs
Pierre Marie Boisson, économiste en chef de la Sogebank et Bénédique Paul, chercheur à l’université Quisqueya (UNIQ), ont animé le panel sur les transferts et le financement des MPME à la 12e édition du Sommet international de la Finance organisé par le Group Croissance de concert avec le Groupe ProFin et la Banque de la République d’Haïti (BRH). Plusieurs thématiques portant sur les liens entre les transferts sans contrepartie de la diaspora haïtienne et le développement des Micro Petites et Moyennes entreprises (MPME) ont été débattues.

Pierre Marie Boisson a d’abord présenté les résultats des recherches effectuées au sein de la Sogesol avec d’autres institutions de microfinance (IMF) en Amérique latine sur la viabilité d’utiliser les transferts comme source de financement des PME. Après 3 ans de recherche, révèle M. Boisson, il s’est rendu compte qu’il est illusoire de vouloir financer les MPME via les transferts dans des pays à revenu très faible comme Haïti. Selon le fondateur de la Sogesol, la clientèle bénéficiaire des transferts dans ces pays-là est différente de la clientèle entreprenante. En effet, comme en témoigne le cas haïtien, seulement 4% des transferts sont destinés aux MPME.
S’il est difficile de financer directement les MPME via les transferts de la diaspora, M. Boisson a pour- tant illustré un processus à partir duquel les transferts servent au financement des MPME et de l’économie. En effet, les transferts majoritairement effectués vers Haïti sont destinés à la consommation chez des MPME, faisant partie de la clientèle du système bancaire. Une fois l’argent atterri dans le système bancaire, il renchérit les ressources prêtables des banques qui peuvent à leur tour financer les MPME.
Si l’équation paraît simple, dans le cas de l’économie haïtienne, qui est faible et très volatile d’un point de vue monétaire, le processus n’est pas si linéaire. En effet, l’économie étant composée d’agents rationnels, face aux risques auxquels fait face le pays, M. Boisson a évoqué les raisons à la base de la faiblesse au niveau de l’offre et de la demande du crédit en monnaie forte (dollar). En ce sens, ce processus, après avoir renchéri les ressources prêtables du système bancaire, peut amener finalement à une situation de surliquidité plutôt qu’à l’octroi de crédits. M. Boisson a souligné que c’est pourquoi la plus grosse partie des dépôts en dollars des banques commerciales se situent à l’étranger à part celles investies dans les réserves obligatoires. Si les transferts s’accroissent depuis ces vingt dernières années dans l’économie haïtienne, cela n’aide pas trop l’octroi de crédit à cause des problèmes structurels de l’économie.
Grâce au caractère non simultané des flux dépôts et des retraits, dans le cas où les transferts passent par l’intermédiaire du système bancaire, et la loi des grands nombres (plusieurs haïtien en reçoivent), ces flux financent une bonne partie des ressources prêtables des banques. Celles-ci à leur tour ont pu quand même financer quelques MPME. Toutefois, selon lui, il est difficile de penser à contraindre, inciter ou convaincre les bénéficiaires des transferts d’épargner leur argent pour ensuite financer les MPME.

De son côté, Bénédique Paul a eu un argument un peu plus optimiste quoiqu’il reconnaisse les limites du processus de transfert et de financement des MPME. M. Paul a en effet soutenu que les entre- prises susceptibles de provoquer un effet d’entraînement ne sont pas celles agissant comme des intermédiaires de transferts. S’il est vrai qu’aujourd’hui les banques sont devenues des intermédiaires, la majorité des transferts transitent vers des entreprises qui les remettent en cash. Il a aussi indiqué que c’est le migrant ou le bénéficiaire qui prend les initiatives du transfert. Ce dernier le fait généralement à des fins de consommation alimentaire, sanitaire ou éducative. Dans ces situations, il est difficile que les transferts soient épargnés ou investis dans l’économie haïtienne.
Sur la base de recherches effectuées, Bénédique Paul a avancé que la production constitue la principale porte d’entrée des transferts dans le financement des MPME ou de l’économie. Il a pris l’exemple concret de l’agriculture pour illustrer son argument. Selon lui, bien qu’il soit difficile de constater des cas où les transferts financent directement l’agriculture, ces cas existent et fournissent des opportunités de réflexion pour les décideurs. Il a présenté les résultats d’une étude qu’il a réalisée en 2020/2021 sur un échantillon de 1393 ménages agricoles dont 35.8% utilisent les transferts pour investir dans leurs fermes. M. Paul a souligné que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui sont les principaux bailleurs de fonds de l’agriculture dans le pays, les risques qu’ils prennent sont à considérer.
Répondant aux questions de l’économiste Joseph Harold Pierre sur le rôle du système bancaire dans le financement des MPME dans le pays, M. Boisson a soutenu que le système bancaire/financier tant bien que mal finance les MPME. Il a donné l’exemple particulier de la Sogesol dont 23% de son portefeuille est dans l’agriculture marchande. M. Paul, de son côté, pense que davantage d’efforts doivent être faits et qu’il y a des opportunités pour le système bancaire dans l’agriculture (PME).
M. Paul a aussi soutenu l’idée que la BRH devrait être l’institution haïtienne la plus crédible pour convaincre la diaspora haïtienne d’investir dans le pays. Il existe cependant, selon lui, des points creux qui ne parlent pas en faveur de la BRH. La question du $ 1.50 en est le principal. En somme, les panélistes ont tous les deux reconnus que les transferts actuels financent indirectement les MPME en Haïti. Ils avancent que des efforts pour minimiser les obstacles structurels de l’économie et pour diminuer la volatilité de la gourde sont nécessaires pour avancer dans un nouveau sentier où les transferts peuvent davantage financer les MPME.
DevHaiti