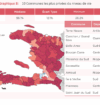Les incidences de deux siècles d’instabilité sur le développement en Haïti

Qui n’a jamais lu ou entendu dans la presse internationale cette expression « pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental » utilisée à tour de bras pour désigner Haïti, deuxième pays indépendant du continent américain après les États-Unis d’Amérique ? Comment expliquer cette pauvreté chronique et séculaire qui sévit depuis toujours en Haïti, pour laquelle semble-t-il les solutions pour y remédier sont encore hors de portée?
S’il est un fait avéré que les catastrophes naturelles, depuis la proclamation de l’indépendance, n’ont pas fait de cadeau à l’économie de la première nation noire indépendante du monde, entravant sérieusement tout processus de développement sur le long terme, l’instabilité politique quasi permanente, résultant des agissements et comportements cupides de nos hommes politiques, a largement contribué aussi à assombrir le tableau de nos malheurs de peuple voué à une existence de pauvreté et de misère.
Témoin et aussi acteur de nos turpitudes depuis plus d’un demi-siècle, l’ancien commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, également ancien président provisoire, Prosper Avril, a récemment signé un ouvrage très instructif «L’Histoire des Transitions Politiques en Haïti (1806-2020)» qui permet d’évaluer, sans concession, les effets des comportements de nos hommes politiques en regard à la stabilité du pays. Des comportements qui constituent un handicap sérieux au développement économique et social du pays.
« La classe politique haïtienne semble ne pas se rendre compte qu’il est impossible de faire avancer un pays sans stabilité politique, sans le strict respect des règles qui gouvernent le fonctionnement des sociétés et qui doivent être respectées par tous et par chacun », déclare, d’entrée de jeu, Prosper Avril qui, avec minutie, a entrepris de documenter l’instabilité politique chronique existant en Haïti depuis le drame du Pont-Rouge.
L’auteur dresse le constat des nombreuses anomalies ayant engendré cette situation politique instable de notre pays tout au long de son histoire à savoir, entre autres, les renversements intempestifs de gouvernements légitimes (26 renversés sur 39), le non respect des mandats des élus, la pléiade des conseils et chefs d’État provisoires (32 au total), les manipulations constitutionnelles […], les révolutions, insurrections ou révoltes sporadiques…
La première fois dans l’histoire d’Haïti qu’un président élu avait passé le maillet directement à son successeur, c’était le 15 mai 1922, lorsque le président Sudre Dartiguenave, à la fin de son mandat, transmettait le pouvoir à son remplaçant, le président Louis Borno.
« Cet événement survient plus d’un siècle après la proclamation de l’Indépendance et au moment de la présence en Haïti des forces américaines d’Occupation », souligne l’ancien général qui, avec la publication de cet ouvrage, se penche sur le phénomène historique particulier des gouvernements provisoires ayant profondément marqué la vie nationale.
Au cours de notre histoire, poursuit l’auteur, les acteurs politiques sur scène, obnubilés par le désir de renverser ceux qui ont détenu les rênes du pouvoir, se sont souciés très rarement du vide créé après la chute du chef d’État qu’ils ont forcé à partir. Et ce qui est pire, dans la plupart des cas, vainqueurs du moment, ils ont utilisé ces périodes de transition pour effectuer des remaniements dans la Constitution du pays, en y intégrant leurs propres idées […] La création de ce vide permettant de se livrer à ces genres d’exercice s’apparente à une maladie dont souffre la classe politique haïtienne: le syndrome du provisoire.
Afin de faciliter la compréhension du lectorat, les cinq catégories de situation suivantes sont passées au peigne fin par le général Avril : celle des chefs d’État munis d’un mandat qui n’ont pas été renversés au pouvoir ; celle des chefs d’État munis d’un mandat mais qui n’ont pas terminé leurs termes, sous la contrainte ; celle où le pays est gouverné par des chefs d’État provisoires ; celle où le pays est gouverné par des conseils provisoires et celle, enfin, des périodes d’absence de gouvernance. Ces cinq situations résument l’occupation de l’espace politique par les Haïtiens relativement à la gestion des affaires de la République.
De l’Indépendance à nos jours, treize (13) chefs d’État ont pu, malgré, parfois, moult occasions d’être renversés, accomplir leurs termes ou ont quitté le pouvoir de leur propre volonté ou par le décès, de mort naturelle. En d’autres termes, seulement treize (13) chefs d’État, après 216 années d’existence de notre Nation, ayant occupé la fonction présidentielle, munis d’un mandat, n’ont pas été renversés ou obligés de quitter le pouvoir par la contrainte.
Si l’on doit considérer le fait que six (6) d’entre eux sont décédés de mort naturelle au cours de l’exer- cice du pouvoir, on peut affirmer que, depuis 1804, seulement sept (7) chefs d’État ayant occupé en toute légitimité la fonction présidentielle n’ont pas été chassés du pouvoir et sont rentrés chez eux après avoir quitté le palais national. Il s’agit de Nissage Saget, Sudre Dartiguenave, Louis Borno, Eugène Roy, Sténio Vincent, René Préval et Michel Martelly.
L’auteur analyse ensuite comment vingt-six (26) citoyens, assumant en toute légitimité la fonction de président de la République, ont été obligés ou contraints d’abandonner le pouvoir avant l’expiration de leurs mandats. Cinq (5) d’entre eux ont eu une mort violente: Dessalines, Christophe, Salnave, Leconte et Guillaume. Pas un seul de ces chefs d’État renversés du pouvoir n’a été l’objet d’une quelconque procédure de destitution, en application de règles constitutionnelles ou légales. Ils ont tous été évincés en marge des normes établies, certains, éliminés physiquement.
Des quinze (15) chefs d’État provisoires inventoriés, à part ceux qui ont transformé leur présence provisoire en position définitive, seuls trois (3) d’entre eux ont réussi à passer le pouvoir à un président constitutionnel, ce, au-delà du délai prescrit pour le faire : Ertha Trouillot au président Jean-Bertrand Aristide, après onze (11) mois, Boniface Alexandre au président René Préval, après vingt-six (26) mois et Jocelerme Privert au président Jovenel Moise, après douze (12) mois.
De ce qui précède, il n’est nul besoin de déployer de grands efforts pour démontrer le poids des effets néfastes de nos insurrections ou soulèvements à répétition sur la stabilité politique si nécessaire au développement du pays, l’impact négatif des remous suscités à chaque changement de gouvernement.
Un autre exemple éloquent, si besoin en était : Haïti a fait l’expérience de périodes d’absence de gouvernance vingt-deux (22) fois déjà au cours de son histoire. En effet, l’auteur a entrepris d’énumérer ces cas où aucun citoyen ni aucune entité n’avait assumé formellement par une proclamation au autre acte officiel, la responsabilité du pouvoir politique en Haïti. Ainsi, en vingt-deux (22) occasions au cours de notre histoire, la République d’Haïti a été exposée pendant un total de neuf cent trente-huit (938) jours à l’incertitude du lendemain. Neuf cent trente-huit (938) longs jours sans qu’aucun chef ne préside la destinée de la nation !
Et, ce cas de figure ne représente que la pointe de l’iceberg en matière d’instabilité politique au cours des deux siècles de notre histoire de peuple et qui est si bien conté ce livre lire absolument: « L’histoire des Transitions Politiques en Haïti (1806-2020) » de Prosper Avril.

DevHaiti