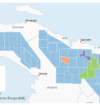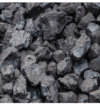Pour mitiger la crise migratoire des Haïtiens, il faut un régime d’accumulation basé sur l’homme

Entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2021, la question migratoire occupe l’opinion publique en Haïti et dans plusieurs pays de l’Amérique latine. En effet, des milliers d’haïtiens et de citoyens de certains pays de l’Amérique centrale (Honduras, Guatemala) ont dû parcourir une dizaine de pays dans l’objectif de se rendre aux Etats-Unis en entrant par l’Etat du Texas. Bon nombre d’entre eux ont été refoulés sur leurs territoires d’origine, souvent suite à des traitements rappelant l’époque coloniale. Les migrants haïtiens viennent pour la plupart des pays tels que le Brésil et le Chili. La majorité a quitté Haïti pour des raisons économiques, sociopolitiques et environnementales. Des causes qui sont liées aux différentes trappes auxquelles la société haïtienne fait face depuis très longtemps. Comment apporter des solutions compréhensibles et durables susceptibles de mitiger la crise migratoire des haïtiens? Quelle vision d’accumulation doit adopter la société haïtienne afin de faire de la migration non une nécessité mais un choix?
Un pays traditionnellement répulsif envers ses enfants
En Haïti, les premières migrations datent de la péri- ode révolutionnaire et de celle qui a suivi l’indépen- dance, c’est-à-dire de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. À l’époque, une composante spécifique de la population, l’élite sociale et économique, a émigré en France, au Canada et, dans une moindre mesure, aux États-Unis (Cesar, 2007; Stepick, 1998). Ce mouvement d’émigration a continué jusqu’au début du XXe siècle, y compris parmi les catégories sociales inférieures: beaucoup d’Haïtiens ont émigré à Cuba, pour y trouver du travail dans l’agriculture.
Par la suite, le flux migratoire s’est réorienté en direction de la République dominicaine, quand Haïti et son voisin ont été occupés en même temps par les Marines. De nombreux Haïtiens qui, dans d’autres circonstances, seraient allés chercher du travail à Cuba dans l’agriculture, ont émigré en République dominicaine où ils ont trouvé un emploi, principalement dans les plantations de canne à sucre. Dans les années 30, au nom d’une politique de blanchissement de la population (eclara la raza), Cuba et la République dominicaine ont expulsé ces migrants. En République dominicaine, lors d’un épisode tristement célèbre appelé «El Corte» (littéralement «la coupe») par les Dominicains, et Kouto-a (le couteau) par les Haïtiens – 17 000 à 30 000 Haïtiens, selon les estimations, ont été massacrés sur l’ordre direct du président-dictateur Rafael Trujillo, en vue de débarrasser le pays des migrants haïtiens (Derby et Turits, 2005; Martin, Midgley et Teitelbaum, 2002). Malgré ces violences, les Haïtiens n’ont pas cessé d’émigrer en République dominicaine, pour y trouver du travail.
Une économie en crise structurelle et conjoncturelle
Le contexte socioéconomique d’Haïti est très mauvais si nous considérons les deux dernières décennies. L’économie du pays connait des taux de croissance très faibles, avec des scénarios négatifs pour les trois derniers exercices fiscaux. En effet, Haïti n’a pas connu de croissance depuis 2018 (1.5%), l’économie s’est contractée en 2019 (-1.5%) et en 2020 (-3.6%) pendant que toutes les prévisions pour 2021 tablent sur une nouvelle contraction économique. Le pays, déjà pauvre, s’appauvrit. Les résultats médiocres en termes de croissance économique se conjuguent avec des taux d’inflation élevés (25.2% en glissement annuel pour le mois de septembre 2021) et une décote de la gourde qui contribuent à l’appauvrissement des ménages.
Haïti dispose du niveau de pauvreté (60% de la population), de l’extrême pauvreté (25%) et d’un niveau d’inégalités sociales les plus élevés de la région Amérique latine Caraïbe. Le pays devient de jour en jour plus répulsif avec la montée de l’insécurité et la répétition des catastrophes naturelles. Avec la mort du président Jovenel Moïse, les citoyens n’ont plus aucune confiance dans la capacité de l’Etat haïtien pour les protéger et assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Ces quelques faits sont des raisons qui rendent indigne l’haïtien ou l’haïtienne, les poussant à quitter le pays, peu importe la destination.
Une définition du régime d’accumulation
Dans la littérature économique, le concept d’accumulation se réfère à un processus consistant à ajouter du capital productif à celui déjà investi. Les régimes d’accumulation (pour son sigle ASS en anglais) sont ancrés dans des formes institutionnelles en évolution, notamment les relations capital-travail, les formes de concurrence, les institutions financières, les formes d’État et les relations internationales.
Selon les théoriciens de l’école de la régulation, chaque type de capitalisme est caractérisé par un mode d’accumulation spécifique. Ce mode comprend la structure productive du pays: ce que le pays produit, comment il le produit, et la manière dont il le redistribue entre les profits et les salaires. En premier lieu, un pays peut orienter son économie fondamentalement vers les produits manufacturés ou les marchandises. Ensuite, il y a la manière dont ces produits sont effectivement produits et la façon dont les bénéfices de la production sont répartis entre les différents secteurs de la société.
Le processus d’accumulation met en relation plusieurs parties prenantes (stakeholders) qui se spécialisent dans des niveaux spécifiques de la chaine de création de valeur. Toutefois, en faisant la politique de certains processus d’accumulation, il y a des acteurs qui créent et d’autres qui extraient. Cela est d’autant plus dangereux quand il existe un biais de performativité qui fait croire que les extracteurs sont les créateurs. Une telle situation, selon l’économiste Italo-britannique, Marianna Mazuccatto, peut emmener une société dans une trappe d’inefficacité et de non progrès social.
Comment est caractérisé le régime d’accumulation en Haïti ?
Le régime d’accumulation en Haïti est par essence sous-optimal et anti-progrès social. Il est caractérisé par des rapports de production entre groupes faiseurs et extracteurs. En effet, en parcourant l’histoire du pays, nous pouvons voir que toute la dynamique économique s’est développée suivant un jeu à somme négative, ou certains perdent (les paysans qui produisent le café par exemple) et certains gagnent (les gouvernements haïtiens, les spéculateurs, la France et les USA). C’est un régime fait d’exploitation et d’exclusion sociale ou légale. Les partis gagnants, particulièrement l’Etat haïtien (ses politiciens et fonctionnaires), n’ont pratiquement rien entrepris de compréhensif et de consistent pour intégrer légalement et socialement les perdants. Toutes les valeurs naturelles et humaines sont des valeurs mortes (dead capital), car elles évoluent à l’extérieur du monde légal susceptible de les rendre fongibles et productives.
De manière moins condensée, nous pouvons caractériser le régime d’accumulation en Haïti par une forte concentration de la propriété, de la richesse et des revenus; de fortes tendances à la financiarisation; une intégration désavantageuse dans l’économie mondiale; une grande hétérogénéité structurelle; une tendance marquée à la primarisation, à l’extractivisme et à la faible diversification de la production; un pouvoir de marché élevé des entreprises et une propension à l’oligopolisation; la persistance de pratiques rentières et de concentration; un chevauchement important entre le pouvoir politique et le pouvoir économique ; une fiscalité faible et inadéquate, avec de nombreuses composantes régressives; des réglementations environnementales laxistes; une protection sociale inadéquate, fragmentée et hiérarchisée et enclins à la marchandisation et au résidualisme.
Un tel type de régime ne peut garantir de l’efficience économique et le bien-être à court terme ou à long terme pour les Haïtiens. Il est désormais urgent de penser à des stratégies et des politiques publiques susceptibles de modifier en profondeur ce régime pour mettre le pays sur un nouveau sentier de progrès économique et social. Il faut un régime capable d’offrir des opportunités aux citoyens et aux citoyennes du pays afin que l’immigration soit pour eux un choix mais non une nécessité.
L’intégration de l’haïtien et de l’haïtienne comme clé de prospérité
Le changement systémique nécessaire pour mettre le pays sur un nouveau sentier de progrès doit prendre en compte l’intégration socioéconomique de l’homme ou de la femme haïtienne comme priorité. Ce sont les principales valeurs de l’économie et de la société haïtienne et sans la prise en compte, la promotion de leurs capacités, aucune dynamique ou jeu de prospérité n’est possible dans le pays. Il faut investir dans l’humain et dans ses activités.
Le pays est majoritairement informel, les capitaux physiques et humains sont morts car il n’y a pas un système légal flexible, ouvert et efficace visant à les rendre fongibles et productifs. L’économiste péruvien, Hernando de Soto, a travaillé au niveau des provinces et de l’économie informelle en Haïti. Il a fait des constats très pertinents pouvant servir de guide à nos stratégies ou politiques publiques pour une revalorisation des capacités du pays. Il a constaté que les biens immobiliers ruraux et urbains sans titre valent ensemble quelque 5,2 milliards de dollars US (en 1995). Pour replacer cette somme dans son contexte, elle représentait quatre fois le total des actifs de toutes les sociétés opérant légalement en Haïti, neuf fois la valeur de tous les actifs détenus par le gouvernement et 158 fois la valeur de tous les investissements directs étrangers dans l’histoire enregistrée d’Haïti jusqu’en 1995.
En d’autres termes, il est urgent d’accorder des droits de propriété aux pauvres et aux plus pauvres pour libérer l’énergie capitaliste de leurs biens (assets). Cette action légale doit être nécessairement accompagnée par des investissements dans des infrastructures de base dans un souci de productivité et de compétitivité. Retenir les haïtiens dans leurs terres requiert un business model conscient de la nécessité de l’intégration légale et socioéconomique de l’homme et de la femme haïtienne et capable de transformer l’espace haïtien en une terre d’opportunités. Sans cet investissement légal et humain, l’économie restera dans une situation structurelle de sous-optimalité et d’absence de bien-être créant un territoire haïtien répulsif envers ses fils et ses filles.
Nous finissons avec cette célèbre citation de l’économiste américain Lant Prichett « There a no poor people, there are people living in poor places. »

DevHaiti