Pour une vraie Négociation Commerciale avec la République Dominicaine
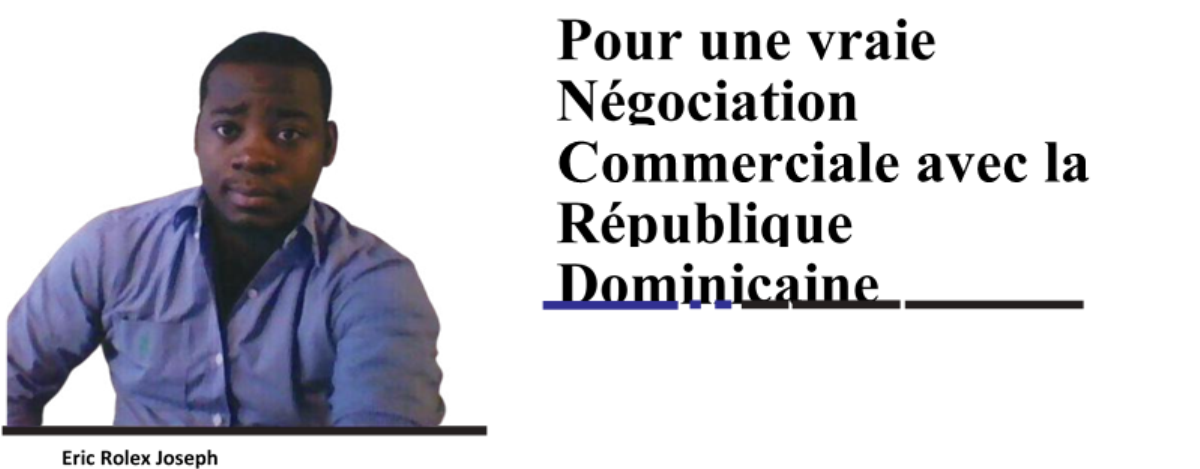
Eric Rolex Joseph est détenteur d’un Master en Politiques publiques de l’University of Kentucky (USA). Fulbright Scholar, Il est Professeur d’Économie Internationale et d’Économie du Développement dans plusieurs centres Universitaires à Port- au-Prince
Cela fait quelques années que les relations commerciales Haitiano-Dominicaines préoccupent les analystes tant en Haïti qu’en République Dominicaine.
Ces relations déséquilibrées, sont de plus en plus intenables et les deux pays doivent trouver un accord.
A chaque nouveau gouvernement, les analystes, les intellectuels et les observateurs des deux côtés de l’île appellent à un rééquilibre des rapports. Tout le monde comprend qu’il faut une meilleure coopération entre les deux pays sur plusieurs points, particulièrement sur les relations commerciales. Même le nouveau président dominicain élu pense qu’il faut revoir les relations entre les deux peuples à ce niveau.
Historiquement, les relations entre les deux peuples ont toujours été tumultueuses. Bourrées de méfiances d’un côté et de mépris de l’autre, la majorité des décisions commerciales sont prises en dehors de toute consultation sérieuse et sans trop grandes considérations de leurs impacts parfois négatifs sur les deux peuples.
Les rapports commerciaux entre les deux pays ne sont pas aussi anciens qu’on aurait pu le croire. Si on devait vraiment situer le début des relations commerciales formelles entre les deux peuples, on pourrait remonter à 1987 . Les échanges se font en grande partie dans les différents points de passage terrestres (officiels ou non).
Avant 1987, entre 1937 et 1986, les points de passage officiels étaient fermés. Les échanges entre les deux pays n’existaient quasiment pas à l’exception de l’importation des dominicains de la main d’œuvre haïtienne avec la permission du gouvernement haïtien.
D’ailleurs, ce n’est qu’en 1929 qu’un premier traité de démarcation des lignes frontalières a été signé lors de l’occupation des deux pays par les américains. Ce traité fut modifié en 1936 et a contribué à l’ouverture des différents points de passage officiels que nous avons actuellement.
Les échanges commerciaux ont toujours suivi les volatilités politiques des deux pays. Même après la signature de l’accord de 1987 pour l’ouverture des frontières les échanges entre les deux pays n’ont pas beaucoup progressé. Ce n’est que pendant la période de l’embargo de 1991, sous prétexte de contenir la masse des immigrants haïtiens en Haïti, que les Dominicains, ignorant les protestations de l’OEA , ont vraiment commencé à nous bombarder de leurs produits. Malgré tout, au début des années 2000, par exemple en 2001, il n’y avait qu’un faible déficit commercial – moins de 100 millions de dollars en faveur de la République Dominicaine .
Les 12 années qui ont suivi ont vu une augmentation substantielle des importations haïtiennes « passant de 208 millions de dollars en 2002 à plus de 1 milliard de dollars en 2013 -, sans une trop grande augmentation des exportations. En 2015, la République Dominicaine a officiellement exporté environ 1 milliard de dollars de Cependant, avec la venue du gouvernement Martelly, les relations commerciales des deux pays entrent dans une autre ère. Le gouvernement interdisait l’importation par voie terrestre de 23 produits dominicains. Les exportations dominicaines vers Haïti ont chuté, pour atteindre 853 millions de dollars en 2017 alors que les exportations d’Haïti ont totalisé 42 millions. Plus près de nous, entre Janvier et Mars 2020, les dominicains ont déjà exportés pour plus de 206 millions de dollars vers Haïti selon le CEIRD .
Pourtant, plusieurs gouvernements ont tenté d’apporter des éléments de solution à ce déséquilibre. Avec l’élection de Luis Abinader en République dominicaine, la question refait surface. Certains analystes indépendants dont des experts internationaux, des chercheurs locaux réfléchissent sur la meilleure solution. La majeure partie de la classe intellectuelle qui réfléchit à ce problème pense qu’une harmonisation des relations et des priorités entre les deux économies seraient profitables pour les deux peuples. Cependant, deux grands courants de pensée traversent les écrits et les discours:
a) Les Élites politiques et économiques dominicaines veulent un accord commercial avec Haïti afin d’assurer leur accès à ce marché.
b) Les analystes haïtiens, la classe intellectuelle et plusieurs politiciens se penchent beaucoup plus sur le renforcement de la production nationale haïtienne pour réduire drastiquement les importations provenant de la république voisine. Ce qu’il faut noter c’est que ces deux solutions peuvent paraitre mutuellement exclusives sur la forme, pourtant sur le fond, elles sont logiques et cohérentes.
Les Haïtiens veulent renforcer la production nationale et réduire la dépendance externe. Un accord élargi avec la République Dominicaine pourrait aider grandement en ce sens. Une stratégie « Win Win » pour les deux pays serait pour Haïti un moyen d’attirer des investissements directs étrangers, principalement des grandes firmes dominicaines (Büthe, T. and Milner, H.V (2008)).
Un tel accord permettrait d’augmenter la production nationale, tout en assurant un bon rendement aux capitaux dominicains, un marché beaucoup plus large, stable et rentable. Les secteurs du Tourisme, de la Finance et de la Formation Supérieure sont des domaines clés ou une synergie entre les deux pays feraient l’affaire des deux peuples. Par exemple, l’accès au marché Haïtien des banques dominicaines peut aider à mobiliser les capitaux importants pour la réalisation de gros investissements (Büthe, T. and Milner, H.V. (2008)) dans les secteurs touristiques, routiers, miniers et/ou agricoles. La télécommunication est aussi un secteur qui pourrait intéresser leurs investissements par rapport à la taille de notre marché.
Une approche à éviter à tout prix est celle consistant à prendre des décisions unilatérales comme bannir certains produits en provenance de la République
Dominicaine ou en imposant des tarifs sans pour autant assurer un approvisionnement local suffisant comme ce fut le cas récemment en Octobre 2015 puis en Janvier 2018 . Un tel choix, sans une vraie politique nationale de renforcement de la compétitivité des produits locaux (disponibilité et un bon prix), pénalise le consommateur final, à savoir le peuple haïtien. Ces décisions non seulement les poussent à payer à un prix fort des produits et services de mauvaises qualités, mais aussi de voir les importateurs faire leur beurre sur leur dos. Par exemple, en interdisant l’entrée sur le sol haïtien par voie terrestre de 23 produits , l’État a favorisé directement les gros importateurs tout en pénalisant les paysans ou détaillants des villes de province qui, eux, auraient pu acheter directement chez les dominicains.
Une telle décision ne saurait en aucun cas réduire de manière considérable les manques à gagner au niveau des taxes et sauver la production comme annoncée. L’une des conséquences de ces mesures est qu’aujourd’hui, nous avons des importateurs en situation de monopole qui fixent comme bon leur semble le prix de tous les produits, sans avoir à s’inquiéter de la compétition des petits marchands au niveau des frontières. L’objectif de toute bonne politique publique devrait être en faveur de la société, et du plus grand nombre. Peu importe ce qu’on vous dit, les tarifs sont des taxes.
Plusieurs études sérieuses sur la question ont démontré que les échanges commerciaux produisent des gains qui aident à la croissance lorsque les pays s’assurent de protéger de manière intelligente les industries sensibles. Au final, nous ne devons donc pas craindre un bon accord avec la république voisine. Surtout avec ce fossé économique énorme qui sépare les deux pays, nous devons trouver la bonne formule qui permettra de profiter des avancées dominicaines. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les deux pays avaient à peu près le même PIB, mais alors que la République Dominicaine a enregistré des décennies de croissance économique soutenue, l’économie haïtienne demeure languissante, perturbée par les troubles politiques, et les catastrophes naturelles et des mauvaises politiques publiques dans pratiquement tous les domaines. Aujourd’hui, bien que les deux pays aient à peu près la même population, près de 11 millions de personnes, l’économie de la RD est dix fois plus grande que celle d’Haïti. Il nous faut impérativement négocier et surtout bien négocier avec eux. Il y va.
DevHaïti
