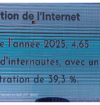Rapport mondial du PNUD : l’intelligence artificielle, nouvel atout pour relancer le développement humain

Début mai 2025, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publie son nouveau rapport mondial sur le développement humain intitulé : « Une affaire de choix : individus et perspectives à l’ère de l’IA ». À l’occasion de la première édition du Sommet Ayiti IA au Karibe Convention Center le 27 juin dernier, le PNUD-Haïti, partenaire de l’évènement, a décidé de dévoiler le contenu dudit rapport à l’assistance de ce sommet répartie au Karibe (en présentiel) et aux spectateurs du reste du monde qui le suivaient à travers diverses plateformes numériques disponibles à cet effet.
Zakaria Zoundi, économiste senior au PNUD, était chargé d’assurer la présentation du rapport 2025 sur le développement humain aux milliers de participants qui assistaient à l’événement. En observant les grandes lignes du rapport, on constate que les progrès du développement humain connaissent un ralentissement sans précédent depuis quelques années.
Face à cette stagnation du développement humain, les rapporteurs du PNUD misent sur l’influence grandissante des nouvelles technologies et plus particulièrement de l’IA pour relancer le développement mondial. Dans sa définition du terme, l’intervenant M. Zoundi indique que le développement humain consiste à donner à l’individu la liberté de vivre une vie à laquelle on tient. L’IA, comme levier de croissance indiscutable, peut contribuer à la relance tant souhaitée du développement, à condition de faire le bon choix.
Le rapport de développement humain est reflété à travers l’indice de développement humain (IDH) qui considère trois éléments fondamentaux : l’espérance de vie à la naissance, le revenu par habitant et l’éducation. Tous ces éléments pris en commun donnent l’IDH, qui est une valeur comprise de 0 à 1. En d’autres termes, un IDH proche de 1 est un IDH élevé, mais quand il se rapproche de 0, c’est un IDH faible.
Analysant le comportement de l’indice de développement humain (IDH) lors des dernières décennies, Zakaria Zoundi relate : « Lorsqu’on observe les tendances de l’Indice du développement humain (IDH) au fil du temps, on voit que le monde a connu une croissance soutenue jusqu’à la pandémie (covid-19). À partir de là, nous avons connu une phase de baisse jusqu’en 2021. On a eu une reprise juste après. Cependant, depuis cette reprise, on n’a pas encore atteint le niveau d’avant la pandémie », examine le présentateur du rapport, soulignant que les blessures causées par les revers de 2020-2021 restent ouvertes et la reprise est lente.
Malgré une performance assez appréciable de l’IDH en 2023, jusqu’ici le niveau n’est pas assez satisfaisant par rapport à celui idéalement attendu, estime l’économiste du PNUD, qui croit que si la lenteur observée lors de l’année 2023-2024 devient la normalité, le monde ne sera pas seulement retardé de quelques mois, mais plutôt de quelques décennies.
Des inégalités croissantes
Et, en mesurant les inégalités entre les pays à IDH faible et ceux à IDH très élevé, le cadre du PNUD dit avoir constaté que ces inégalités se réduisaient au fil du temps jusqu’à la pandémie. « Mais depuis l’époque 2016-2020, on observe une augmentation de ces inégalités, ce qui veut dire qu’on se dirige vers un scénario moins idéal. Car, bien que l’IDH global augmente, il faut s’assurer que cette croissance soit vraiment équitable, c’est-à-dire que ces pays à IDH faible aussi bien que ceux à IDH élevé avancent de façon équitable.
En observant l’évolution de l’IDH à travers le monde, le constat est le même pour les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes, selon les propos de M. Zoundi. « On a relevé des baisses en 2020-2021 et une croissance en 2022. En 2023, le niveau a atteint 0,23 pour la région susmentionnée.
Pour Haïti, de 1990 à 2023, l’IDH est passé de 0,461 à 0,554. Soit une progression de 20,17%. Ce qui est vraiment remarquable, d’après l’économiste du PNUD qui souligne que malgré les défis auxquels fait face l’ex-Perle des Antilles, elle continue à progresser dans la bonne direction en matière d’IDH.
L’IA et le développement humain
Y a-t-il un lien entre l’IA et le développement humain ? Pour trouver la réponse à cette question, le PNUD a lancé une enquête à laquelle 21 personnes dans une vingtaine de pays ont été interrogées. L’enquête a révélé qu’un répondant sur 5 utilise l’IA aujourd’hui ; 2/3 des pays prévoient, d’ici un an, d’utiliser l’IA dans l’éducation, la santé et le travail, trois domaines fondamentaux du développement humain. « Cela montre que si nous faisons les bons choix, l’IA contribuera à développer nos systèmes éducatif, sanitaire et à améliorer la productivité de même que notre IDH », scande M. Zoundi.
Lorsqu’on compare les pays à IDH faible et ceux à IDH plus élevé, on constate qu’en matière d’utilisation récente d’outils alimentés par l’IA dans les pays à IDH faible, 14% des répondants affirment qu’ils ont utilisé l’IA et 66% affirment qu’ils sont en attente de l’utiliser. Par contre, dans les pays à IDH plus élevé, 19% des répondants l’ont déjà utilisé et 46% attendent de le faire. Selon le représentant du PNUD, cela montre qu’au niveau des pays en développement, bien que l’utilisation actuelle ne soit pas assez élevée, on constate une augmentation marquée de l’utilisation des outils alimentés par IA.
L’enquête a aussi révélé que la fréquence et le domaine de l’utilisation de l’IA dépendent du secteur dans lequel l’individu évolue. Par exemple, les étudiants prévoient d’utiliser l’IA dans le domaine de l’éducation. Alors que les personnes retraitées souhaitent utiliser l’IA dans le domaine de la santé.
Est-ce que l’intégration de l’IA représente une menace pour la capacité d’agir humaine ou est-elle un outil d’automatisation ?
Pour cela, le PNUD a mesuré les changements attendus dans les proportions de la population déclarant avoir le contrôle de leur vie grâce à l’IA. Ce qu’on constate, c’est qu’au niveau des pays à IDH faible, la plupart des jeunes pensent que l’IA les rend plus autonomes. Par conséquent, elle ne représente pas de menace sur les capacités d’agir. Au niveau des personnes âgées, il y a une vision plus ou moins pessimiste qui est dégagée par rapport à l’AI.
Fort de ce constat, Zakaria Zoundi s’est plu à dire : « L’ère du numérique ne pourrait pas être en train de remodeler le paysage émotionnel des jeunes ».
Quelle voix l’IA reflète-t-elle ? Qui est dedans ? Qui est dehors ?
Lorsqu’on mesure la corrélation ou le lien entre l’utilisation de ChatGPT et les valeurs des modèles culturels des pays, on les compare à IDH faible et moins élevé, on constate une forte corrélation entre ceux développés et ceux en développement, indique l’intervenant au Sommet Ayiti IA.
Ce constat, poursuit-il, montre simplement que les réponses que ChatGPT donne ont tendance à s’aligner plus étroitement sur les modèles et les opinions culturels des pays à IDH très élevé. Cela peut s’expliquer de façon élémentaire. Ces modèles développés par des pays développés considèrent les réalités culturelles, sociales et les modèles de leurs pays d’origine.
« On doit être en mesure de mettre en place des modèles qui puissent refléter nos réalités. Parce que, actuellement, nous ne sommes que des utilisateurs de ces outils qui se sont développés en considérant les réalités des pays qui les ont mis en place. On doit arriver nous-mêmes à mettre en place des outils qui reflètent nos réalités.
« Donc la jeunesse, la population haïtienne doivent jouer un rôle fondamental dans cette transformation avec le soutien de l’État et du secteur privé », insiste l’économiste du PNUD qui pense que des initiatives telles que le Conseil national du numérique et l’IA d’Haïti et le Fonds de l’IA méritent d’être saluées et encouragées.
En guise de conclusion, Zakaria Zoundi a énuméré trois points clés pour aider l’IA à soutenir le développement humain :
– Construire une économie de complémentarité.
Au lieu de remplacer les humains, l’IA doit travailler à leur côté. Les décideurs politiques doivent encourager les personnes et l’IA à collaborer afin de stimuler la productivité et de soutenir le travail décent. Cela signifie qu’il faut utiliser l’IA pour créer des retombées positives dans l’ensemble de l’économie, aider les travailleurs à s’adapter et veiller à ce que personne ne soit laissée pour compte.
– Guider l’innovation avec intention. L’IA doit être développée en tenant compte des personnes dès le départ et non après coup. L’innovation doit concilier profit et intérêt social en veillant à ce que les outils d’IA aident les personnes à la fois en automatisant les tâches et en améliorant la créativité et la résolution des problèmes.
– Investir dans des compétences et le soutien adéquat. Pour prospérer dans un monde régi par l’IA, les personnes ont besoin des outils et de l’éducation adéquats. L’IA peut contribuer à personnaliser l’apprentissage et le soutien dans plusieurs domaines comme les soins de santé. Mais, les risques tels que les préjugés, la protection de la vie privée doivent être gérés. Dans le même temps, l’IA peut ouvrir de nouveaux emplois qui nécessitent un contact humain.
Enfin, qu’est-ce que tout cela représente pour Haïti ?
Pour Haïti, l’IA représente un bon potentiel avec : une population jeune et dynamique ; un écosystème numérique émergent ; un intérêt grandissant pour l’innovation technologique, l’informatique et l’IA.
Par tous ces facteurs, on peut dire qu’Haïti a de bonnes bases pour bénéficier au maximum des avantages offerts par l’IA. Elle peut aider Haïti à progresser dans de nombreux domaines tels que l’éducation, l’agriculture, les soins de santé, la réponse aux catastrophes ;
« Il faut des investissements stratégiques dans des secteurs tels que les compétences numériques, les infrastructures, la gouvernance et l’entrepreneuriat, qui peuvent offrir à Haïti une opportunité unique de façonner une voie de développement résiliente, équitable et tournée vers l’avenir », conclut le cadre du PNUD.
DevHaiti