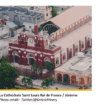Tourisme, IDE, recul de la pauvreté…quelles leçons pouvons-nous en tirer ?

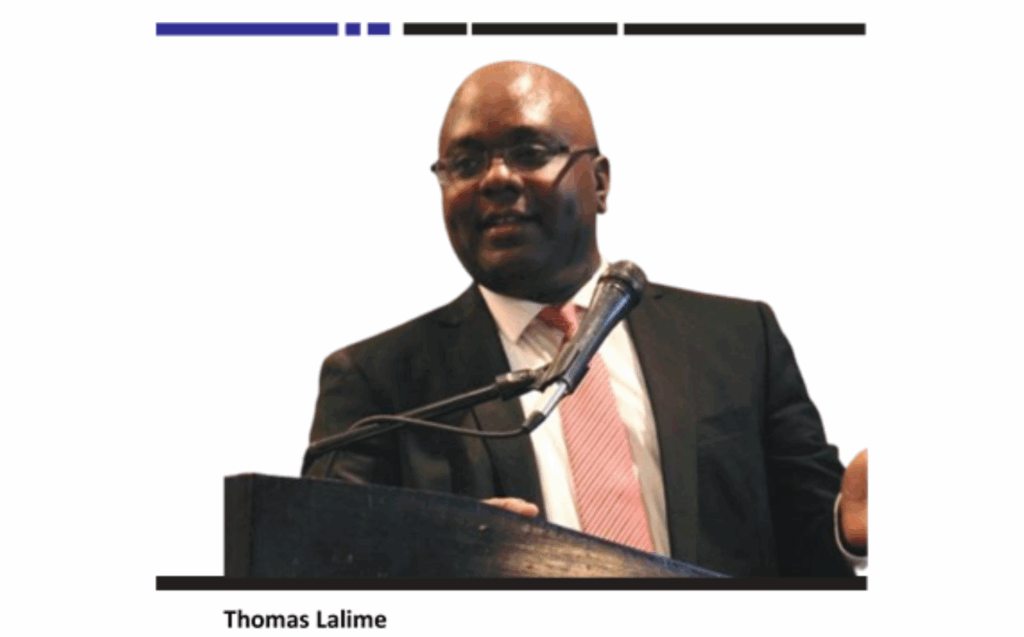
Luis Rodolfo Abinader Corona a pris les rênes du pouvoir en République dominicaine le dimanche 16 août 2020. Économiste de formation et entrepreneur à succès, il aura pour mission de consolider son pays sur la trajectoire de développement économique que ce dernier a entamé depuis la fin de la dernière occupation américaine en septembre 1966. La stabilité politique qui s’en est suivie a été la pierre angulaire de ce processus de développement économique qui a permis au dominicain moyen d’améliorer significativement ses conditions de vie. Elle a permis aux autorités dominicaines de maintenir une stabilité macroéconomique avec un peso relativement stable par rapport au dollar américain, ainsi qu’un taux d’inflation faible en dépit de quelques épisodes de turbulences.
En conséquence, la République dominicaine a fait un saut en termes de réduction de la pauvreté. Sur la période allant de 1990 à 2017, l’Indice de développement humain (IDH) est passé de 0.6 à 0.74, soit une moyenne annuelle de 0.67. En 2018, son IDH a été de 0.745, ce qui l’avait classée à la 121e place sur 228 pays, juste après l’Ukraine. Ce sursaut quantitatif et qualitatif a été possible grâce au tourisme et à l’investissement direct étranger (IDE) qui ont boosté la croissance économique dominicaine.
Le taux de croissance économique a été en moyenne de 5.6 % en République dominicaine au cours des trois dernières années contre seulement 0.6 % au cours de la même période en Haïti. En 2019, ce taux était négatif en Haïti (-0.9 %) contre 5.1 % chez le voisin. Un taux de croissance économique négatif est synonyme de destruction de richesses. La richesse produite en République dominicaine lui permet de limiter le déficit de sa balance commerciale. Les exportations dominicaines sont passées de 6.8 milliards en 2010 à 11.2 milliards de dollars américains en 2019, une hausse de 65 %. Les importations, de leur côté, s’élevaient à 20.3 milliards de dollars américains en 2020 contre 15.2 milliards en 2010, soit une hausse de 34 %. Le déficit de la balance commerciale se chiffre à 9.1 milliards de dollars américains en 2020.
Le tourisme et les investissements directs étrangers (IDE) compensent largement le déficit de la balance commerciale dominicaine. De 2010 à 2018, la République dominicaine a reçu en moyenne 2.5 milliards de dollars d’IDE par année. Le tourisme a rapporté à la République dominicaine environ 7.5 milliards de dollars américains en 2019 avec 7.13 millions de voyageurs non-résidents arrivant par voie aérienne. Les dépenses quotidiennes moyennes des étrangers non-résidents dominicains en 2019 étaient de 136.2 dollars américains avec un séjour moyen de 8.5 nuits. Les Dominicains non-résidents passaient une moyenne de 16.1 nuits et dépensaient 816.7 dollars américains par séjour. Déjà en 2010, le tourisme rapportait à la République dominicaine environ 4.2 milliards de dollars américains.
Cerise sur le gâteau, les transferts de la diaspora dominicaine s’élevaient à 7.9 milliards en 2019 contre 4.3 milliards en 2010. Au bout du compte, si l’on fait le décompte des entrées de devises résultant des exportations, du tourisme, des IDE et des transferts de la diaspora, on obtient un total de 28.7 milliards de dollars américains. Les importations étaient de 20.3 milliards de dollars américains. Il y a eu donc un important surplus de dollars américains sur le territoire dominicain qui a permis de maintenir le peso dominicain relativement stable par rapport au dollar.
Parallèlement, de 2010 à 2018, Haïti a bénéficié d’une moyenne de 156 millions de dollars américains d’investissements directs étrangers. Les transferts privés sans contrepartie de la diaspora, collectés à partir des maisons de transferts entre octobre 2018 et septembre 2019 avaient crû annuellement de 6.4 % pour atteindre 2.5 milliards de dollars. En 2017, une année relativement bonne comparée à 2018 et 2019, Haïti a reçu la visite d’environ 500 000 touristes qui auraient dépensé en moyenne 600 dollars américains par séjour pour un total d’environ 300 millions de dollars américains, selon les estimations disponibles.
Selon la note sur la politique monétaire publiée par la Banque de la République d’Haïti (BRH), au cours des 11 premiers mois de l’exercice 2018-2019, le solde commercial était déficitaire de 2.7 milliards de dollars américains. Durant cette période, les exportations ns atteignaient 1.11 milliard de dollars américains alors que les importations s’élevaient à 4.2 milliards de dollars américains. Globalement, Haïti exporte pour environ un milliard et importe pour 5 milliards de dollars américains pour une année plus ou moins stable.
Si l’on fait le décompte, les IDE, les transferts, les exportations et le tourisme rapportent un montant cumulé de 4.1 milliards de dollars américains pour des importations de 5 milliards de dollars américains pour l’exercice fiscal 2018-2019. L’offre de dollars américains sur le marché local est donc largement inférieure à la demande. L’écart est d’environ un milliard de dollars américains. Cet écart crée une forte pression sur le prix du dollar américain par rapport à la gourde qui est le taux de change. L’augmentation du taux de change et l’inflation importée qui s’en est suivie ont rongé une bonne partie du pouvoir d’achat des ménages. Tout le contraire de la République dominicaine.
Il faut ajouter à ce déficit structurel, des variables conjoncturelles défavorables à la stabilisation du taux de change en Haïti, en particulier l’insécurité et l’instabilité politique qui amplifient l’incertitude qui, elle-même, alimente des anticipations rationnelles négatives des agents économiques concernant l’avenir de la nation n et de l’économie haïtienne. La plus grande leçon à tirer de la République dominicaine est l’importance de la création d’un climat stable et sécuritaire dans la prospérité économique.
Les dirigeants et les institutions dominicaines inspirent beaucoup plus de confiance à leur population comparée à Haïti. Cette confiance est également cruciale pour la croissance économique.
L’investiture du président Luis Rodolfo Abinader constitue un exemple éloquent. En 2020, la République dominicaine réalise des élections incontestables et incontestées, malgré la pandémie de la Covid-19.
C’est le meilleur signal de stabilité politique qu’elle pouvait envoyer aux investisseurs étrangers, aux touristes, aux partenaires économiques et à la communauté internationale. À l’inverse, l’absence d’élections en Haïti pour le renouvellement du mandat des parlementaires, des maires et peut-être du président de la République témoigne du fait que les dirigeants haïtiens ne sont pas encore prêts à consolider le processus d’institutionnalisation de la démocratie, préalable à la stabilisation politique nécessaire au décollage économique.
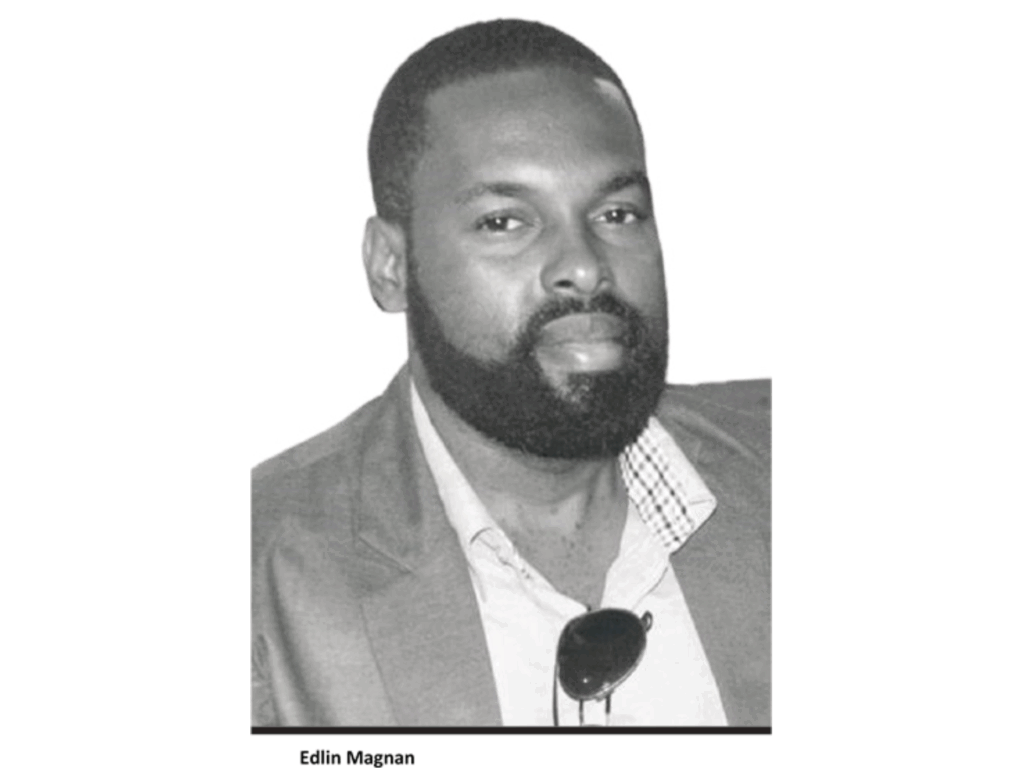
L’économie dominicaine est l’une des plus développées de la Caraïbe. Avec une superficie de 48 670 km2, la République Dominicaine occupe la plus grande partie de l’île. Selon les derniers chiffres officiels, la RD possède un PIB de 85,56 milliards de dollars en (2018) et un IDH de 0,746 (2017).
Depuis plus d’une quarantaine d’années, la RD connait une hausse de croissance économique, en dépit des catastrophes naturelles et des troubles sociaux politiques.
L’agriculture et le tourisme sont deux éléments déterminants dans l’économie de la RD.
Cependant, la COVID-19 a frappé le secteur touristique dominicain de plein fouet, ce qui a nettement diminué le nombre de touristes chez eux. De mars à septembre 2020, la République Dominicaine a été capable de résister et de nourrir ses enfants. Ce qui est différent pour sa voisine la République d’Haïti.
S’appuyant sur les promesses politiques de son nouveau président, Luis Abinader, la RD espère ralentir la propagation de la COVID 19 et relancer son tourisme. Si la RD connait un tel essor en matière de politique économique, c’est à cause des efforts constants d’un peuple ayant la volonté de sortir son pays du marasme économique.
Education civique, bonne volonté et harmonie sont 3 facteurs clés pour le développement de tous pays, la RD a su les expérimenter pour le plus grand bien de ses citoyens, d’où les leçons à tirer.
Edelin Mangnan poursuit sa formation Post Doctorale à AIU (Atlantic International University). Il est détenteur d’un diplôme de Doctorat en Économie avec Spécialisation en Management de Projets de l’Institut Madison de Londres. Il est le Directeur du Centre IPES (Initiative Professionnelle d’Entrepreneuriat Social), Centre de Formation, d’Étude et de Recherche en Entrepreneuriat Social.
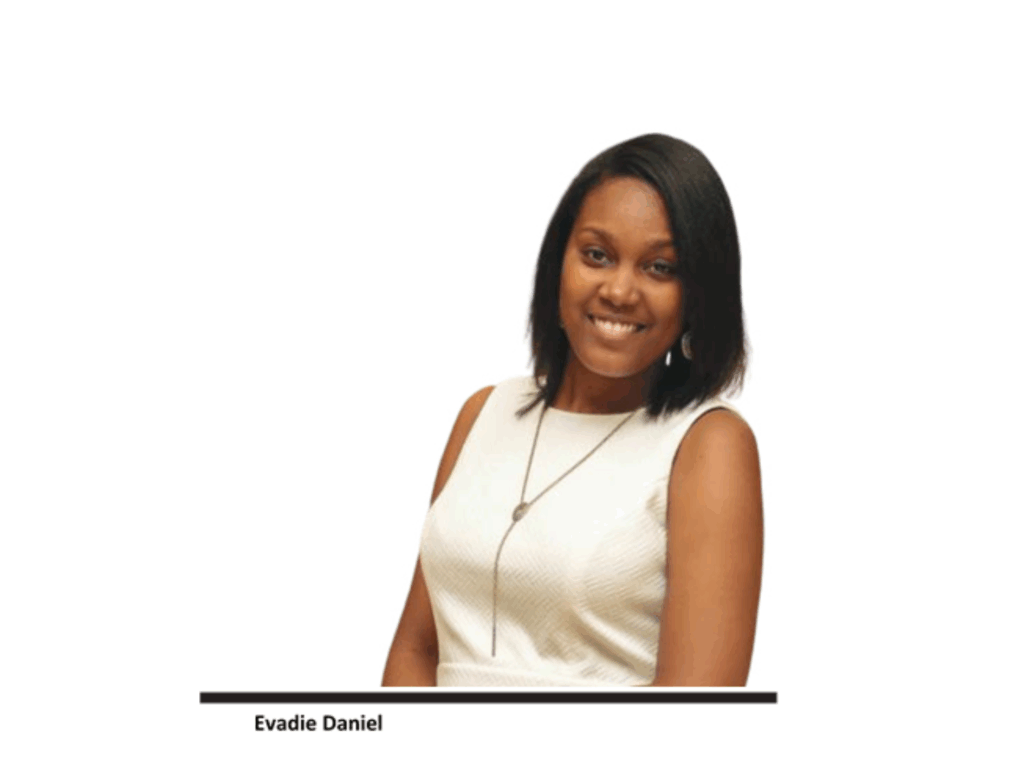
Deux pays se partagent la même île pourtant l’un se présente comme le revers de l’autre. Si l’on revient 60 ans en arrière pour faire une comparaison entre eux, il peut se révéler difficile de croire que le fossé se soit agrandi autant et que l’un se retrouve aujourd’hui aux antipodes de l’autre. L’on ne peut s’empêcher de se questionner sur cette transformation. Qu’a fait le peuple voisin contrairement à nous et que pouvons-nous retenir de ces années de croissance soutenue? Plusieurs leçons peuvent être tirées mais je n’en retiendrai qu’une: la volonté politique des différents gouvernements qui se sont succédés en République Dominicaine de construire une nation. En effet, nous avons tous deux été colonisés quoi que nous fussions plus exploités que nos voisins ; nous avons tous deux soufferts des périodes d’instabilité politique (plus intense en terre voisine avant 1915 que chez nous) et de dictature, et enfin nous avons subi l’occupation américaine durant la même période.
Mais toujours est-il qu’à partir de 1960, alors que nous avions tous deux le même PIB réel par habitant (autour de $800) nos trajectoires allaient diverger considérablement et atteindre en 2019 un PIB percapita de $756 en Haïti contre $8,282 en République Dominicaine.
Et depuis, la République dominicaine continue d’enregistrer le taux de croissance le plus élevé de la région de l’Amérique latine et de la Caraïbes (5.3% en rythme annuel contre 3.8%). Les politiques structurelles, qui reflètent la volonté politique des gouvernements dominicains, ont été les principaux déterminants de cette croissance. Le peuple dominicain, à travers ses gouvernements, a su maintenir les infrastructures publiques et les services sociaux laissés par les américains et diversifier son économie. La République dominicaine a décidé de s’ouvrir au monde et d’asseoir sa croissance économique au fil des ans sur l’industrialisation, la construction, l’agriculture, les services dont particulièrement le tourisme- entre autres. Elle s’est lancée dans un processus de planification de l’économie de demain, en témoignent les différents diagnostics qui ont été commandités par les gouvernements en place et documents stratégiques disponibles pour différents secteurs accompagnés de plans opérationnels annuels.
Il reste quand même que le pays doit renforcer l’état de droit en veillant à combattre la corruption et à promouvoir davantage une croissance inclusive afin de diminuer le niveau de pauvreté qui y existe.
Marie Evadie Daniel, économiste-statisticienne avec une spécialisation en économie de développement et gestion de projets internationaux. Elle est détentrice du PMP, l’une des meilleures certifications en gestion de projets.
DevHaïti