Vers un état des lieux de la protection sociale en Haïti
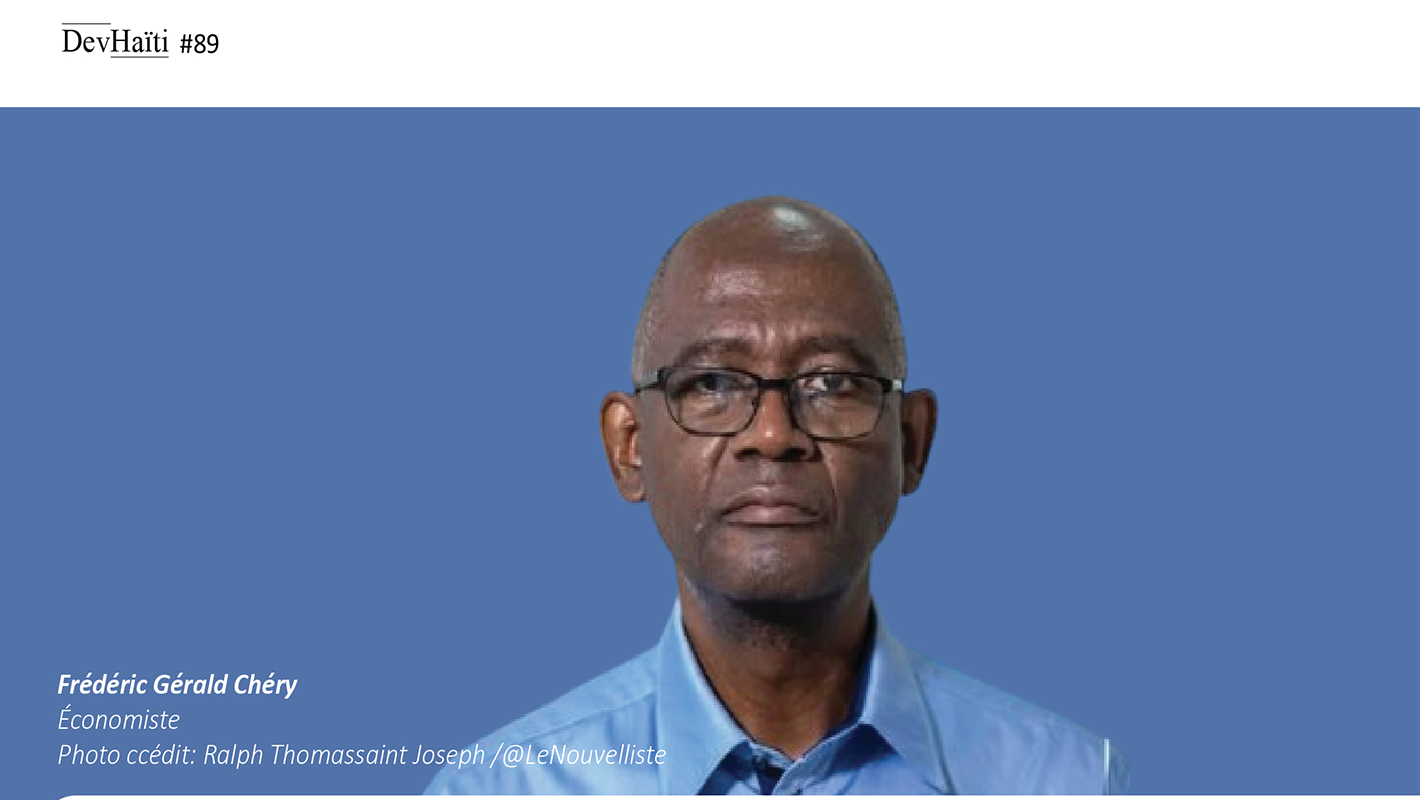
En raison de l’importance cruciale de la protection sociale, toutes les sociétés fournissent un niveau minimal de protection à leurs membres. Toutefois, il est essentiel d’analyser les circonstances ayant motivé les acteurs de la société à ajuster les conditions et les modalités de la protection sociale. D’après l’analyse du professeur et économiste Frédéric Gérald Chéry, la modification du système de protection sociale devient impérative lorsque les dispositifs antérieurs ne parviennent plus à assurer un niveau minimal de protection aux individus.
À titre d’exemple, il s’est référé à la société́ haïtienne qui avait, dit-il, un modèle traditionnel de protection sociale. À cette époque, l’individu pouvait compter sur sa famille ou une famille élargie pour recevoir une assistance au cas où une difficulté (maladie, désastre naturel, infirmité, etc.) survenait.
« Des notables locaux possédant d’immenses terres agricoles assumaient certains rôles de protection et exigeaient des personnes protégées des redevances en retour. Les individus affectés par un risque pouvaient à tout moment retourner vers leurs familles ou des notables pour avoir la nourriture et être soignés. L’argent ne circulait pas, mais les individus étaient assistés en cas d’urgence », explique l’expert-économiste Frédéric Gérald Chéry, qui situe la matérialisation du système de protection sociale moderne en Haïti vers les années 1960.
« L’idée d’un système de protection sociale moderne ressemblant aux modèles industrialisés, notamment européen, s’est progressivement installée en Haïti à partir de la fin des années 1930. À ce moment, les intellectuels haïtiens, notamment les femmes, et les militants politiques et syndicaux se sont beaucoup investis pour discuter des moyens d’organiser la société́ haïtienne et aussi la protection sociale. Ces idées se sont matérialisées pendant les années 1960, sous François Duvalier (loi sur le travail et lois sur la protection sociale en 1968) », indique M. Chéry.
De cette date (1968) à nos jours, aucun changement d’envergure, visant une amélioration de la situation des couches défavorisées de la population, n’a été apporté dans ce système de protection. On ne trouve pas non plus une littérature trop dense sur un sujet d’une telle importance mis à part le travail réalisé́ par le professeur Suze Mathieu pour le compte du Bureau International du Travail (BIT) et intitulé : « Rapport sur l’Etat des lieux de la Protection sociale en Haïti ».
Ce document d’une quarantaine de pages, « Rapport sur l’état des lieux de la protection sociale en Haïti », publié en 2020 met en lumière le rachitisme chronique du système de protection sociale. Après plus d’un demi-siècle d’existence, il se confine dans un processus de marche à reculons, au grand dam du citoyen haïtien aux prises avec toutes les crises et les chocs naturels et humains sans pouvoir compter sur l’aide de l’Etat et encore moins des services d’assurances.
Liste des institutions impliquées dans la protection sociale en Haïti
Il y a les institutions étatiques tels que le ministère des Affaires sociales, la Caisse d’assistance sociale, le Bien-Etre social, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité́ (OFATMA) ; l’Office national d’Assurance Vieillesse (ONA).
Les institutions privées : les Assurances Leger S.A; l’International Assurance S.A. (INASSA) ; La Compagnie d’Assurance d’Haïti (CAH) ; Capital Life Insurance Company, Ltd.
Les organisations internationales ; les organisations à but non-lucratif ; les ONG et fondations ; les syndicats.
Il y a quatre secteurs qui sont impliqués dans le domaine de la protection sociale en Haïti, le secteur public, le secteur privé, les organisations internationales et les institutions à but non- lucratif. Parmi ces quatre (4), seulement deux secteurs sont impliqués directement en offrant des services à la population haïtienne ; le secteur public à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) et le secteur privé à travers les compagnies d’assurances.
Au niveau étatique, il y a cinq institutions qui offrent des services directement à la population, le bureau central du MAST et quatre de ses organes autonomes qui sont la Caisse d’Assistance Sociale (CAS) ; le Bien- Être Social ; L’Office d’Assurance Accidents du Travail et Maternité́ (OFATMA) et L’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA). En additionnant tous les chiffres recueillis de ces institutions, et sans tenir compte de la possibilité́ de compter certaines personnes plus d’une fois, le nombre total de citoyens couvert serait de 261 874. Ce chiffre représente 3,3% de la population haïtienne estimé à plus de dix millions d’habitants.
La grande majorité́ de ceux qui bénéficient des services sociaux de l’Etat habitent Port-au-Prince et ses environs.
Dans le secteur privé, moins que dix (10) compagnies d’assurances offrent des polices d’assurances vie – santé et/ou vieillesse. En excluant les 48 000 fonctionnaires de l’Etat, le nombre de personnes couvert est approximativement 37.000 au niveau national, et comme c’est le cas pour le secteur public, la grande majorité́ habite Port-au-Prince.
Seulement les travailleurs du secteur formel sont inclus, mais un grand nombre ne connait pas les avantages auxquels ils ont droit. Il faut mentionner aussi que pas mal de ceux qui travaillent dans le secteur formel ne sont pas couvert à cause de leur manque d’information et le manque d’effort au niveau étatique pour les renseigner, voir les inclure.
En concluant son rapport, la professeure Suze Mathieu a déclaré́ que cette étude a permis de constater qu’il y plusieurs lois et institutions dans le pays qui sont concernées par ce sujet. Mais comme d’habitude c’est le passage de la théorie à la pratique qui n’arrive pas à se faire convenablement. Pourquoi ? « En me basant sur mes connaissances de la société́ haïtienne et les résultats de cette étude, je dirais que : historiquement l’Etat et les citoyens haïtiens ont toujours entretenus des rapports de suspicion et de méfiance l’un envers l’autre à cause de la succession de gouvernements dictatoriaux et répressifs, qu’a connu ce pays. Alors, arrivé à un tournant où la majorité́ des citoyens ont exprimé́, d’une manière ou d’une autre, leurs désirs de vivre dans une société́ démocratique, il est difficile de construire la confiance et l’intérêt mutuel entre l’Etat et citoyen qui est indispensable à une société́ démocratique » a indiqué l’auteure du rapport.
« Pour le moment, le citoyen haïtien ne se considère pas comme faisant partie de l’Etat. Il ne s’identifie pas à l’Etat. Pour lui, il y a l’Etat qui existe quelque part et lui d’autre part. De la même manière, les instances étatiques ne font pas suffisamment d’effort, pour renseigner les citoyens de leurs droits et de leurs devoirs ».
En guise de recommandations, Mme Mathieu pense qu’il faudrait :
- Travailler à l’application des lois haïtiennes qui existent dans ce domaine ;
- Rendre les institutions existantes fonctionnelles et assurer qu’elles ont une couverture réellement nationale ;
- Informer systématiquement les citoyens de leurs droits et de leurs devoirs dans ce domaine
- Impliquer les citoyens le plus que possible pour assurer la bonne marche des programmes et des institutions.
- Encourager l’Etat haïtien à assumer ses responsabilités envers ses citoyens dans le domaine de la protection sociale, le BIT pourrait considérer une campagne d’information avisant la population haïtienne du contenu des conventions internationales signées par l’Etat Haïtien dans ce domaine. Ceci à l’instar des campagnes d’information de l’UNICEF en ce qui concerne les droits des enfants et des femmes.
- Le BIT pourrait considérer aussi une implication plus active dans le domaine de la micro-assurance et de mutuelles de santé́.
- Comprendre que cette étude nous donne une vision partielle de la situation, il faut prévoir des rencontres de groupe « focus » avec les différentes catégories de personnes qui reçoivent ces services pour avoir leurs opinions sur la qualité́ des services.
Les carences de la protection sociale
Par ailleurs, le professeur et économiste Frédéric Gérald Chéry a fait remarquer que chez nous en Haïti, le modèle contemporain de la protection sociale souffre de nombreuses carences. En premier lieu, il ne répond pas aux besoins de groupes importants d’actifs (traditionnels et émergents) qui sont stratégiques pour l’économie nationale, dont les travailleurs agricoles, les actifs des industries créatives et les jeunes entrepreneurs. Ces catégories oubliées par la loi de 1968 restent négligées. La réflexion macroéconomique axée sur la stabilisation à court terme est déficiente pour répondre à ces éventuels cotisants.
Toujours selon le professeur Chéry, « Il manque un débat sérieux et soutenu autour de la stratégie visant à valoriser le potentiel du secteur productif aux fins d’accroitre, à la fois, la productivité́, les revenus, le niveau des cotisations et des avantages sociaux. Le pays tarde aussi à adopter une politique de l’épargne servant à intégrer les ressources de la protection sociale en vue de multiplier les investissements productifs et valoriser l’épargne. Il faut aussi des investissements dans les équipements sociaux qui permettent aux jeunes haïtiens à mieux se retrouver dans la société́ haïtienne. »
« Haïti n’a plus l’ambiance intellectuelle des années 1930 à 1960 qualifiées de trois décennies d’exception par Yannick Lahens qui avait porté les Haïtiens et les Haïtiennes à penser la manière de construire leur société́ », a conclu l’économiste Gérald Chéry.
L. Gary Cyprien

DevHaiti


